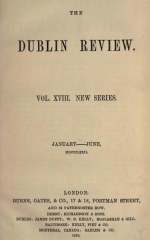22/11/2014
Le jubilé d’un holocauste 1871 - 1921
Trouvé sur Gallica, l'inépuisable source de documents, cet hommage paru en 1921, à l'occasion du jubilé de la Commune.
La proximité des événements se ressent dans le ton de l'article mais nous le livrons comme tel, à titre de document historique. Le lecteur saura prendre la distance nécessaire.
nb: la photo ne figure pas dans l'article d'origine.
oOo
Revue ETUDES. 58e année – tome 167e de la collection – 5 mai 1921
CHRONIQUE DU MOUVEMENT RELIGIEUX
LE JUBILÉ D’UN HOLOCAUSTE
LES OTAGES DE LA COMMUNE (24-27 MAI 1871)
————
I
Les journées du 22 au 28 mai 187 comptent parmi les plus sanglantes et les plus tragiques de la trop longue histoire de nos discordes sociales et de nos révolutions.
Souveraine maîtresse de Paris insurgé, depuis le 18 mars, la Commune achève sa hideuse agonie de bacchante par le massacre et par l’incendie, tandis que l’armée de la France, sous le regard narquois des états-majors prussiens, doit reconquérir laborieusement la capitale, quartier par quartier, rue par rue, monument par monument. Pour projeter un pur rayon de grandeur morale sur cet effroyable drame de guerre civile et religieuse, dont nous allons revivre le cinquantième anniversaire, il faudra l’héroïsme sublime des élus de Dieu et l’holocauste des martyrs.
L’armée à laquelle est dévolue la redoutable mission de rétablir l’ordre légal par la force des baïonnettes est commandée par le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. C’est le 21 mai, au petit jour, que les troupes du maréchal ont pénétré par surprise dans l’enceinte de Paris, à la barrière de Saint-Cloud, puis se sont emparées du château de la Muette et du Trocadéro, qui étaient devenus des forteresses puissamment armées pour la défense.
Voici quelles seront maintenant les étapes de la conquête de Paris. Le 22 mai, prise du rond-point de l’Étoile, de la gare Saint-Lazare, sur la rive droite ; du Champ de Mars et de l’École militaire, sur la rive gauche. Le 23 mai, occupation du faubourg Saint-Germain, de la Madeleine, de l’Opéra, encerclement et assaut victorieux des hauteurs de Montmartre. Le 24 mai, on s’empare du Luxembourg et du Panthéon, sur la rive gauche ; et, sur la rive droite, du Palais-Royal, de la Bourse, de la gare du Nord, de la gare de l’Est. Le 25 mai, prise de laButte aux Cailles et de la place d’Italie, puis de la gare d’Austerlitz, de la gare de Lyon et de la prison de Mazas. Le 26, progression laborieuse jusqu’à la place de la Bastille, puis jusqu’à la barrière du Trône. Le 27, on réduit le puissant bastion constitué par les Buttes Chaumont et le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, le 28 mai, jour de délivrance, prise de la Roquette, prise de l’église de Belleville, prise de l’hôpital Saint-Louis ; les soldats du général de Ladmirault atteignent le Pré-Saint-Gervais. Le pouvoir insurrectionnel de la Commune révolutionnaire est partout anéanti. Force demeure à la patrie et à la loi.
Mais après combien de catastrophes Cette affreuse bataille de rues avait coûté de 7000 à 8000 tués et blessés aux troupes de Mac-Mahon ; et les pertes des insurgés furent, numériquement, beaucoup plus considérables encore. A partir du 23 mai, jour où l’armée de Versailles atteignait la Madeleine, l’Opéra et Montmartre, commençaient les immenses incendies qui allaient se prolonger et s’étendre jusqu’à la fin de la semaine sanglante. La Commune voulait- s’ensevelir sous les ruines de Paris, sous les ruines de tout ce qui perpétuait l’âme des aïeux, de tout ce qui représentait le culte, la croyance, l’art et la gloire du passé. Il y avait des « savants », des techniciens dévoyés et déclassés qui enseignaient doctement le secret infernal d’incendier avec méthode et succès. Les murailles extérieures et intérieures étaient enduites de pétrole, les grands courants d’air étaient soigneusement provoqués, les plus massifs bâtiments étaient attaqués par leurs recoins ou leurs dépendances les plus vulnérables à l’action dévorante du feu. L’incendie ravagera donc la grande chancellerie de la Légion d’honneur, la Cour des comptes et le Conseil d’État, le château des Tuileries, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice. Des bords de la Seine, il gagnera différents autres quartiers de Paris et atteindra le carrefour de la Croix-Rouge.
Notre génération a vu les ruines de la Cour des comptes, et, plus anciennement, les ruines mêmes des Tuileries, encore debout dans leur désolation navrante et grandiose. Mais la génération de nos parents et de nos aînés a contemplé le spectacle terrifiant du gigantesque incendie, qui laissa dans la mémoire de tous les contemporains une impression atroce, un souvenir fantastique.
Les Études ont publié, par exemple, les souvenirs du R. P. Jean Noury, alors supérieur des Jésuites de Versailles. Relisons la scène qu’il rapporte à la date tragique du 24 mai 1871 :
Ce même jour..., nous nous étions rendus, le R. P. provincial [Armand de Ponlevoy] et moi, dans cet endroit du parc de Saint-Cloud qu’on appelait la « lanterne de Diogène », d’autres disaient « de Démosthène ». C’était le point culminant du parc ; on y avait élevé une tour qui, de loin, avait la forme d’une lanterne. De là, Paris offrait un spectacle horrible et grandiose ! L’incendie, allumé dans tous les quartiers de la ville, faisait monter jusqu’au ciel des tourbillons de flammes et de fumée. Beaucoup de personnes étaient réunies à cet endroit, pour tâcher de se rendre compte de ce qui se passait. Mais on devinait difficilement, même avec les plus puissantes lunettes, quels édifices étaient la proie des flammes. On craignait pour Notre-Dame, pour les autres églises, pour la Sainte-Chapelle surtout, qui disparaissait dans un nuage de feu.
Le R. P. de Ponlevoy regarda longtemps en silence, ému et terrifié. « Tel dut être, dit-il, le spectacle qu’offrit la prise de Babylone et de Jérusalem ! C’est d’un grandiose effrayant et d’une horreur toute biblique »...
Après le témoignage d’un vénérable religieux, il faut reproduire celui d’un illustre soldat, le général du Barail, qui écrivait au tome troisième de Mes Souvenirs :
Ce que je vis de la semaine sanglante suffit à me plonger dans un profond sentiment de désespoir et de terreur, et à expliquer les sévérités de la répression. Je vis, du sommet des collines où je circulais avec mes cavaliers, flamber Paris. Le spectacle était horrible et grandiose. Pendant le jour, sous le soleil impassible de mai, c’était une voûte colossale de fumée noire, où tourbillonnaient les cendres des papiers brûlés, et qui s’étendait, comme un dôme de catafalque, sur la capitale pleine de rumeurs des détonations et de cris de rage. Pendant la nuit, le dessous de ce dôme s’illuminait des éclats rouges des fournaises, tandis qu’au-dessus, là-haut, la lune semblait passer, narquoise, sur le cataclysme.
Et je songeais que, pendant que des Français brûlaient Paris, les officiers prussiens regardaient tranquillement, les deux mains sur leur sabre, l’épouvantable complément de leur victoire…
Plus odieux et plus criminel encore que la destruction des monuments de pierre par la Commune révolutionnaire de Paris, fut l’attentat perpétré contre des vies humaines, contre des citoyens désarmés qui comptaient parmi les plus nobles, les plus bienfaisants et les meilleurs. C’est la cause de l’ordre social, c’est la sainteté même de la religion, que voulurent frapper en leur personne les misérables qui les assassinèrent. Nous sommes en présence du suprême forfait de la Commune le massacre monstrueux des otages.
Parmi ceux-ci, on distingue des laïques et des prêtres. Les laïques, au nombre de quarante-cinq, se répartissent de la façon suivante trente-deux gendarmes et gardes de Paris, deux professeurs auxiliaires et six serviteurs de l’école Albert-le-Grand d’Arcueil, un banquier, un publiciste, deux fonctionnaires, un membre enfin de la haute magistrature, M. Bonjean, sénateur, président de Chambre à la Cour de cassation. Quant aux prêtres et religieux, ils furent au nombre de vingt-quatre, et, dans la présente chronique, nous avons le spécial devoir de les désigner avec plus de détails et d’une manière plus expresse.
L’archevêque de Paris, Mgr Darboy.
L’un de ses vicaires généraux, Mgr Surat.
Le curé de la Madeleine, l’abbé Deguerry.
Le curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, l’abbé Bécourt.
Un vicaire de Notre-Dame de Lorette, l’abbé Sabattier.
Un prêtre des Missions étrangères, le R. P. Houillon.
Un aumônier de patronage, l’abbé Planchat (des Frères de Saint-Vincent-de-Paul).
Un ancien missionnaire, aumônier d’ambulance, l’abbé Allard.
Un séminariste de Saint-Sulpice, l’abbé Seigneret.
Un Frère des Écoles chrétiennes, le Fr. Sauget.
Cinq membres du Tiers-Ordre enseignant de Saint-Dominique, à l’école Albert-le-Grand d’Arcueil :
Le R. P. Captier,
Le R. P. Bourard,
Le R. P. Cotrault,
Le R. P. Delhorme,
Le R. P. Chatagneret.
Quatre religieux de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Picpus) :
Le R. P. Radigue,
Le R. P. Rouchouze,
Le R. P. Tardien,
Le R. P. Tuffier.
Cinq religieux de la Compagnie de Jésus, de la maison de la rue de Sèvres et de Sainte-Geneviève de la rue des Postes :
Le R. P. Pierre Olivaint, Le R. P. Léon Ducoudray,
Le R. P. Alexis Clerc,
Le R. P. Jean Caubert,
Le R. P. Anatole de Bengy.
Les prêtres et religieux que nous venons d’énumérer furent massacrés en quatre groupes distincts, les 24, 25, 26 et 27 mai.
Le 24 mai, jour où l’armée de Mac-Mahon s’empara du Luxembourg et du Panthéon, en même temps que des gares du Nord et de l’Est, six otages furent fusillés dans le chemin de ronde de la Grande-Roquette : l’archevêque de Paris, le curé de la Madeleine, le P. Ducoudray, le P. Clerc, l’abbé Allard, et, seul laïque parmi eux, le président Bonjean.
Le 25 mai, tandis que l’armée de Versailles allait s’emparer de la Butte aux Cailles et de la place d’Italie, et s’ouvrir péniblement un chemin vers la gare d’Austerlitz, les PP. Captier, Bourard, Cotrault, Delhorme, Chatagneret, du Tiers-Ordre enseignant de Saint-Dominique, étaient massacrés, avec deux maîtres laïques et six serviteurs de leur école Albert-le-Grand d’Arcueil, dans une impasse voisine de la place d’Italie et de l’église Saint-Marcel de la Maison-Blanche.
Le 26 mai, jour où la Commune perdait le faubourg Saint-Antoine et tout le secteur compris entre la place de la Bastille et la place de la Nation, avait lieu, sur les hauteurs de Belleville, cité Vincennes, au 85 de la rue Haxo, l’épouvantable scène de boucherie dans laquelle furent mis à mort, à coups de fusil et à coups de baïonnette, ou même à coups de couteau, quarante-sept otages, dont trente-sept gendarmes et gardes de Paris et dix ecclésiastiques les PP. Olivaint, Caubert et de Bengy, de la Compagnie de Jésus ; les PP. Radigue, Rouchouze, Tardien et Tuffier, de Picpus ; l’abbé Sabattier, de Notre-Dame de Lorette ; l’abbé Planchat, du patronage de Charonne ; le jeune abbé Seigneret, séminariste de Saint-Sulpice.
Enfin, le 27 mai, date de la prise des Buttes Chaumont et du Père-Lachaise, les geôliers communards de la Grande-Roquette ayant déserté leur poste devant la perspective imminente d’un châtiment certain, plusieurs d’entre les trente et un prêtres et religieux, encore détenus dans la prison bombardée, avec des gendarmes et des gardes de Paris, se risquèrent à sortir, croyant respirer désormais l’atmosphère de la liberté reconquise. C’était vingt-quatre heures trop tôt : Mgr Surat, vicaire général, l’abbé Bécourt, curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et le P. Houillon, des Missions étrangères, furent abattus, massacrés au coin d’une rue, dans le quartier même de la Roquette.
L’holocauste était consommé. Le lendemain, dimanche 28 mai, sera, nous l’avons dit, le jour de la délivrance pour Paris incendié, ravagé, ensanglanté, sur lequel planait, depuis dix semaines, le plus hideux cauchemar. A la victoire finale du bon droit, avait préludé le sacrifice magnanime offert à Dieu par vingt-quatre « témoins » de sa propre cause et ministres de son immortelle Église.
II
Sur la voie douloureuse de la plupart des otages de la Commune, trois étapes sont particulièrement mémorables : Mazas, laRoquette, la rue Haxo.
Mazas, c’est la maison d’arrêt, la prison cellulaire, où ils demeureront séquestrés, chacun dans son étroit réduit, et sans être l’objet de la moindre instruction judiciaire, depuis la première quinzaine d’avril jusqu’au soir du 22 mai. Prisonniers d’État, ils sont au secret, par mesure de haute police et de suprême arbitraire des commissaires du peuple, notamment du féroce procureur de la Commune, Raoul Rigault.
Le plus important des otages était Mgr Darboy, l’archevêque de Paris. Des souvenirs quelquefois pénibles s’attachaient aux controverses doctrinales qui marquèrent son épiscopat de prélat gallican. Mais tout disparaissait désormais dans l’auréole de son malheur, de ses longues souffrances pour le Christ et l’Église, en attendant la gloire tragique d’une auréole plus splendide encore. Durant sa captivité, il relisait avec amour les livres qui lui étaient envoyés de sa belle bibliothèque de sciences ecclésiastiques, il revivait les jours où il avait été professeur de philosophie au petit séminaire, puis aumônier des normaliens. Sur sa poitrine, il gardait la croix pectorale de Mgr Affre, l’archevêque pacificateur dont le sang avait été le dernier versé au pied des barricades de juin 1848. A son doigt, il portait l’anneau pastoral de Mgr Sibour, cet autre archevêque de Paris poignardé à Saint-Etienne-du-Mont, en 1857, au milieu des fêtes de sainte Geneviève…
Le ministre plénipotentiaire des États-Unis, M. Washburne, obtint de visiter, un jour du mois d’avril 187 1, l’archevêque de Paris, prisonnier à Mazas. Pareil témoignage mérite d’être reproduit dans ses affirmations essentielles :
Je dois avouer que je fus profondément touché de l’aspect de cet homme vénérable. Sa personne amaigrie, sa taille mince et légèrement courbée, sa longue barbe, qui, selon les apparences, n’avait pas été rasée depuis sa captivité, son visage hagard et indiquant une santé ébranlée, tout en lui était de nature à affecter même les indifférents…
Le 19 mai, un autre visiteur pénétrait, par privilège, à Mazas, auprès de l’archevêque captif. C’était Me Edmond Rousse, qui venait briguer le périlleux honneur de le défendre éventuellement devant les tribunaux de la Commune. L’illustre avocat devait plaider, plus tard, pour d’autres nobles causes non moins désespérées, mais non moins dignes de son amour passionné pour le droit. Jusqu’au bout de sa carrière, selon le mot du duc d’Aumale, il unirait au talent de bien dire le courage de bien faire. L’impression de Me Rousse sur Mgr Darboy est aussi douloureuse et aussi émouvante que celle du diplomate américain :
En entrant dans la cellule du pauvre archevêque, je fus frappé de son air de souffrance et de son abattement. Grâce au médecin de la maison, on avait remplacé par un lit le hamac réglementaire des détenus. Il était couché tout habillé, les moustaches et la barbe longues, coiffé d’un bonnet noir, vêtu d’une soutanelle usée, sous laquelle passait un bout de ceinture violette, les traits altérés, le teint très pâle…
… Après une demi-heure de conversation, je lui tendis la main et pressai la sienne avec émotion. Plus d’une fois, je sentis les larmes me gagner. Il me dit adieu avec effusion, me remerciant vivement de ma charité. Ma visite, l’assurance que je lui donnais que le jugement n’aurait pas lieu tout de suite, la promesse que je lui fis de venir le voir souvent l’avaient évidemment remonté. Quand je me levai, il rejeta vivement la couverture de laine grossière qui l’enveloppait à moitié, descendit de son grabat sans que je pusse l’en empêcher, et, me serrant la main dans les siennes, il me reconduisit jusqu’à la porte.
Vous reviendrez bientôt, n’est-ce pas
– Mardi, Monseigneur.
« Mardi » sera le 23 mai. Depuis la veille, Mgr Darboy aura été transféré à la Roquette, la prison des condamnés à mort. Et, le mercredi 24, il sera fusillé sans jugement.
Mais revenons au 19 mai. Après sa conversation avec l’archevêque, Me Rousse fit une visite semblable au vénérable curé de la Madeleine, l’abbé Deguerry, naguère confesseur de l’impératrice Eugénie. Puis il eut un entretien avec le P. Jean Caubert, ancien avocat, Jésuite de la rue de Sèvres, dont il avait personnellement connu le père et le frère. Me Rousse voulut faire entrevoir au prisonnier du Christ une délivrance possible. Le visiteur nous rapporte que les espérances du P. Caubert étaient d’une autre sorte.
Il m’écoutait avec l’indifférence la plus sincère, souriant toujours et ayant l’air de penser : à quoi bon tout cela ? Enfin, il me dit :« Je vous remercie beaucoup de ce que vous faites. Il en sera ce qu’il plaira à Dieu. S’ils veulent nous tuer, ils en sont les maîtres. » Et, s’éloignant tout de suite de ce qui le regardait :« C’est une bien grande épreuve pour le pays, me dit-il, et qui le sauvera ? » Comme je lui exprimais mes doutes à cet égard : « Quant à moi, me dit-il avec le plus grand calme, jene doute pas, je suis sûr, je crois fermement que la France sortira de là régénérée, plus chrétienne, et, par conséquent, plus forte qu’elle n’a jamais été… »
… Je me levai, un peu gêné, et ne trouvant pas grand’chose à dire à un homme si fermement trempé, et dont le courage me semblait si fort au-dessus du mien.
Dans les premiers jours de son incarcération à Mazas (12 avril), Mgr Darboy avait cru devoir, comme tel était indubitablement son droit, écrire une lettre au Chef du pouvoir exécutif, à Versailles, Adolphe Thiers, pour appuyer un projet d’échange entre prisonniers politiques. Moyennant la libération, par le gouvernement légal de Versailles, du révolutionnaire Blanqui, condamné pour acte de sédition et d’insurrection, la Commune de Paris consentirait à remettre en liberté l’archevêque de Paris, le président Bonjean, l’abbé Deguerry, le vicaire général Lagarde et la sœur de l’archevêque, Mlle Darboy (laquelle allait être délivrée, de fait, après trois semaines d’incarcération arbitraire). L’abbé Lagarde, libéré sur parole, fut chargé de porter à Versailles le message de l’archevêque. Adolphe Thiers jugea inacceptable un échange qui semblait supposer ‘une analogie ou une équivalence entre la condition d’un criminel politique, comme Blanqui, et celles des otages de la Commune. Le gouvernement de Versailles interdit à l’abbé Lagarde de rentrer dans Paris, malgré les adjurations pressantes que lui adressait l’archevêque prisonnier. Au total, l’incident laissa, parmi les contemporains, une impression pénible et troublante.
Des projets d’échange continuèrent néanmoins à circuler avec quelque insistance. Le 6 mai, l’un des Jésuites détenus à Mazas, le P. Alexis Clerc, ancien officier de marine et professeur à l’école Sainte-Geneviève de la rue des Postes, recevait inopinément la visite d’une dame qui, durant le siège de Paris, avait été infirmière dans une ambulance où lui-même avait été aumônier. Cette dame avait accès auprès de l’un des potentats de la Commune révolutionnaire, et, en visitant le P. Clerc, amenait au prisonnier de Mazas, son propre frère, M. Jules Clerc, qui allait ainsi le revoir une dernière fois avant la suprême catastrophe. La charitable visiteuse annonce au P. Clerc que, s’il y consent, le haut personnage révolutionnaire ira prochainement le voir pour lui proposer d’être compris dans un échange de prisonniers politiques. Mais, aussitôt, l’ancien officier de marine bondit comme sous un outrage :
— De grâce, contenez-vous, lui dit-on, et, surtout, si l’offre vous est faite, n’allez pas vous compromettre... Il vous en arriverait malheur !
— Quel malheur ? Et qu’ai-je à craindre ? Nous ne pouvons guère être plus mal qu’à la Conciergerie et à Mazas.
— Pardon, mon Père, pardon…
Alors, s’écria-t-il en tressaillant, nous serions fusillés ! Quelle bonne fortune ! Tout droit en Paradis !
Et il avait l’air radieux, les mains étendues, les yeux au ciel...
Le soir même, le P. Alexis Clerc écrivait encore
J’ai entendu parler de propositions d’échange entre certaines personnes. Absit ! Je ne veux pas. Je patiente très bien, et le ferai tant qu’il faudra. Mais il y a tant de raisons pour refuser un échange. Oh !non !
Le P. Clerc n’avait guère d’illusions sur son sort. Néanmoins, sa libération, à la faveur d’un brusque écroulement de la Commune révolutionnaire, demeurait une éventualité possible. Professeur de sciences à la rue des Postes, il avait à prévoir la reprise de son cours au s futurs polytechniciens. Il réclama donc des livres de géométrie analytique, et, durant tout le temps qu’il ne consacra pas aux exercices de piété, il occupa laborieusement sa captivité à préparer son cours, en vue de la prochaine rentrée scolaire. Exemple magnifique de fidélité à la conscience professionnelle !
L’épisode le plus émouvant de la détention des otages est l’entrée mystérieuse de Notre Seigneur lui-même, sous le voile des espèces eucharistiques, dans la cellule de quelques-uns des prêtres et religieux qui s’apprêtaient à lui offrir le témoignage de leur sang.
Trois fois, l’audacieuse et sainte expédition fut accomplie, et avec un heureux succès, par une intrépide chrétienne, Mlle Delmas, directrice de l’Orphelinat des enfants délaissées, rue Notre-Dame-des-Champs. Ce fut, d’abord, le 13 avril, le jour même où les PP. Olivaint et Caubert allaient être conduits de la prison du Dépôt à la prison de Mazas. Ce fut, ensuite, le 15 mai, à Mazas même, quand des intelligences eurent été nouées, avec les garanties de sécurité nécessaires, parmi les geôliers des PP. Olivaint, Ducoudray et Clerc. Ce fut, enfin, dans la matinée du 22 mai, jour où les otages allaient quitter Mazas pour la Roquette. Le bombardement faisait rage, la ligne de feu s’étendait de la gare Saint-Lazare à l’École militaire. Mlle Delmas et une compagne digne de sa vaillance faisaient à pied, dans une prière silencieuse, la longue étape de la rue Notre-Dame-des-Champs à la prison de Mazas, près la gare de Lyon, et elles apportèrent sans encombre le précieux dépôt, qui fut immédiatement transmis aux PP. Olivaint, Ducoudray, Clerc, Caubert et de Bengy. Pour tous les cinq et pour plusieurs de leurs compagnons de supplice, notamment Mgr Darboy, Mgr Surat et l’abbé Deguerry, ce sera le viatique divin du dernier voyage et du suprême combat.
Pour chaque destinataire, le P. Hubin, lors du premier envoi, et le P. Matignon, lors du deuxième et du troisième envoi, placèrent quatre hosties consacrées dans une custode, enveloppée d’un corporal et renfermée dans un sachet de soie, lequel était muni d’un cordon pour être porté au cou. Le tout avait été introduit dans le double fond, hermétiquement fermé, d’un pot de crème, rempli jusqu’au bord. Les prisonniers étaient dûment avertis par des messages écrits en style conventionnel. A chaque envoi, ils purent faire savoir que l’aliment tant désiré leur était fidèlement parvenu et qu’ils avaient le bonheur d’être maintenant christophores.
Une lettre d’actions de grâces, écrite de Mazas, le 16 mai, par le P. Alexis Clerc, mérite d’être rapprochée de l’épitre fameuse aux chrétiens de Rome, où le martyr saint Ignace d’Antioche, au début du second siècle, chante avec amour son ardent désir d’être uni par le sacrifice de son sang au Pain véritable et vivant, Jésus-Christ
Ah !prison, chère prison, toi dont j’ai baisé les murs en disant : bonacrux !quel bien tu me vaux. Tu n’es plus une prison, tu es une chapelle. Tu ne m’es plus même Une solitude, puisque je n’y suis pas seul, et que mon Seigneur et mon Roi, mon Maître et mon Dieu y demeure avec moi...
Oh !dure toujours, ma prison, qui me vaux de porter mon Seigneur sur mon cœur, non pas comme un signe, mais comme la réalité de mon union avec Lui ! Dans les premiers jours, j’ai demandé avec une grande insistance que Notre Seigneur m’appelât à un plus excellent témoignage de son nom. Les plus mauvais jours ne sont pas encore passés. Au contraire, ils approchent, et ils seront si mauvais que la bonté de Dieu devra les abréger. Mais, enfin, nous y touchons.
J’avais l’espérance que Dieu me donnerait la force de bien mourir. Aujourd’hui, mon espérance est devenue une vraie et solide confiance. Il me semble que je peux tout en Celui qui me fortifie et qui m’accompagnera jusqu’à la mort.
Le voudra-t-il ? Ce que je sais, c’est que [s’il ne le veut] j’en aurai un .regret que la seule soumission à sa volonté pourra calmer...
La préparation au martyre est achevée.
L’holocauste sanglant va s’accomplir.
III
Dans la soirée du 23 mai, tous les otages qui venaient de passer, à Mazas, plusieurs semaines au régime de la prison cellulaire, se trouvaient incarcérés à la Grande-Roquette, prison des condamnés à mort. Ceux que le Seigneur avait choisis pour le martyre allaient y passer, les uns deux jours, la plupart quatre jours, quelques-uns cinq jours. Les autres, que l’Ange de Dieu n’aura pas marqués pour le même témoignage, seront délivrés le sixième jour.
Les conditions matérielles et morales de leur nouvelle (mais -combien passagère) installation représentèrent, pour les captifs du Christ, un incomparable adoucissement. Au lieu du jour parcimonieusement mesuré des lucarnes de Mazas, chaque cellule bénéficie d’une vraie fenêtre, s’ouvrant à hauteur d’appui et donnant libre accès à l’air et à la lumière. En outre, ce n’est plus l’isolement. Chaque cellule n’est séparée de la cellule contiguë ̃que par une mince cloison, qui partage par moitié, entre les deux prisonniers, la même fenêtre commune. A un signal donné, l’un et l’autre captif peut se rendre à la fenêtre et converser librement avec son voisin. On retrouve aujourd’hui cette disposition des lieux au numéro 85 de la rue Haxo, où les cellules de quelques-uns des otages ont été parfaitement reconstituées, après achat des diverses pièces de leur matériel (portes, verrous, grillages), lors de la démolition de la Grande-Roquette.
Non seulement les prisonniers pouvaient ainsi converser deux à deux, mais, deux fois par jour, ils avaient récréation commune, avec liberté de se voir dans le chemin de ronde, ou dans le couloir de la prison, ou même dans les cellules les uns des autres. On devine quel réconfort moral les otages de la Commune, prêtres et laïques, trouvèrent dans cette facilité bienheureuse de se communiquer mutuellement les secours fraternels et spirituels que réclamaient leur épreuve déjà longue et l’imminence du dernier sacrifice.
Les entretiens de Mgr Darboy et du P. Olivaint furent d’un caractère particulièrement émouvant les dissentiments des années précédentes disparaissaient à jamais dans la communauté d’un même témoignage rendu à la même cause pour le même amour. Le religieux put donner à l’archevêque le trésor des trésors, le Pain divin de l’Eucharistie.
Le P. Olivaint reconnut, parmi les otages laïques, un de ses anciens camarades de l’École normale, M. Chevriot, proviseur du lycée de Vanves (alors succursale de Louis-le-Grand). Après les premières effusions, le P. Olivaint, abordant un grave sujet, demanda simplement et affectueusement à M. Chevriot s’il comprenait comme lui les devoirs que leur imposait la perspective menaçante de la mort. Le proviseur répondit que rien ne les séparait plus. Dès la vieille, il avait fait sa paix avec Dieu, et s’était confessé au P. Houillon, des Missions étrangères, son voisin de cellule. « Fort bien, mon cher camarade, répliqua en souriant le P. Olivaint. Mais il me semble que vous m’apparteniez, et que j’ai un peu le droit d’être jaloux ! »
Dans une lettre du 25 avril, datée de Mazas, le P. Clerc écrivait à son frère Jules qu’il avait prévu de longue date la probabilité d’une incarcération à subir. « Pour ne pas exagérer les pressentiments que je reçois, continuait-il, je dois ajouter que j’imaginais que cela se ferait par le moyen régulier et officiel d’un M. Bonjean quelconque, magistrat des vieux Parlements, tandis que ce pauvre M. Bonjean trouvemoins étonnant de se voir lui-même en prison, que de s’y voir avec les Jésuites. Oh !fortune !je puis dire aussi : Oh ! Commune, voilà de tes coups ! » Un mois plus tard, à la Grande Roquette, c’était le Jésuite Alexis Clerc qui occupait la cellule contiguë à celle du président Bonjean.
La rencontre pouvait sembler paradoxale. Ce contact suprême et inopiné avec un prêtre de la Compagnie de Jésus n’allait-il pas bouleverser un magistrat qui incarnait, au su de tout le monde, et qui avait formulé avec âpreté, à la tribune du Sénat impérial, les plus violentes préventions des légistes et des césariens du gallicanisme d’État contre la puissance ecclésiastique, contre Rome et surtout contre les Jésuites? Mais, aux approches d’une mort tragique, la grâce de Dieu faisait luire, dans l’âme du magistrat gallican, des clartés nouvelles, lui faisait découvrir d’autres horizons. La charité sacerdotale du P. Clerc, sa droiture et sa générosité chevaleresques émurent, séduisirent, le président Bonjean. Sur le terrain de l’honneur, sur le terrain de la conscience professionnelle, les deux captifs n’auraient nulle peine à s’entendre. Nous connaissons déjà le P. Clerc. Quant au président Bonjean, il était revenu à Paris, en pleine Commune, pour prendre place à la tête de la Cour de cassation, comme doyen des présidents de Chambre, le premier président se trouvant écarté par la maladie.C’est au sortir même de son audience que le président Bonjean avait été arrêté, incarcéré, par les forbans de la Commune. Lorsque, pour des raisons de famille, on avait envisagé, pour lui, la libération temporaire, comme prisonnier sur parole, il avait, d’accord avec sa noble femme, refusé la perspective d’un tel avantage, craignant qu’un obstacle de force majeure l’empêchât de rentrer à Paris et lui donnât l’apparence d’avoir trahi, par crainte de la mort, son engagement d’honneur. Après quoi, le fier magistrat français avait, dans sa prison, écrit, pour ses enfants, cette déclaration admirable :
… Moi qui n’ai jamais trompé personne, moi qui voudrais encore moins tromper mes enfants en ce moment solennel, je vous affirme que, si misérable que puisse être la fin qui paraît m’être destinée, je ne voudrais à aucun prix avoir agi autrement que je ne l’ai fait. C’est que le premier bien, mes chers enfants, c’est la paix de la conscience et que ce bien inestimable ne peut exister que pour celui qui peut se dire :J’ai fait mon devoir.
Entre cet homme d’honneur et de haute conscience qu’était le président. Bonjean, et l’ancien officier de marine, le chevalier intrépide, le prêtre et le religieux au grand cœur, qu’était le P. Alexis Clerc, l’accord ne tarda pas à devenir étroit et cordial.
Tous deux causèrent longtemps, à la commune fenêtre de leurs deux cellules. Ils causèrent encore, seul à seul, dans le chemin de ronde, durant le temps de la récréation des détenus. Les autres otages respectaient l’intimité d’un dialogue dont chacun soupçonnait aisément le caractère. Enfin, les deux interlocuteurs se séparèrent, et le président Bonjean, le visage tout radieux, aborda l’archevêque de Paris :« Eh bien ! Monseigneur, s’écria-t-il, moi, le gallican, qui aurait jamais cru que je serais converti par un Jésuite ?... »
Ces choses étaient dites dans la matinée du 24mai. Dans la soirée du même jour, au pied des hautes murailles de: la Roquette, un double feu de peloton, salué par les acclamations haineuses et féroces de la populace qui avait envahi l’enceinte de" la prison, foudroyait tes six premières victimes Mgr Darboy et le président Bonjean, les abbés Deguerry et Allard, le P. Ducoudray, recteur de la rue des Postes, et le P. Alexis Clerc, son fidèle compagnon de labeur et de martyre. La dernière vision qu’un témoin eût gardée de l’archevêque, dont le corps était déjà criblé de balles, mais avant le coup de grâce, est celle qu’a immortalisée, à Notre-Dame de Paris, le monument de Mgr Darboy par le sculpteur Bonnassieux la main gauche s’appuyait sur le mur, tandis que la main droite demeurait élevéedans un geste de suprême bénédiction. Le Bon Pasteur donnait sa vie pour son troupeau, et, comme le Christ, il pardonnait à ses meurtriers.
Le surlendemain, 26 mai, à Belleville, au 85 de la rue Haxo, avait lieu la grande hécatombe de quarante-sept otages de ta Commune, dont dix ecclésiastiques, parmi lesquels quatre Pères de Picpus et trois Jésuites.
Pour mieux savourer l’amertume du calice d’agonie, les otages qui, depuis la Roquette, venaient de subir l’épuisante fatigue de la voie douloureuse, durent supporter encore une longue attente, rue Haxo, parmi les menaces et les clameurs furieuses de la multitude en délire. Le sort des victimes se discutait confusément, tumultuairement, dans un conseil de guerre improvisé, dont l’issue ne pouvait être douteuse.
Avec le citoyen Hippolyte Parent, dernier commandant en chef de l’insurrection vaincue, la plupart des « juges » réclamaient l’exécution générale des otages, tandis qu’une tardive clémence était plaidée, au nom de l’intérêt politique, par quelques prévoyants de l’avenir.
Mais -à quoi bon tant de palabres ? Le débat se prolonge par trop, au gré de la foule révolutionnaire. Une vivandière de dix-neuf ans décharge son revolver. Un otage tombe foudroyé. Alors, il se produit une poussée formidable, tandis que le boucher Victor Bénot rugit :A mort !et que des centaines de voix avinées répètent :A mort ! A mort ! Ce sera la parole décisive.
Les otages sont entraînés pêle-mêle, vers le fond de la cité Vincennes, par delà le petit mur (haut de 50 centimètres) d’un immeuble en construction, et acculés au pied d’une haute muraille de couleur sombre. L’heure du massacre est venue.
Fédérés et vivandières tirent dans le tas, soit à coups de fusil, soit à coups de revolver, tandis que d’autres assassins, à califourchon sur le mur d’enceinte, dirigentcontre les otages un feu plongeant. Après quoi, la foule se rue sur les malheureux, qui râlent et gémissent encore. On les piétine, on les larde de coups de baïonnette et de coups de poignard, jusqu’à ce que tous soient entrés dans l’éternel silence.
Puis, les quarante-sept cadavres sanglants, horriblement mutilés et défigurés, furent jetés, entassés, dans une fosse de maçonnerie qui était destinée à devenir la fosse d’aisances de l’immeuble en construction. Du regard humain, tous les détails du massacre et de ses suites concourent à augmenter l’épouvante de cette affreuse, de cette répugnante scène de boucherie, qui reste le plus hideux forfait de la Commune agonisante.
Si nous commémorons le jubilé des otages de la Commune, ce n’est pas dans une pensée de haine ou de vengeance, mais en vue de rendre hommage à l’héroïsme de tant de nobles victimes.
C’est en vue de remercier le Dieu très bon et très saint qui, par la vertu spirituelle de leur sanglant holocauste, daigna exercer sur les âmes croyantes et incroyantes, sur les œuvres d’apostolat intellectuel ou populaire, sur la France repentante et consacrée, les magnifiques desseins d’amour dont témoigne, parmi tant d’épreuves, l’histoire religieuse des cinquante dernières années.
Les Dominicains enseignants d’Arcueil, fusillés, le 25 mai 1871, non loin de la place d’Italie, étaient tombés en criant :C’est pour le bon Dieu ! Parmi les prêtres et religieux massacrés rue Haxo, nous en savons deux qui, ayant atteint l’âge d’homme et, suivant déjà une autre carrière, avaient tout quitté, en 1845, pour entrer dans la Compagnie de Jésus proscrite, se sentant impérieusement sollicités par l’attrait de la persécution C’était l’universitaire Pierre Olivaint, dont le P. Charles Clair a retracé avec tant de charme la sainte carrière, et c’était le juriste Jean Caubert, qui aura eu pour historiographe son neveu, le R. P. Pierre Lauras, aujourd’hui directeur de la Conférence Laënnec. Ce qu’ils ont cherché, ils l’ont trouvé au delà de leurs plus magnanimes désirs d’immolation et de sacrifice, quand, le 26 mai 1871, ils donnèrent au Christ, à l’Église et aux âmes le suprême témoignage d’amour.
Sans nous permettre de dire encore les paroles que l’Épouse du Christ veut être la première à prononcer, nous avons le droit de rappeler que, dans le langage de l’antiquité chrétienne, pareil témoignage se nomme le martyre. Archevêque, vicaire général, prêtres du clergé séculier ou régulier, aspirants au sacerdoce ou éducateurs religieux des enfants du peuple, tous les otages de la Commune qui ont été arrêtés et mis à mort en raison même de leur qualité d’ecclésiastiques ou de religieux, et qui ont volontairement accepté la mort pour cette sainte cause, paraissent réaliser chacune des conditions que la Tradition catholique exige pour que le témoignage du sang prenne le caractère et reçoive l’auréole du martyre.
Déjà, notre cœur discerne et salue les témoins du Christ, immolés le 24, le 25, le 26, le 27 mai 1871, dans la blanche armée des cieux qui, selon les paroles du Te Deum, chante la louange du Seigneur par un éternel cantique.
Nous glorifions, par leur mémoire et leurs exemples, le Dieu tout-puissant que leur mort héroïque a plus dignement glorifié. Nous appelons avec espoir et confiance leur secours céleste sur tout ce que nous aimons et tout ce qu’ils ont aimé.
Mais nous nous gardons d’intercéder nous-mêmes pour leur âme et leur salut, comme s’ils pouvaient avoir besoin de notre aide, car nos aillés dans la foi nous ont appris que ce serait une impiété de prier pour des martyrs.
Yves de la BRIERE
la villa des otages.
Nous nous permettons de signaler à la délicate charité de nos lecteurs et lectrices les œuvres d’apostolat populaire (patronage de garçons, patronage de filles, institutions annexes) qui perpétuent la mémoire des nobles otages de la Commune au lieu même de leur massacre 85, rue Haxo.
A la « villa des otages », on retrouve le cadre presque intact de l’horrible scène du 26 mai 1871. Sur le mur sombre du massacre, on lit la liste des victimes qui furent mises à mort, voilà cinquante ans, par haine du droit, de la religion et de la paix, odioiuris, religionis et pacis. Devant ce mur, on contemple la fosse encore béante où furent jetés pêle-mêle les cadavres des victimes. Dans le bâtiment contigu, on visite les cellules des otages, telles qu’elles étaient à la Roquette.
Chaque secours donné aux œuvres de la « villa des otages » sera un hommage rendu à la sainte mémoire des témoins du Christ et une contribution méritoire à la fécondité de leur sacrifice.
Y. B.
Disponible sur Gallica :ark:/12148/cb34348593d/date
15:35 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Compagnie de Jésus, Eglise catholique | Lien permanent | Commentaires (0)
16/11/2014
La Commune de Paris (Revue Etudes - Juin 1971)
Le site Gallica de la BNF est décidemment une source incontournable. Nous y avons trouvé ce texte sur la Commune de Paris, datant de l'année du centenaire (1971) et qui a pour particularité d'être signé par le R. P. Joseph Lecler s.j., vice-postulateur de la cause de béatification des RR. PP. Olivaint, Ducoudray, Caubert, de Bengy et Clerc, de la Compagnie de Jésus, mis à mort pour la foi, sous la Commune, à la Roquette et à la rue Haxo, les 24 et 26 mai 1871.
D'autre part, le recul des années permet un récit circonstancié, d'un point de vue particulier que l'auteur justifie lui-même: "Peut-être certains lecteurs s’étonneront-ils de ce que nous paraissions passer par trop rapidement sur le réservé aux prisonniers civils et militaires. Ce n’est pas par « cléricalisme », mais par souci d’honnêteté : ayant été chargé d’enquêter sur ce qu’il advint des membre du clergé, nous nous sommes bornés à faire état de cela seulement que nous connaissons". Ceci dit, l'auteur revient, en fin d'article, sur la répression Versaillaise sévère et - il faut le dire - parfois excessive, sinon injustifiée.
Enfin, l'intérêt de cet article réside aussi dans l'importance des sources citées - dans lesquelles nous iront, à notre tour, puiser prochainement.
oOo
La Commune de Paris
par le R.P. Joseph Lecler.
LES ORIGINES, LES OTAGES, LA REPRESSION
Après un siècle, il ne manque pas d’historiens pour évoquer encore, sur le mode épique ou lyrique, les destinées de la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871). Pour Henri Lefebvre, se référant aux vues de Karl Marx, elle « fut d’abord une immense, une grandiose fête, une fête que le peuple de Paris, essence et symbole du peuple français, et du peuple en général, s’offrit à lui-même et offrit au monde » [1]. Paris libre 1871 de Jacques Rougerie (Seuil, 1971), dont on ne saurait trop louer l’intérêt documentaire, est une évocation de Paris « volcan de la France, peut-être du monde au xixe siècle » (p. 7). L’auteur voit dans la vie des clubs de la Commune « une gigantesque libération de la parole » (p. 208). Il n’a qu’un regret, comme il le déclare dans un autre ouvrage, c’est que les « ténors » de cette libération – à l’exception de Louise Michel et de quelques autres – n’aient guère soutenu leur rôle dans la suite, lors du procès des membres de la Commune[2]. Ces deux exemples ne font qu’illustrer un fait évident dans le climat général de notre époque : le souvenir de la Commune de 1871 est demeuré très vivant dans la mémoire des Français et surtout dans l’esprit des Parisiens. La Révolution de 1789 s’éloigne classée définitivement « bourgeoise », elle est rentrée dans l’histoire, où elle continue d’ailleurs de susciter d’excellents travaux. La Commune, beaucoup plus que la Révolution de 1848, s’inscrit déjà dans les problèmes sociaux de notre temps, quelles que soient les discussions sur sa vraie nature : blanquiste, socialiste, proudhonienne ou libertaire. C’est à ce titre qu’elle éveille encore tant d’échos, dans la classe ouvrière bien sûr. mais aussi dans tous les milieux politiques influencés par les diverses idéologies marxistes, socialistes ou gauchistes. Il faut constater d’ailleurs que maintes formes de violences, qui prolifèrent dans le monde actuel, figurent déjà dans sa brève existence : La Commune a eu ses « otages » ; elle a succombé sous la « répression » versaillaise ; ses extrémistes ont mis en œuvre tout ce que certains appellent à l’heure actuelle, les violences « gauchistes ». Ajoutons qu’elle a eu son journal : le Cri du Peuple, dont le titre même fait déjà penser à l’actuelle Cause du peuple.
Cette année du centenaire verra se multiplier les publications sur la Commune et les divers aspects de son histoire. Nous n’entreprendrons pas, dans ce bref article, d’esquisser une vue d’ensemble qu’on trouverait aussi bien dans un bon manuel. Pour parler de ce que nous savons, nous retiendrons principalement l’affaire des Otages, qui semble revivre pour nous, à de multiples exemplaires, dans les tristes réalités du présent. C’est sur la base des enquêtes précises auxquelles nous nous sommes livrés, et des témoignages recueillis, que t nous voudrions retracer l’histoire de l’arrestation des otages, des drames de la Roquette et de la rue Haxo[3].
Pour replacer ces faits dans l’histoire générale, nous aurons à rappeler brièvement comment est née la Commune et comment elle a péri, dans un déluge de représailles hors de proportion avec ses propres excès.
LES ORIGINES DE LA COMMUNE
Le mythe de la Commune se rattache à la commune parisienne de l’An II et aussi, pour une part. à la naissance et à l’histoire souvent tumultueuse des communes médiévales. On le voit revivre, à Paris, dans la situation révolutionnaire créée par la chute de l’Empire (4 septembre 1870) et par la proclamation d’un gouvernement de Défense nationale[4]. Les causes en sont diverses : les misères du siège, l’échec des opérations militaires et des sorties en masse, l’action continue des groupes révolutionnaires, l’incapacité du Gouvernement de l’Hôtel de Ville que la population patriote accuse de défaitisme. Après divers manifestes, c’est le 4 janvier 1871 que fut affichée, au nom des « délégués des vingt arrondissements de Paris », une première proclamation de la Commune[5]. Elle resta sans effet. Le lendemain commençait le bombardement de Paris. Pour calmer la fièvre. Trochu lançait, le 19 janvier, une ultime tentative contre l’armée assiégeante 50 000 gardes nationaux furent engagés à Buzenval. C’est l’échec de cette dernière sortie qui amena, le 28 janvier, la signature de la convention d’armistice entre Jules Favre et Bismarck.
Les élections générales prévues par cette convention eurent lieu le 8 février. Il en sortit une Assemblée royaliste aux deux-tiers : 400 monarchistes contre 200 républicains. Celle-ci, réunie à Bordeaux, constitua Thiers chef du pouvoir exécutif. Dans le domaine de la politique extérieure, les négociations furent rapides et bien menées. Le 26 février eut lieu la signature des préliminaires de paix : cession de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, indemnité de guerre de 5 milliards, occupation de Paris par les Allemands jusqu’à la ratification des conventions précédentes.
En fait, l’occupation de Paris, restreinte aux Champs-Élysées, ne dura que trois jours, du 1er au 3 mars. Pourtant, c’est cette brève occupation, jointe à d’autres causes d’ordre intérieur, qui va amener la rupture entre la Capitale et le Gouvernement de la France. Bien que justifiée politiquement, pour éviter la cession de Belfort, elle fut regardée comme une insupportable humiliation et exploitée de toute manière par les partis révolutionnaires.
Une autre cause de rupture fut la méfiance qui s’établit aussitôt entre l’Assemblée nationale, à majorité conservatrice – l’Assemblée des ruraux, comme on l’appelait –, et la Capitale, travaillée depuis des mois par le mythe de la Commune. A la méfiance du Paris révolutionnaire succéda l’hostilité, lorsque furent connues, dans le courant de mars, les graves décisions du Gouvernement : exigibilité immédiate des effets de commerce et des loyers, suppression des trente sous par jour alloués aux gardes nationaux, pacte de Bordeaux – maintien provisoire de la République –, transfert de l’Assemblée nationale, de Bordeaux à Versailles, et non à Paris.
Le 15 mars, Thiers arrivait à Paris. Il tenait en suspicion la Garde nationale, qui s’était fédérée sous la direction d’un Comité central. Contre l’avis de Vinoy, gouverneur de la Capitale, il décida de lui reprendre les 200 canons qu’elle avait entreposés à la Butte Montmartre et à Belleville. Deux manifestes, l’un du général d’Aurelle de Paladines, chef officiel de la Garde nationale, l’autre de Thiers, affichés dans la nuit du 17 au 18 mars, annonçaient l’opération[6]. Les Parisiens y étaient mis en garde contre des « hommes mal intentionnés » qui, méconnaissant l’autorité de leur chef, se sont constitués en « comité occulte » (le Comité central) et organisent le désordre dans la ville. Le 18 mars, au petit matin, les troupes arrivaient, sous les ordres du général Lecompte, pour récupérer les canons. Faute d’attelages suffi- sants, l’opération traîna en longueur. C’est à la faveur de ce temps perdu qu’accoururent des gardes nationaux et toute une populace. Le général Lecompte fut arrêté par des meneurs et conduit 6 rue des Rosiers[7], où siégeait un comité de fédérés. Peu après, on y amenait le général Clément Thomas, reconnu place Pigalle, et très impopulaire. L’un et l’autre furent fusillés par les fédérés après une parodie de jugement.
La réponse de Thiers fut l’abandon de Paris par le Gouvernement et par les troupes régulières. Il s’est félicité plus tard de cette décision, lors de l’enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars. Déposant comme témoin, il l’a présentée comme un plan stratégique astucieux, celui qu’il il aurait conseillé à Louis-Philippe, le 28 février 1848 : abandonner froidement la Capitale à l’insurrection, pour revenir en forces et écraser les révoltés avec des troupes sûres[8]. En réalité, il semble bien qu’il ait été pris de panique[9] en voyant la Garde nationale menaçante et les troupes régulières en voie de débandade. Il gagna lui-même Versailles en toute hâte.
Pas plus qu’il n’y a eu de plan stratégique du côté du Gouvernement, il n’y a eu de complot méthodiquement élaboré chez les « vainqueurs du 18 mars ». Comme l’écrit Édith Thomas, « nulle organisation n’a préparé [cette « victoire »], ni le Comité central de la Garde nationale, ni le Comité des vingt arrondissements, ni l’Internationale »[10]. Dans le vide du pouvoir, des hommes issus des différents mouvements révolutionnaires ont dû passer à l’action. Le 19 mars, le Comité central de la Garde nationale s’installa à l’Hôtel de Ville. Il agit en gouvernement provisoire, sans d’ailleurs en prendre le titre. Par son ordre, les élections eurent lieu le 26 mars. Il y eut 229 000 votants sur 485 000 inscrits. L’assemblée élue se composait de 90 membres. On comptait une quinzaine de modérés : maires et adjoints de Paris, mais ils donneront rapidement leur démission. Les 75 autres formaient une coalition hétéroclite des blanquistes, comme Rigault, Ferré, Ranvier ; des jacobins, comme Delescluze ; des radicaux, comme Vallès et Vermorel ; des internationalistes, comme Frankel (ami personnel de Karl Marx) et Varlin[11]. Ainsi fut constituée, le 28 mars, la Commune de Paris. Le lendemain, elle formait les dix commissions ou ministères qui devaient constituer son gouvernement. L’esprit dans lequel elle va engager sa révolution communaliste trouvera sa charte dans la proclamation du 19 avril. Les délégués du peuple déclaraient leur volonté de consolider la République, non plus comme un gouvernement despotique et centralisé, mais comme la fédération de toutes les communes de France. Suivait la liste des droits inhérents à la Commune : elle consacrait l’intervention permanente et libre des citoyens dans toutes les affaires communales. L’unité politique de la France sera « l’association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles, en vue d’un bien commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous ». Une telle révolution sera « la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, des monopoles, des privilèges, auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie ses malheurs et ses désastres »[12].
On sait que, dès le mois de mars, plusieurs villes de France essayèrent d’imiter Paris et de réaliser à leur tour une « commune »[13]. Ces soulèvements furent rapidement étouffés par le Gouvernement de Versailles. La Commune de Paris resta seule en face de son programme.
Nous ne décrirons pas ici comment furent réorganisés les services publics par le Gouvernement révolutionnaire. On recula devant certaines mesures extrêmes, comme la nationalisation de la Banque de France. Mais l’enseignement fut laïcisé et, dans le temps très court que dura le régime (moins de deux mois), ses dirigeants s’efforcèrent de réorganiser le travail dans un sens ouvertement favorable aux intérêts du monde ouvrier[14]. De l’aveu général, néanmoins, la Commune se ressentit cruellement de la rivalité des partis au pouvoir et de la prolifération des comités révolutionnaires. Pour ses affaires intérieures, comme pour la conduite de la guerre, ce fut pour elle un danger fatal que d’osciller sans cesse entre la dictature jacobine ou blanquiste et l’anarchie libertaire[15].
LA POLITIQUE RELIGIEUSE, LES ARRESTATIONS D’OTAGES
Dans le domaine de la politique religieuse, la Commune de Paris, si brève qu’elle ait été, est restée de sombre mémoire dans l’esprit des croyants. Qu’elle ait été anticléricale, nul ne le conteste et l’on en perçoit bien quelques raisons. Le ralliement du clergé au coup d’État du 2 décembre, par peur du socialisme, l’avait dangereusement inféodé au régime déchu. Après la chute de l’Empire, les sympathies des évêques allaient à coup sûr du côté de la monarchie et non de la République[16]. Mais s’agit-il seulement d’anticléricalisme ? Demandons-le à un historien qualifié et qui ne cache pas ses sympathies pour le régime : « Cherchons, écrit J. Rougerie[17], contre qui se définit le communeux. On l’a partout constaté, son premier, son pire ennemi, c’est le prêtre, le marchand de religion ». L’insurgé de 1871 est un déchristianisateur. » Le même auteur remarque que des prêtres ont été les premiers otages, et tout le premier Mgr Darboy, archevêque de Paris : « Il n’est pas de club, pas de jour, où l’on ne réclame leur tête, dans les 48, dans les 24 heures, immédiatement. » L’un des signes les plus clairs de cette haine anti-religieuse, de cet athéisme militant, c’est la profanation des églises. Les clubs n’en font pas seulement des lieux de réunion. Il leur arrive de les souiller bassement par des spectacles et des parodies sacrilèges. Des affiches ou des rapports faisaient état de découvertes macabres dans les caveaux de certaines églises, entre autres dans l’Église Saint-Laurent, en face de la prison Saint-Lazare : il s’agissait, disait-on, de cadavres de jeunes filles, victimes du sadisme des membres du clergé. Voilà, remarque le même auteur, « jusqu’où pouvait aller la passion déchristianisatrice » ! Gaston da Costa, l’auteur de la Commune vécue, reconnaît lui-même qu’on avait exploité, en l’occurrence, la crédulité des imbéciles. La Révolution française avait mis quatre ans pour arriver à ce paroxysme de fureur anti-religieuse : la Commune l’atteint d’emblée, dès les premiers jours, tant l’idéologie de ses promoteurs était marquée par l’athéisme militant. C’est que le climat social avait beaucoup changé depuis 1848. « Les républicains de 1848, écrit Georges Weill[18], croyaient tous en Dieu : Raspail et Barbès invoquaient Jésus-Christ. Les socialismes de la première moitié du xixe siècle étaient encore empreints de religiosité. Il n’en va plus de même au temps du second Empire. L’athéisme mis en vogue par la critique philosophique de la religion (Feuerbach) n’est pas seulement à la base du marxisme, il imprègne profondément le blanquisme, l’idéologie de l’Internationale (fondée en 1864) et les groupes libertaires. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre l’Église et le cléricalisme, mais d’extirper le christianisme et la religion elle-même en tant qu’obstacles à la libération des peuples. Comme on le voit par de nombreux témoignages, c’est ce visage nouveau du « socialisme » qui a étonné et horrifié les croyants.
Dès le 2 avril 1871, le Journal officiel publiait les décrets sur la Séparation de l’Église et de l’État, la suppression du budget des cultes, la nationalisation des biens meubles et immeubles appartenant aux congrégations religieuses[19]. Quant à l’idée de constituer un groupe d’otages, il prit corps au début d’avril, lorsque l’armée versaillaise eut fusillé deux chefs militaires de la Commune, Flourens et Duval, après la prise du rond-point de Courbevoie. Jusque-là. Rigault, le préfet de police, de sinistre renom, avait déjà multiplié les arrestations arbitraires. C’est lui qui avait envoyé au Dépôt, dès le 21 mars. le président Bonjean, président de la Chambre des requêtes à la Cour de Cassation. Le décret sur les otages parut le 6 avril[20] :
Art. 1 – Toute personne prévenue de complicité avec Versailles sera immédiatement décrétée d’accusation et incarcérée.
Art. 4 – Tous accusés retenus par le verdict du jury d’accusation [art. 2 et 3] seront les otages du peuple de Paris.
Art. 5 – Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan de la Commune sera, sur le champ, suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus.
A cette date, le Dépôt de la Préfecture de police était déjà largement pourvu de prisonniers laïques (magistrats, fonctionnaires, gardes de Paris) et ecclésiastiques[21]. Parmi ces derniers se trouvaient plusieurs jésuites de la célèbre École de la rue des Postes, arrêtés au cours d’une perquisition, dans la nuit du 3 au 4 avril, notamment le Recteur, le Père Ducoudray, le Père Clerc, ancien officier de marine, et le Père de Bengy, aumônier militaire pendant la guerre. Dans la journée du 4 furent arrêtés : Mgr Darboy, archevêque de Paris, l’abbé Legendre, le chanoine Petit, le Père Olivaint, supérieur des jésuites de la rue de Sèvres, et son confrère le Père Caubert. Mgr Surat, archidiacre de Notre-Dame, arrêté le 5 avril, a laissé dans sa cellule le récit de sa comparution devant Rigault. Comme il demandait le motif de son arrestation, le préfet de police répondit :
« Les chouans de M. de Charette et les Vendéens de M. de Cathelineau tirent sur nos frères, il nous faut des otages et tout prêtre qui sera rencontré dans Paris nous en servira. » Mgr Surat essaya de discuter. Rigault lui répondit :
« Oh ! ne prenez pas votre ton paternel. Nous .sommes las de votre jésuitisme ; nous n’en voulons plus. Vous avez pour la première fois le bonheur d’avoir un gouvernement athée et nous ferons voir que nous ne reconnaissons d’autre Dieu que… »
— « Je n’ai pas compris ce qui m’était dit, ajoute l’accusé, tant le ton avec lequel on me parlait était exaspéré. » — « Voilà, ajouta Rigault, 1800 ans que cela dure, il faut que ça finisse. »[22]
Ce même jour furent arrêtés l’abbé Moléon, curé de Saint-Séverin, M. Deguerry, curé de la Madeleine, et le Père Allard, aumônier des ambulances.
A partir du 6 avril, date du décret sur les otages, les arrestations se succédèrent. Ce jour-là, trois prêtres de Saint-Sulpice, dont M. Icard ; trois séminaristes, dont M. Seigneret ; le Père Planchat, des Frères de Saint-Vincent-de-Paul, directeur du patronage Sainte-Anne, rue du Bois[23]. Le 7, le curé de Saint-Pierre de Montmartre et ses vicaires : les Pères de Picpus, dont quatre seront exécutés rue Haxo (Radigue, Tuffier, Rouchouze, Tardieu). Le 9, M. Bayle, vicaire général, et l’abbé Lartigue, curé de Saint-Leu. Le 11, l’abbé Sabatier, vicaire de Notre-Dame de Lorette, qui sera fusillé rue Haxo. Le 13 et le 20, l’abbé Bécourt, curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et le Père Houillon, qui tomberont le 27 mai devant la prison de la Roquette.
Une arrestation massive eut lieu le 19 avril : celle du Père Captier et des Pères dominicains de l’École Albert le Grand à Arcueil, avec leurs familiers, en tout 26 personnes. Ils avaient pourtant converti leur École en ambulance et prodigué leurs soins aux blessés.
A ces otages religieux s’adjoignirent de nombreux otages civils et militaires, répartis dans les diverses prisons de Paris[24].
LES EXÉCUTIONS DE LA ROQUETTE (24 mai 1871)
Selon le décret du 6 avril. trois otages devaient être mis à mort pour chaque exécution d’un prisonnier communard. En fait, c’est seulement à l’extrême fin de la Commune que commencèrent les massacres. Le 23 mai au soir, son Gouvernement ne détenait plus que les régions de Paris situées à l’est d’une courbe allant de la Porte de la Chapelle à la place de la Concorde et de là au parc actuel de Montsouris. Du 24 au 27 mai, tandis que se resserrait l’étreinte des troupes versaillaises, quatre grands épisodes marquèrent l’exécution de 73 otages. Le 24 mai, six d’entre eux tombèrent à la prison de la Roquette. Le 25 mai, au 38 de l’avenue d’Italie, à quelques centaines de mètres des troupes versaillaises, furent massacrés, au sortir de la prison du secteur, le Père Captier, dominicain, quatre de ses confrères et 8 membres du personnel de leur École[25]. La journée du 26 mai vit d’abord une exécution isolée, celle du banquier Jecker, d’origine suisse, qui avait fait de trop bonnes affaires lors de la campagne du Mexique[26]. Puis, dans la soirée, au 85 de la rue Haxo, fut consommée l’affreuse tuerie où périrent 49 otages amenés de la Roquette. Le 27 mai enfin, avant-dernier jour de la Commune, tandis que les détenus de la Roquette se libéraient eux-mêmes, les fédérés fusillaient un otage civil et trois prêtres (Mgr Surat, le Père Houillon et l’abbé Bécourt)[27].
De ces quatre épisodes, nous en retiendrons deux sur lesquels s’est portée spécialement notre enquête la grande Roquette (24 mai) et la rue Haxo (26 mai). Il nous faut ainsi revenir au point de départ le Dépôt de la Préfecture de police et la Conciergerie, où Rigault entassait tout d’abord ses prisonniers. Pour faire de la place, dans le courant d’avril, il expédia des civils et la plupart des prêtres à Mazas, maison d’arrêt pour prévenus[28].
Le 22 mai, comme la situation devenait grave, Rigault et Ferré firent adopter par le Comité de salut public – créé au début de mai – l’ordre suivant, adressé à la Sûreté générale :
Ordre de transférer immédiatement à La Roquette, dépôt des condamnés, les otages tels que l’Archevêque, tous les curés, Bonjean sénateur, les mouchards et sergents de ville, enfin tous ceux qui pourraient avoir quelque importance.
Un autre mandat chargeait Rigault de l’exécution des décrets relatifs aux otages. Ce jour-là 37 otages furent transférés à la Roquette : Mgr Darboy, 29 prêtres et 7 civils, dont le président Bonjean. Nouvelle fournée le lendemain 8 prêtres et 7 civils[29].
La grande Roquette, où furent menés les otages a disparu. Elle a été démolie en 1900. Elle était située en face de la petite Roquette, la prison des jeunes détenues qui subsiste encore, rue de la Roquette, entre la place Voltaire et le Père-Lachaise. Contrairement au régime de Mazas, les otages purent se retrouver en des récréations communes. Des survivants, tels le Père Yves Bazin, l’abbé Gard, M. Bayle, vicaire général de Paris, M. Petit, chancelier de l’archevêché, nous ont apporté d’émouvants témoignages sur ces rencontres fraternelles entre Mgr Darboy, les prêtres séculiers, les religieux et les laïques. L’Archevêque était très entouré ; on se plaisait à remarquer que le Prélat, qui n’aimait pas beaucoup les jésuites, s’entretenait longuement avec le Père Olivaint. Le président Bonjean, gallican bon teint, était en excellents termes avec les religieux et faisait au Père Clerc, jésuite, sa dernière confession[30].
Le 24 mai, l’armée versaillaise resserrait son étreinte. L’Hôtel de Ville en flammes était évacué par la Commune. Montmartre était tourné. Au sud, les troupes régulières arrivaient au Panthéon. Rigault, qui cherchait à regagner sa demeure, rue Gay-Lussac, était reconnu et fusillé sur place. Le chef responsable était à ce moment Théophile Ferré, du Comité de salut public, assisté de Delescluze, Genton et Fortin[31]. Vers la fin de l’après-midi, à la mairie du XIe, place Voltaire, où ils siégeaient, une délégation de fédérés se présente en criant : « Les otages ! le décret sur les otages ! » Ferré cède et rédige un ordre d’exécution pour six otages, sans les désigner autrement. La Roquette est tout près. Genton et Fortin racolent un peloton, une quarantaine de volontaires, puis ils vont se présenter à François, directeur de la Roquette. L’ordre ne contenant pas de noms, le directeur désigne, semble-t-il, les premiers inscrits sur la liste qu’il avait reçue de Mazas : le président Bonjean, le Père Allard, aumônier des ambulances, le Père Clerc, jésuite, l’abbé Deguerry, curé de la Madeleine, le Père Ducoudray, jésuite, et un autre dont on n’a jamais su le nom. François n’avait pas écrit le nom de Mgr Darboy, sans doute à dessein. Mais les hommes du peloton ne l’entendaient pas ainsi : « Il nous faut l’Archevêque ! », s’écrièrent-ils. Une violente discussion s’ensuivit. Pour couper court, Genton et Fortin retournèrent auprès de Ferré, qui ajouta : « Et notamment l’Archevêque ». C’est ainsi que Mgr Darboy fut substitué à l’inconnu désigné d’abord comme sixième otage.
Il était à peu près 7 heures du soir, le 24 mai, lorsqu’on vint chercher les otages désignés pour l’exécution. Quand ils furent rassemblés, on les conduisit dans le second chemin de ronde, le plus loin possible des regards indiscrets. Les seuls témoins, en dehors du peloton, furent Fortin, Sicard, Genton et François. C’est Sicard qui, muni d’un sabre, commanda le feu. Tout se passa dans le plus grand silence et dans une grande dignité de la part des victimes. Il paraît certain que l’Archevêque a dit à Fortin : « Et cependant j’ai écrit à Versailles (selon Vuillaume), ou bien : « Et cependant j’ai écrit à Thiers » (selon da Costa)[32]. Ce dernier ajoute une réponse de Fortin : « Nous le savons bien, c’est sa faute si vous êtes là. » Selon Vuillaume, au contraire, il n’y a eu aucune réponse. Sur la mort de l’Archevêque, nos deux historiens sont d’accord. Après la salve, les otages tombèrent excepté l’Archevêque. « Mais il est blindé celui-là ! », s’écria Lolive et, rechargeant son chassepot, il visa de nouveau l’Archevêque qui, portant la main à sa poitrine, s’affaissa.
De retour à la mairie du XIe, Genton et Fortin annoncèrent à leurs collègues qu’ils venaient de fusiller l’Archevêque. On notera la réponse de Vermorel, que nous a transmise Vuillaume : « Vous avez fait là une jolie besogne. Nous n’avions peut-être qu’une dernière chance d’arrêter l’effusion du sang. Vous venez de nous l’enlever. Maintenant, c’est fini »[33].
Sur les derniers instants des otages, les meilleures sources sont celles de Maxime Vuillaume et de Gaston da Costa, deux historiens communards, qui ont interrogé l’un et l’autre Fortin, témoin oculaire[34]. Il existe cependant une légende, qui ferait d’un certain « père Louis », volontaire du peloton d’exécution, un témoin à part et valable. Elle a été accréditée par un journaliste du Figaro, Charles Chincholle, qui l’a reproduite dans son livre : les Survivants de la Commune (Paris, 1885, pp. 77-78), et, à sa suite, par le comte d’Hérisson, dans son Nouveau Journal d’un officier d’ordonnance (Paris, 1889, pp. 250-252). Au début de notre siècle Gaston da Costa s’en est inquiété, lorsqu’il préparait son ouvrage : la Commune vécue (Paris. 1903).
Il écrivit à Fortin, son ami. Il en reçut une réponse très claire : le « père Louis », c’est Fortin lui-même, que Chincholle avait interrogé à son retour du bagne, vers la fin de 1881. Pour diverses raisons, le journaliste avait attribué à ce « père Louis », personnage imaginaire, les propos de Fortin sur l’attitude des otages dans les moments qui précédèrent leur exécution[35]. Mais la légende est tenace elle a encore été reprise en 1928, dans l’Histoire de la Commune de Georges Laronze. Tout se ramène donc au témoignage de Fortin, tel qu’il a été recueilli par Vuillaume et da Costa, avec quelques légères divergences, notamment sur l’heure (6 heures 1/2 ou 7 heures 1/2)[36].
LE MASSACRE DE LA RUE HAXO (26 mai 1871)
Deux jours plus tard, le 26 mai, l’exécution des otages de la rue Haxo ne fut même pas l’objet d’une décision du Comité central. La Commune se désorganise. Vers trois heures de l’après-midi le colonel Gois, l’un des plus violents parmi les fédérés, président de la cour martiale, prit sur lui de continuer les exécutions d’otages[37]. Il recrute un peloton de tireurs et, ainsi accompagné, il se présente à François, le directeur de la Roquette : « Il m’en faut cinquante », déclare-t-il. « Tu as un ordre ? », répond François. Pour toute réponse, Gois tire son revolver : « Et d’abord les curés ! » Sur la liste il en choisit dix : trois jésuites (Olivaint, Caubert, de Bengy), quatre pères de Picpus (Radigue, Tuffier, Rouchouze, Tardieu), un frère de Saint-Vincent de Paul (Planchat), un prêtre séculier (l’abbé Sabatier), un séminariste (l’abbé Se’igneret). Après les avoir inscrits, il fit insérer les noms de 35 gardes de Paris et de quatre agents secrets de l’Empire. En tout 49 otages.
Lorsque ceux-ci furent rassemblés, Gois et ses acolytes se concertèrent. Quelques-uns voulaient les tuer sur place. Gois fut d’avis de les mener sur les hauteurs de Belleville. C’est une marche au calvaire de plus de trois kilomètres qui leur fut imposée, par le boulevard de Ménilmontant, la rue de Ménilmontant, la rue de Puebla, la rue des Rigolles, la rue de Paris[38]. Sur tout le trajet, une foule haineuse et déchaînée insultait les prisonniers. Il y eut une halte à la mairie de Belleville, qui était alors en face de l’église SaintJean-Baptiste. Elle donnait refuge, dit l’abbé Raymond, deuxième vicaire à l’église, à tout ce qui restait des dirigeants de la Commune. Mais Ranvier, le maire de Belleville, n’avait aucune envie de voir le massacre s’accomplir sur son domaine. Il renvoya les otages au deuxième secteur, qui se trouvait au 85 de la rue Haxo. On se remit en route en suivant la rue de Paris. D’après le récit de cet excellent témoin[39], une cantinière à cheval ouvrait la marche ; un officier à cheval lui servait de cavalier. Des clairons et tambours jouaient une marche de chasseurs. Derrière un peloton de gardes nationaux, les 35 gardes de Paris, puis les prêtres et les quatre agents de l’Empire. Un grand prêtre âgé marchait à grand-peine on y a reconnu le Père Tuffier, de Picpus. Un autre peloton de gardes nationaux fermait la marche, suivi d’une foule imposante qui demandait à grands cris la mort des condamnés.
Vers six heures du soir, les 49 otages et leur escorte arrivaient 85 rue Haxo, centre du deuxième secteur. Au fond d’une ruelle, dans une maison à un seul étage, surmontée d’un clocheton – elle a été démolie récemment – se trouvaient encore quelques membres de la Commune : Varlin, Cournet, Fortuné, Alavoine, Vallès. Dans le prolongement de la maison, sur la gauche, le mur contre lequel seront fusillés les otages. Le lieu même du massacre formait avec le grand mur un rectangle enclos par un petit mur bas. Il y avait en son milieu une fosse dans laquelle seront jetées les victimes, après le massacre. En avant, se trouvait un assez grand jardin, dans lequel rentrera la foule[40]. Contrairement aux exécutions de la Roquette, le massacre de la rue Haxo a eu de nombreux témoins. Ils se trouvaient dans le jardin, mais on pouvait tout voir du côté de la rue du Borrégo, qui avait des ouvertures sur le terrain. Après la Commune, les gens du quartier seront muets devant les Conseils de guerre, lorsqu’on cherchera des témoignages. La présence d’enfants, qui est bien attestée par ailleurs, montre que le carnage n’a pas manqué de spectateurs.
L’entrée au secteur fut déjà l’occasion de scènes de violences. Adossé à la grille, un homme de taille herculéenne se tenait là, injuriant et frappant comme une brute les otages. Tous les témoignages concordent sur ce point, y compris celui de Vuillaume, Quand les otages arrivèrent devant le siège du secteur, la foule les suivit, lançant des cris de mort. Loin de pousser au massacre, Varlin et ses collègues ont tenté de s’y opposer. Peine perdue. Ils auraient risqué eux-mêmes de se faire descendre. Ce sont les conducteurs du cortège, assistés d’hommes armés et de femmes, qui se sont chargés de la tuerie, car il n’y a pas d’autre mot pour désigner ce massacre des 49 otages.
Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici la relation de Vuillaume. Avant d’être insérée dans son ouvrage : Mes cahiers rouges sous la Commune, elle avait paru dans les Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy. Elle a été recueillie de la bouche même d’un des exécutants[41] :
Je sus plus comment s’était consommé le massacre. L’un des acteurs du drame, l’un de ceux qui conduisaient le cortège, me détailla, devant le mur même, la scène sanglante.
Debout à gauche, sur un petit mur, à quelques mètres de la haute muraille du fond, le capitaine Dalivous, sabre au clair, interpelle la foule.
Les fusils sont déjà abaissés.
« Attendez ! crie Dalivous. Ne tirez pas encore ! Attendez mon commandement. »
A droite du mur, dans le passage qui relie le jardin à la cour du secteur, on voit à travers les branches, les pantalons des gardes de Paris et les soutanes des prêtres.
Les militaires sont à quelques pas.
Ils sont dix.
C… l’un de ceux qui ont dirigé le cortège, est là. Il montre du doigt le mur.
Sans prononcer une seule parole, les gardes s’avancent, se placent face à la foule, en ligne.
« Face au mur ! » crie Gois.
« Jamais ! » crie un maréchal des logis.
Mais la foule a déjà trop attendu. Les fusils sont mis en joue. Cent coups de feu partent ensemble. Les dix prisonniers s’affaissent.
A peine sont-ils tombés, que dix autres, appelés, poussés, se présentent.
On tire de tous les coins du jardin, au hasard, sans aucun commandement.
La fusillade est si désordonnée que les tireurs sont eux-mêmes blessés. Près de G... un homme a l’oreille entamée, un autre le pouce emporté.
Un orage, blessé seulement, se relève. Une fusillade l’abat.
« On les tirait comme des lapins ! » me disait, en face du mur, en me désignant le coin sinistre d’où défilaient les otages, l’un des exécuteurs.
Les prêtres tombèrent après les militaires.
Les quarre civils furent tués les derniers.
Quand tout fut fini, quand le tas ne remua plus, les Enfants perdus, qui s’étaient placés au premier rang, remirent leurs fusils en bandoulière et quittèrent le jardin.
La besogne était terminée.
La foule redescendit vers la mairie, silencieuse, comme poursuivie déjà par le remords ou la responsabilité de l’effroyable hécatombe.
J’étais resté l’un des derniers, me dit l’ami qui m’accompagnait, toujours debout sur le petit mur, tout près de Dalivous. J’étais comme cloué sur place. Tout d’un coup, je sautai à bas et ne m’arrêtai que dans la rue... Je jetai un coup d’ail sur mon uniforme. Il était plein de sang, avec des éclats de cervelle.
Je regardai l’ancien combattant.
Vous n’y pensez pas parfois ? lui dis-je.
Pourquoi !... ce n’est pas un crime… un acte de justice révolutionnaire, comme à l’Abbaye…
Après le massacre, quand la foule eut vidé les lieux, les cadavres furent jetés pêle-mêle dans la fosse sur le terrain où ils avaient succombé[42]. Prêtres, religieux, gardes de Paris, agents de l’Empire, ils ne sont pas tous tombés pour la même cause. Mais leur union dans la mort ne condamne-t-elle pas cette forme de violence, qui a existé depuis les temps les plus anciens et qui semble renaître plus dangereusement que jamais en notre siècle : l’inhumaine politique des otages. Les communards d’ailleurs ont bien senti eux-mêmes quel danger présentait pour leur cause le décret du 6 avril. Vermorel l’a reconnu, après les exécutions de la Roquette, comme nous l’avons vu. Varlin d’abord, et aussi ses collègues, l’ont constaté d’une autre manière, lorsqu’ils ont cherché, mais en vain, face à une foule en délire, à esquiver l’application du décret.
LA RÉPRESSION VERSAILLAISE
On peut réprouver, à juste titre, les graves excès de la Commune : sa politique de déchristianisation, ses arrestations arbitraires qui ont fait régner dans la capitale un climat de terreur, ses exécutions d’otages, ses incendies que l’historien communard Lissagaray revendique expressément pour la cause. Et pourtant de tels excès n’excusent en aucune façon la répression cruelle et sans mesure qui s’est abattue sur ses défenseurs. Les chiffres de la répression parlent d’eux-mêmes, car ils sont sans proportion avec les attentats commis par les communards. Du côté de ces derniers, on atteint une centaine de meurtres, si l’on adjoint aux exécutions d’otages les règlements de comptes individuels. Mais c’est par milliers qu’ont été exécutés sur place, au fur et à mesure de l’avance versaillaise, non seulement des fédérés en armes, mais des gens, hommes et femmes, soupçonnés, sur de vagues indices, d’avoir pris part au combat.
Mac Mahon, chef des opérations, avoue 17 000 morts du fait des combats. M. Rougerie assure qu’on pourrait facilement doubler ce chiffre. M. Laronze, suivi par M. Fabre[43], parle de 20 000 morts, dont 16 000 pendant la bataille des rues, et 3 500 exécutés après la reprise de Paris. Dans l’état actuel de la documentation, on n’arrivera jamais à des chiffres précis. Il reste que ce bilan approximatif est par lui-même effroyable. Il y a eu de véritables hécatombes, dans le quartier de la Roquette et du Père-Lachaise, lors des derniers combats. Quant aux cours martiales, elles ont fonctionné en divers endroits de Paris : au Luxembourg, à l’Ecole Militaire, au Panthéon, à Mazas, à la Roquette, aux Buttes-Chaumont... Maxime Vuillaume, qui les a vues à l’œuvre, nous en donne l’impressionnant tableau.
Après ces massacres et ces exécutions sommaires, 24 conseils de guerre ont fonctionné pendant quatre ans : 43 522 personnes, ouvriers pour près de la moitié ont été arrêtées. Sur les 36 309 qui ont été jugées en fait, 23 727 ont bénéficié d’un non-lieu, 2 445 ont été acquittées et 10 137 ont été condamnées à des peines diverses. En ne comptant que les plus lourdes peines, il y a eu 93 condamnations à mort (23 seulement ont été effectives), 251 condamnations aux travaux forcés, 4 586 condamnations à la déportation.
Si le nombre des peines capitales demeure restreint, le chiffre des déportés en Nouvelle-Calédonie a été considérable. Ces condamnations légales, succédant aux tueries des derniers jours de la Commune ont pu donner bonne conscience aux hommes de Versailles. N’avaient-ils pas rétabli l’ordre, face aux fauteurs du désordre le plus effrayant qu’ait connu la France depuis la grande Révolution ? On parlera alors du Gouvernement de l’« ordre moral ». En fait, on avait assuré la domination d’une classe et maintenu les privilèges dont elle avait été si largement pourvue sous l’Empire. Dans cette classe, quelques rares esprits ont entrevu alors qu’en combattant avec l’énergie du désespoir, les fédérés ne luttaient pas simplement par appétit de « subversion », comme le donnerait à entendre l’appellation d’« insurgé ». Citons seulement cet épisode bien connu, qui est à l’origine de la vocation sociale d’Albert de Mun. Un jour de mai 1871, le jeune officier de l’armée versaillaise accompagnait son général aux avant-postes de Courbevoie :
Comme nous croisions des soldats qui portaient un homme ensanglanté, le général s’arrêta et s’informa : « Mon général, c’est un insurgé », dirent les troupiers. Alors ce cadavre vivant, se soulevant sur sa civière, tendit vers nous son bras nu et, le regard fixe, d’une voix éteinte, prononça : « Les insurgés, c’est vous ! »
Le convoi s’éloigna, mais la vision nous resta présente. Entre ces révoltés et la société légale dont nous étions les défenseurs, un abîme nous apparut.
Qu’avait fait cette société légale, depuis tant d’années qu’elle incarnait l’ordre public, pour donner au peuple une règle morale, pour éveiller et former sa conscience, pour apaiser par un effort de justice la plainte de sa souffrance ? Quelle action chrétienne les classes en possession du pouvoir avaient-elles, par leurs exemples, par leurs institutions. exercée sur les classes laborieuses ? Ces questions se posaient avec force à nos esprits, dans le trouble des événements[44].
Sans doute Albert de Mun reste de son temps. Sa pensée sociale demeure marquée de paternalisme et de condescendance à l’égard des classes populaires. Il dépassait en tout cas cette « bonne conscience » de tant de bourgeois d’alors qui voyaient dans le châtiment « exemplaire » des coupables la seule garantie de l’ordre futur. Albert de Mun ne cacha pas d’ailleurs son sentiment à l’égard des conseils de guerre :
Il était inutilement cruel et souverainement inpolitique de prolonger en quelque sorte la guerre civile, en entassant dans les prisons une multitude de misérables plus inconscients que coupables[45].
Il soulignait ainsi – et la leçon vaut pour toutes les époques – le danger d’une répression qui se voulait totale et sans merci. Toute classe, tout parti au pouvoir risque de payer fort cher dans l’avenir ce qui apparaîtrait à ses adversaires comme une politique dictée par la vengeance.
Le souvenir de la Commune, nous l’avons dit, reste vivant dans la France du xxe siècle. On l’a évoqué à plusieurs reprises depuis les événements de 1968. N’a-t-on pas parlé, avec quelque raison, d’une « commune » étudiante ? Elle n’est pas née non plus d’un véritable complot, elle a eu quelque chose de spontané et elle s’est développée, un moment, en face d’un certain vide, d’une certaine défaillance du pouvoir. Expérience faite, tout n’était pas « subversion » pure dans ces manifestations tumultueuses. Il a bien fallu y reconnaître des aspirations valables et positives, vis-à-vis desquelles la répression brutale eût été la plus dangereuse des erreurs. Notre monde actuel connaît aussi d’autres « communes », qui ne sont pas tant le fait d’un parti politique déterminé que de formations spontanées, où s’expriment, de façon souvent violente et même sauvage, les aspirations vers une vie plus humaine de populations sujettes et misérables. On voudrait espérer que, dans les luttes politiques et sociales de notre temps, il y ait de moins en moins de place pour cette dialectique funeste des violences otages-répression, guérilla subversive-politique d’extermination.
Joseph LECLER
Ce texte est disponible sur Gallica : Identifiant : ark:/12148/cb34416001m/date
oOo
Complément à la note 36 :
VUILLAUME Maxime : Mes Cahiers rouges au temps de la Commune, Paul Ollendorf, 2e éd. s.d.
NOTE V
(Page 159. — Sur deux lanternes)
Da Costa, dans sa Commune Vécue (II, 8), an sujet des lanternes que tiennent, dans mon récit, deux hommes du cortège des otages, me reproche d’avoir voulu, par une « invention de journaliste, dramatiser mon tableau ».
Da Costa ajoute que mes deux lanternes eussent été bien inutiles, car il était à peine six heures et demie.
Je crois, moi, qu’il était, non six heures et demie, mais sept heures et demie.
Lorsque les exécuteurs, après la fusillade, s’éloignèrent du mur, huit heures sonnaient à l’horloge de la prison. Certainement le sinistre cortège ne mit pas plus d’une demi-heure à se rendre, par le chemin de ronde, du perron de l’escalier de secours par où étaient descendus les otages, au lieu de l’exécution.
L’heure de l’exécution est confirmée par plusieurs témoignages.
A l’audience du 8 août 1871 du troisième conseil de guerre (Procès des membres de la Commune), Trinquart, pharmacien de la prison, dépose : « J’ai entendu à huit heures un feu de peloton. »
Dans son livre, Un prêtre et la Commune de Paris en 1871, l’abbé G. Delmas, vicaire à Saint-Ambroise, ex-otage à la Roquette, écrit (page 202) : « Vers les huit heures, nous bondîmes sous la détonation d’un feu de peloton qui sortait du chemin de ronde. » Le même abbé, qui, ne l’oublions pas, était enfermé à la Roquette, parlant de l’arrivée du peloton d’exécution, écrit : « A sept heures du soir, agitation inaccoutumée, apparition d’un fédéré dans la cour. » De sept heures à sept heures et demie, les otages ont été appelés, ils sont descendus au chemin de ronde. A huit heures, ils sont exécutés.
Voilà donc, une fois pour toutes, les heures des diverses phases du drame bien fixées.
Mais eût-il été six heures et demie, comme le veut Da Costa, que mes lanternes ont encore leur explication.
En quittant leurs cellules, les otages durent descendre l’étroit escalier de la tourelle, l’escalier « de secours », complètement obscur, tout au moins fort mal éclairé par d’étroites meurtrières percées sur l’extérieur, qui conduisait au chemin de ronde. Comment l’eussent-ils descendu sans lumière !
A plusieurs reprises, avant d’écrire mon récit, j’ai visité la Roquette, la dernière fois avec Gustave Geffroy, j’ai suivi le chemin que suivirent les otages. Si Da Costa en a fait autant, s’il est comme moi descendu par la tourelle, il a dû, comme moi, s’aider d’une lumière quelconque, d’une lanterne.
Et puis, voici encore un témoin du troisième conseil de guerre, qui va venir à mon secours.
A l’audience du 9 août 1871, Vattier, détenu de droit commun à la prison, dépose : « Quelques instants après l’entrée du peloton à la prison, on m’a fait éclairer le corridor qui conduisait à l’escalier de secours. J’ai vu passer les otages, etc. »
Ce Vattier, qui éclairait le corridor sur lequel s’ouvraient les cellules, a certainement éclairé l’escalier, plus obscur encore.
Mes lanternes sont ainsi expliquées. Elles ne sont donc pas, comme l’écrit Da Costa, une « invention de journaliste ».
[1] La proclamation de la Commune, 1965, pp. 20-21.
[2] Procès des Communards, 1964, pp. 63 sv. Dans le même sens, M. Winock et J.P. Azema, Les Communards, Seuil, 1964, pp. 45 s.
[3] Depuis la dernière guerre, on a entrepris le procès apostolique de Mgr Darboy, archevêque de Paris, et des otages religieux de la Commune. Nous avons été chargés nous-mêmes de rassembler les témoignages relatifs au Père Olivaint, jésuite, et à ses quatre confrères, les pères Ducoudray, Clerc, Caubert et de Bengy.
[4]On en suivra les progrès dans le récent ouvrage de Jacques Rougerie : Paris libre 1871 que nous avons déjà mentionné. Voir aussi Adrien Dansette, Les Origines de la Commune, Plon, 1944, pp. 75 s.
[5]J. Rougerie. op. cit., pp. 61-63.
[6] Textes dans H. Lefebvre, op. cit., pp. 235-236.
[7] C’est le n°36 de la Rue du Chevalier de la Barre, qui contourne la basilique du Sacré-Cœur.
[8] Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871, tome II, « Dépositions des témoins », Versailles, 1872. p. 12.
[9] C’est le mot employé par A. Dansette, op. cit., p. 131 et par J. Rougerie, op. cit., p. 106.
[10]Édith Thomas, art. « Commune de Paris, 1871 », dans l’Encyclopedia universalis, tome IV (1968), p. 760.
[11] Cf. A. Ollivier, La Commune, Gallimard, 1939, pp. 249-250. Liste des communards, avec leur âge et d’autres détails dans Winock et Azema, op. cit., pp. 182-183.
[12]Journal des Journaux de la Commune 1872, t. Il. pp. 1-6.
[13]Marseille, Lyon. Saint-Etienne. Le Creusot, Narbonne... Cf. H. Lefebvre. op. cit., pp. 343-351.
[14]E. Thomas. art. cit.. pp. 761-762.
[15]A. Dansette. op. cit..pp. 155-157.
[16]« Après la chute de l’Empire, il se fit, dans l’épiscopat français une sorte d’unanimité autour de l’idée monarchique » (Jacques Gadille, La Pensée et l’action politiques des évêques français, au début de la IIIe République, Hachette, 1967, t. 1, p. 294.
[17]J. Rougerie, op. cit., pp. 224-226. Sur la profanation des églises voir P. Fontoulieu, Les Églises de Paris sous la Commune, 1873.
[18] Histoire du Catholicisme libéral en France, Paris, 1909. p. 290.
[19] Journal des Journaux de la Commune, t. I. p. 196.
[20] Ibid., p. 251.
[21] Sur ces arrestations et sur toute l’affaire des Otages, voir Marc-André Fabre, Les drames de la Commune, Hachette, 1937, pp. 34 s.
[22] Texte dans (Abbé Clément), Saint-Sulpice sous la Commune, s.d., p. 118. Ouvrage précieux pour l’histoire religieuse de la Commune. Nous avons mis en italiques les noms des otages qui seront mis à mort.
[23] Maintenant rue Planchat.
[24]Peut-être certains lecteurs s’étonneront-ils de ce que nous paraissions passer par trop rapidement sur le réservé aux prisonniers civils et militaires. Ce n’est pas par « cléricalisme », mais par souci d’honnêteté : ayant été chargé d’enquêter sur ce qu’il advint des membre du clergé, nous nous sommes bornés à faire état de cela seulement que nous connaissons.
[25]Cf. MA. Fabre, op. cit., pp. 158-169.
[26]Maxime Vuillaume, Mes Cahiers rouges au temps de la Commune, Paul Ollendorf, 2e éd. s.d., pp. 108-115.
[27]M.A. Fabre, op. cit., pp. 201-226.
[28] Elle se trouvait en face de la gare de Lyon et comptait plus de 1 200 cellules. Elle a été démolie en 1898.
[29]M.A. Fabre, op. cit., pp. 83-93.
[30] Ces témoignages ont été recueillis au procès informatif de 1872 et dans les écrits des Otages (Yves Bazin, Gard, Lamazou).
[31] Pour l’essentiel du récit, nous suivons M. Vuillaume, op. cit., pp. 67 s.
[32] Sur cette correspondance de Mgr Darboy avec Thiers, nous renvoyons à l’ouvrage de J. Gadille, op. cit., t. I., pp. 219-220. Vuillaume déplore l’éxécution de l’Archevêque « qui fit tant pour Blanqui » (pp. 71-72)
[33] M. Vuillaume, op. cit., p. 78.
[34] G. Da Costa, La Commune vécue, t. II, pp. 8 sq. – M. Vuillaume, op. cit., pp. 75-78.
[35]G. Da Costa, op. cit., pp. 455-458.
[36]Vuillaume tient pour 7 h. 30 et Da Costa pour 6 h. 30. A propos de cette controverse sur la présence ou l’absence de lanternes, voir Vuillaume, op. cit., pp. 83-84. [Voir également à la fin de cet article le complément intitulé « Note V »– NDLR]
[37]Sur ce massacre, nous utilisons, outre Vuillaume, op. cit., pp. 118-136, l’abbé Raymond, vicaire à Belleville, et sa relation parue dans l’Univers du 22 août 1871. Voir aussi Eugène Crépin, Souvenirs de la Commune de Paris, 1872 ; M. A. Fabre, op. cit., pp. 170-200.
[38]Maintenant rue de Belleville.
[39]La relation de l’abbé Raymond est du 22 août 1871.
[40] Sur le lieu du massacre, on peut consulter E. Crépin, op. cit. L’auteur était locataire du 85 rue Haxo après la Commune. Il a fait lui-même sur le drame une enquête attentive dans le quartier.
[41] M. Vuillaume, op. cit., pp. 135-136.
[42]« Aussitôt après la Commune, les corps des cinq otages de la compagnie de Jésus, Léon Ducoudray et Alexis Clerc (fusillés à la Roquette), Pierre Olivaint, Jean Caubert et Anatole de Bengy (fusillés rue Haxo), ont été inhumés dans une des chapelles latérales de la résidence de la rue de Sèvres (dont le père Olivaint était supérieur), maintenant Église Saint-Ignace (33 rue de Sèvres).
[43]M. A. Fabre, op. cit., p. 257. J. Rougerie, op. cit., p. 227. Sur les Conseils de guerre, voir outre ces deux ouvrages l’ouvrage antérieur de J. Rougerie, Procès des Communards, 1964.
[44] Albert de Mun, Ma vocation sociale, 1908, pp. 22-23.
[45] Ibid., p. 31.
19:03 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)
12/11/2014
Review of "Acts of the Captivity" (1872)
Another review about a book on Alexis Clerc, published in 1872 in the Dublin Review:
DUBLIN REVIEW.
VOL. XVIII. NEW SERIES.JANUARY—JUNE, 1872
Notice of Books:
Acts of the Captivity and Death of the Fathers Olivaint and four others of the Society of Jesus.Translated from the French of Father De Ponlevoy. London: Burns, Oates, & Co. (pp. 106.)
This most interesting little book, which may be truly so characterizedfrom its mode of treatment as well as from the subject itself, gives us,in details which would be painfully vivid were we not reading of martyrdom,the deaths of five Jesuit Fathers, shot in Paris during the last hours of theCommune. Père de Ponlevoy writes as might be expected from him, of thesehis brethren in many a long year of religious obedience and apostolic labour. There is, throughout, both in the narrator and in those of whom he writes,the union of two qualities, each of them an enigma to the world, and in theirconjunction absolutely incomprehensible. We see the mortified equanimityof one who has long since resigned his will into the hands of his Lord, togetherwith the fervent brotherly charity of a heart detached and spiritualized, andtherefore the seat of a supernatural ardent love for all, “especially for thosewho are of the household of the faith.” We should therefore greatly desireto see this little book in the hands of all who remain under the misconceptionof supposing that a priest, and especially a Jesuit, must needs be a heartlessand soulless automaton, who having surrendered his will once for all, hasported thereby with every feeling of affectionate regard for his brother-man. It is no such “smooth savage,” to use an expression of the poet Coleridge’s, who indites these feeling, breathing lines; who, while he records the trials,sufferings, triumphs of his brethren in religion, rejoices and weeps by turns.We must deny ourselves the pleasure of making extracts that solicit us atevery point as we turn over time pages; and merely say that the “Acts”consist of seven chapters; viz.—Biographical Notices—Preliminary Movements—The Arrests—The Conciergerie—Mazas—La Roquette and the Executions—Epilogue.
One of the most thrilling parts of this narrative is the account given of theentrance of our Lord in the Most Holy Eucharist into the prison of Mazas. This greatest of consolations for the captives preparing for their martyrdomwas planned, and successfully accomplished, notwithstanding manifold difficulties. How ardently it had been longed and waited for we are not left toimagine. “Six Sundays,” wrote P. Olivaint, “passed in darkness. Howmany days without going up to the altar! Ah, when we are deprived of ablessing, how much better we feel its value.” (p. 59.) Again : —
“How manifest it is to me that the Lord has conducted all! I am at theforty-first day of my retreat. After to-day, I shall only meditate on theEucharist Is not that the best way of consoling myself for not being ableto say Mass? If I was a little bird, I would go every morning to hear Masssomewhere, and would afterwards return willingly into my cage. Say manythings for me to all. A word particularly to Armand. How I think ofhim! He suffers more than I do, I am sure, and his friends also.
“It was only towards the middle of the day that the little pots and littleboxes, so long expected arrived at Mazas. There was one each for Father Olivaint, Father Ducoudray, and Father Clerc, but none, alas! this time for Father Caubert and Father de Bengy; it had not been possible to makearrangements on their side. Each of the three privileged Fathers receivedfour hosts, amid each of them could thus preserve and carry on his heart, asupon a living altar, the God of his heart and his portion for eternity.
“The prisoners had been forewarned of this ingenuous and daring attempt,and were to give notice at once of its success. Father Olivaint hastens to send this note on the evening of the 15th:—’ I did not expect anything moreto-day. My surprise, and I will say, my consolation, was all the greater.Thank you again and again, a thousand thanks! I have been occupied a longtime on the Holy Ghost in my retreat; now I will only meditate on theEucharist.” (pp. 61, 6g.)
We will record a sentence from the words spoken by one of their ownpupils over the martyred bodies of these Fathers, when they were found andhonourably interred, on the entrance of the troops and the extinction of theCommune. And then we take a reluctant leave of this little volume, withthe single unfavourable remark, as regards the translation, that It might havepreserved a substantial fidelity to the original, and yet have been less constrainedly French. There are expressions of true good English, all but literalsynonyms to words here employed, but missed (as it seems to us) by thetranslator, which would have rescued his—or perhaps her—work from thisfriendly criticism, and rendered it a more scholarly production. But thegift of really good translation, especially from the French, is almost as rareas that of really good poetry; with this favourable difference between the two departments of literature, that mediocrity is not intolerable in the one asin the other. Let us be thankful for what we get: only, it is a pity, as faras it goes, if we might have had better with a little more pains.
Over their bodies, then,—may we not say their relics, as Père de Ponlevoy entitles his narrative their “Acts”? —the following most true words wereuttered: —
“That these poor Fathers desired, the end they pursued, was to form forFrance a Christian youth. They knew that, if in the heart of a child is found, innate, so to say, the love of family, and the love of country, all that is veryweak, very capricious, very frail, without the love of God; and then, in themorning of our lives, they received us from the hands of our parents, tostrengthen that which in us was only instinct, by principles which wouldrender us one day capable of devotedness, by teaching us the law of sacrifice,so severe, and yet so consoling. But in opposition to our masters, in themidst of the rending of our unhappy country, men have been found capable ofevery crime. These men have said to themselves— ‘In order that societymay become an easy prey to us, we must have a society without God;’ andfinding themselves the strongest for several hours, they have killed those whowere preparing a race of Christians for France,” (p. 101.)
DUBLIN REVIEW.
LONDON:BURNS, OATES, & CO., 17 & 18, PORTMAN STREET,AND 63 PATERNOSI’RR ROW. / DERBY: RICHARDSON & SONS. / DUBLIN: JAMES DUFFY; W. B. KELLY; Me GLASHAN& GILL / BALTIMORE: KELLY, PIET & CO. / MONTREAL, CANADA: SADLER & CO. / 1872.
19:48 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)