23/06/2013
VIE DU PERE ALEXIS CLERC PAR CH. DANIEL (Chapitre 2)
CHAPITRE II.
séjour en france. — nouvelle campagne.
conversion.
Nous savons peu de chose sur le séjour d’Alexis en France du 14 octobre 1845 au 26 mai 1846, date d’un nouvel embarquement.
Dès qu’il est au milieu ou à proximité des siens, sa correspondance nous fait défaut. Néanmoins, aux détails près, nous pourrons dire comment il remplit cet intervalle d’environ sept mois. A en juger par les résultats et par les souvenirs consignés ultérieurement dans ses lettres, ce ne fut pas un temps perdu, au double point de vue de sa carrière et de son acheminement vers la vie chrétienne.
A Toulon, ayant pu enfin passer son examen, il fut promu au grade d’enseigne de vaisseau. Puis il vint à Paris et n’y resta pas oisif, comme on va le voir.
Être enseigne de vaisseau à vingt-six ans, ce n’était pas un succès enivrant, et, d’après ce qu’il venait d’éprouver, notre jeune officier ne pouvait se promettre un avancement rapide. Ses doutes, à l’endroit de sa carrière, subsistaient donc tout entiers. Nous ne saurions dire si ce fut par les conseils de son père ou de quelque ami de la famille, toujours est-il qu’il crut devoir se ménager, à tout événement, l’entrée d’une autre carrière, peut-être mieux en rapport avec ses antécédents, celle de l’instruction publique. Il se remit donc courageusement à l’étude des mathématiques et se fit même l’élève d’un de ses anciens camarades de l’École, M. Joseph Bertrand, alors professeur au collège Saint-Louis. En trois mois il avait obtenu les diplômes de bachelier et de licencié ès-sciences mathématiques, et il se préparait à devenir docteur, lorsque la perspective d’une nouvelle campagne le rengagea pour longtemps dans la marine.
Mais la préparation de ses examens fut loin de l’absorber tout entier, et il entreprit alors des études d’un bien autre intérêt, qui devaient imprimer à sa vie une direction toute nouvelle.
Nous l’avons dit, il n’était pas systématiquement incrédule et le voltairianisme de son père n’avait jamais déteint sur lui. Encore moins s’était-il laissé entamer par les bizarres doctrines de Fourier, qui comptaient alors de nombreux adeptes à l’École polytechnique.
Plus sage, en ce seul point, que tant d’autres, il n’avait pas fait de pacte avec l’erreur. Mais, depuis l’âge de quatorze ans, ne mettant jamais le pied à l’église, il n’entendait plus parler de Dieu ; il n’avait rien lu, rien de ce qui éclaire l’homme sur sa destinée future et son avenir éternel ; à cet égard, il était redevenu un pur païen. C’était donc une éducation à refaire. Il le comprit et se mit résolument à l’œuvre.
Il lui arriva comme à Marceau, ce grand chrétien, bien ignorant, lui aussi, et même d’une impiété quelque peu agressive, jusqu’au jour où les écailles lui tombèrent des yeux. Poussé par je ne sais quelle curiosité, ou plutôt obéissant à une première et mystérieuse impulsion de la grâce, le capitaine Marceau demanda un jour à un ecclésiastique de Toulon [1] un livre sur la religion catholique où la question fût traitée à fond. Ce digne prêtre lui donna la Démonstration évangélique de Duvoisin. Marceau la lut d’un bout à l’autre, d’abord avec une certaine défiance, puis avec un intérêt passionné, la lumière pénétrant de plus en plus vive dans son âme ; et tel fut, au rapport de son historien, le commencement de son admirable conversion qui précéda de quelques années celle d’Alexis Clerc.
Par quelles mains le même livre fut-il remis à notre jeune marin ? Je l’ignore, mais ce que je sais c’est qu’il le lut avec le même fruit que Marceau, et que, plus tard, il l’indiquait à ses amis comme un remède dont il avait éprouvé sur lui-même l’efficacité. Fort bon livre en effet, doué de toutes les qualités sérieuses qui distinguent la vieille école française. Né vers le milieu du xviiie siècle, Duvoisin avait professé en Sorbonne avant la Révolution ; le concordat fit de lui un évêque et il administra avec sagesse le diocèse de Nantes, mais pour son malheur il devint, en 1811, membre de la commission ecclésiastique présidée par le cardinal Fesch et dans cette occasion mémorable, hélas !il ne fut pas héroïque. IL en rejaillit sur son nom une flétrissure qui ne doit pas atteindre le remarquable traité apologétique dont il est l’auteur. Tout homme désireux de s’instruire de ce qu’il n’est pas permis d’ignorer, trouvera là, en quelques pages écrites sans prétention, mais non sans chaleur, — quoique d’un style toujours contenu et discret, — tous les éléments d’une conviction solide et réfléchie.
« La religion chrétienne est-elle révélée ? Voilà l’état de la question. Question de fait qui ne peut être décidée que par des faits, c’est-à-dire par celles de toutes les preuves qui sont les plus convaincantes, les plus frôles à saisir, les plus analogues aux principes et aux sentiments qui nous dirigent dans le cours ordinaire de la vie. L’auteur du christianisme s’est dit l’envoyé de Dieu. Ses disciples prétendent qu’il a justifié sa mission par des prodiges évidemment surnaturels, et ils apportent en preuve non-seulement leur témoignage, mais encore des prodiges tout semblables, opérés par eux-mêmes au nom de leur maître. Jésus-Christ et ses apôtres ont-ils fait les miracles qui leur sont attribués ?et ces miracles ont-ils à notre égard un degré de certitude qui ne permette pas à un homme raisonnable de les révoquer en doute ? [2] »
Voilà en effet toute la question ; elle est nettement posée et l’on doit ajouter consciencieusement résolue ; si bien, qu’en arrivant à la conclusion de son livre, l’apologiste est en droit de s’adresser à Dieu lui-même et de lui dire avec Richard de Saint-Victor : « Dieu de vérité ! je crois fermement tout ce que vous m’avez révélé par Jésus votre fils. Lui seul a les paroles de la vie éternelle, et il n’est pas sous le ciel d’autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Je ne crains pas de m’égarer à la suite d’un tel guide. Mais si, par impossible, ma foi était une erreur, ce serait vous qui m’auriez trompé en permettant que le christianisme fût marqué à des caractères où je reconnais l’empreinte de votre toute-puissance [3]. »
Cela soit dit en passant pour signaler à l’attention du lecteur, un livre qu’Alexis Clerc avait en très-haute recommandation, d’après son expérience personnelle confirmée depuis par des études plus approfondies.
Alexis lut aussi les Pensées de Pascal, et comme il était très-sensible non-seulement à la portée philosophique des idées, mais encore à la beauté du langage, il goûta infiniment l’illustre penseur qui est sans conteste l’un de nos plus grands écrivains. Soit qu’il compare l’entreprise de Jésus-Christ à celle de Mahomet et qu’il arrive à conclure que, a puisque Mahomet a réussi, le christianisme devait périr s’il n’eût été soutenu par une force toute divine ; » soit qu’il dise tout simplement, avec l’autorité d’une conviction inébranlable, qu’il croit « des témoins qui se font égorger, a Pascal, qui, dans des conditions différentes, aurait été peut-être le plus puissant des apologistes, abonde en mots frappés au coin du génie qui sont comme autant de médailles commémoratives de ces grands faits divins dont se compose toute l’histoire du christianisme. Moins exact, cependant, moins vrai, lorsque, étalant comme à plaisir la misère de l’homme déchu, il s’acharne sur cette grande ruine et prend à tâche de dépouiller l’image de Dieu de tout ce qui rappelle encore son origine. Si la raison humaine était aussi infirme qu’il le prétend, aussi fatalement entraînée sur la pente de l’erreur, il faudrait désespérer d’elle et renoncer à lui faire accepter les préliminaires de la foi. Aussi, quoi qu’on ait pu dire, dans cette partie de sa sublime ébauche, Pascal est plus janséniste que catholique, et le douloureux scepticisme, qui s’exhale si souvent de ses pages immortelles, n’est pas toujours sans danger. Chose remarquable ! Clerc, si novice en ces matières, eut un sentiment confus de ce côté faible d’un écrivain de génie, et l’on verra, dans une lettre que nous citerons tout à l’heure, qu’il ne regardait pas le livre des Pensées comme très-propre à éclairer une certaine nature d’esprits.
Je ne saurais dire si ce fut alors ou depuis, mais il lut aussi et goûta singulièrement l’éloquent chapitre de La Bruyère sur les Esprits forts ; et comme son admiration était on ne peut plus communicative, nous la verrons partagée par ses amis en ce qui concerne ce remarquable morceau, dont la valeur apologétique n’est certainement pas à dédaigner.
Ainsi, dès le début, guidé par son seul amour du vrai et du beau, Alexis entrait de plain pied dans le commerce des grands esprits chrétiens du xviie siècle, et il s’y trouvait passablement à son aise pour un enfant du xixe siècle, formé à une tout autre école. Plus tard on le verra faire mieux encore, aborder de front saint Augustin et saint Thomas, leur consacrer ses loisirs, devenir leur disciple et, au besoin, leur interprète ; résolution rare chez un homme de sa profession, et qui ne tenait en rien du caprice.
Cependant tout n’était pas fait, et la conversion du cœur était singulièrement en retard sur celle de l’esprit. En dépit des promesses qu’il s’était faites à lui-même, il ne profita pas de son séjour à Paris pour obéir à la voix qui lui disait comme autrefois au pauvre lépreux :Ostende te sacerdoti.[a] S’il vit des prêtres, ce fut de loin.
Il y en avait alors d’illustres — plus tard il devait les mieux connaître — dont l’éloquence attirait dans la nef de Notre-Dame un immense auditoire, jeune et passionné pour le bien. En descendant de chaire, à l’issue du carême de 1845, le P. de Ravignan avait dit :« Levez-vous donc, messieurs, au milieu des sociétés malades, et dites-leur votre force et votre bonheur ; qu’on vous rencontre, qu’on vous voie partout où le mal a besoin de remède, le bien de consolation et d’appui. Montrez le courage des convictions catholiques aux postes les plus avancés de la lutte, dans les combats de la science, de la philosophie, des lettres, de l’industrie, des arts et de la liberté. Faites entendre la grande voix du christianisme parmi ce chaos confus d’opinions et de doctrines. Dites que vous voulez, que nous voulons la gloire et la grandeur de la patrie, le développement des institutions, le libre essor du génie et des grandes pensées. Pensez vous-mêmes bien haut, apprenez à ceux qui l’ignorent votre langue et votre foi ; rétablissez par la conscience chrétienne l’empire de la justice, de la vérité et d’une sainte indépendance. Croyez-le !vous avez reçu plus de puissance et de durée que tous les essayeurs épuisés des théories humaines. »
Telle était la note à cette date ; et la voix grave et austère du P. de Ravignan ne la rendait pas encore aussi vibrante que celle, plus sympathique à la jeunesse, du P. Lacordaire. Quelles années que celles-là !quels hommes ! A la Chambre des pairs, Montalembert était tous les jours sur la brèche, champion infatigable de toutes les grandes causes catholiques. La lutte se poursuivait depuis deux ans avec une ardeur sans pareille ; et si, d’un côté, on était attristé par une recrudescence d’impiété qui éclatait dans la presse périodique, et jusque dans les chaires de l’enseignement supérieur, on reprenait courage en voyant l’épiscopat tout entier guider aux combats de la guerre sainte les fils des croisés. La compagnie de Jésus était proscrite ; elle dut s’effacer et faire la morte par ménagement pour les timidités du pouvoir ; mais elle venait d’affirmer son existence comme elle ne l’avait pas encore fait depuis le commencement du siècle, dans l’éloquent plaidoyer du P. de Ravignan : De l’existence et de l’Institut des Jésuites. La liberté que revendiquait le P. de Ravignan au nom du droit commun, un peu auparavant le P. Lacordaire l’avait prise. Il était monté dans la chaire de Notre-Dame revêtu de la robe blanche des dominicains ; et personne n’avait osé lui demander de quel droit il portait l’habit de son ordre.
La France entière avait les yeux fixés sur ces deux illustres religieux qui, dans tout l’éclat de la plus pure renommée, ne rivalisaient que d’éloquence, de zèle apostolique et de charité fraternelle. Après l’apparition du beau livre du P. de Ravignan, dans une séance solennelle du cercle catholique, présidée par l’Archevêque de Paris, le P. Lacordaire s’écria : « Si nous étions en Angleterre, je proposerais trois salves en l’honneur du P. de Ravignan. » Ces paroles furent suivies d’unanimes applaudissements, trois fois répétés [4].
S’imagine-t-on que Clerc, revenu en France avec l’intention de faire profession de christianisme, soit resté insensible à ces grands spectacles ? On me le dirait que je n’en croirais rien, tant cette indifférence était peu dans sa nature. Cependant, quels que fussent ses sentiments, il ne fit pas alors le pas décisif. Bien plus, se retrouvant en présence des mêmes séductions auxquelles il avait succombé tant de fois, il éprouva les mêmes défaillances que par le passé et se sentit plus éloigné du but auquel tendaient pourtant toutes les convictions de sa raison devenue chrétienne.
J’en trouve l’aveu dans des notes manuscrites qui portent la date d’une grande retraite faite à Saint-Acheul après son entrée dans la Compagnie de Jésus.
Qu’on me permette de soulever ce voile. Je le ferai, bien entendu, avec tout le respect dû à sa mémoire vénérée et à sa mort glorieuse, mais avec la sincérité dont il aurait usé lui-même, si, nouvel Augustin, il nous eût laissé le livre de ses confessions. Eh bien !oui, j’en crois les notes accusatrices de sa retraite de Saint-Acheul, et je ne crains pas de divulguer ici les égarements de sa jeunesse, qui seront plus tard le triomphe de l’infinie miséricorde.
Comme tant d’autres enfants du siècle, dans cette atmosphère empestée de Paris, de bonne heure il connut le mal et n’en eut point horreur. Les maisons d’éducation qui le reçurent doué d’une précocité dangereuse, protégèrent mal son innocence, et il prêta une oreille complaisante à la voix de ses passions. Une fois, — probablement pour s’exempter de toute pratique religieuse, — il eut le triste courage de se dire protestant, et s’il s’imposait alors quelque contrainte, ce n’était pas vertu, car il se qualifie de sépulcre blanchi. Mais la dissimulation répugnait trop à sa nature ; il secoua de nouveau le frein et ne voulut plus paraître autre qu’il n’était ; l’École Polytechnique, Brest, les îles Marquises, Valparaiso, enfin Paris, qu’il revoyait après avoir reçu les premières impressions de la grâce, chacun de ces noms excite son repentir en lui remettant devant les yeux les dérèglements et les scandales de sa jeunesse.
Saint Augustin, qui en savait quelque chose, nous peint éloquemment cet état de lutte, où, l’esprit étant convaincu et aux trois quarts soumis, le cœur hésite encore et n’a pas le courage de briser les liens qui le retiennent captif sous le joug des sens [5]. Ses inclinations mauvaises et frivoles venaient à l’envi le tirer par la robe de sa chair et lui murmurer à l’oreille : Quoi !tu nous quittes ? C’en est donc fait !et la séparation sera éternelle ! Le moment est donc venu où tu ne jouiras plus de toute ta liberté ?
Tel était l’état d’âme d’Alexis, de retour à Paris après sa campagne dans les mers du Sud, et voilà comment il put, lui qui croyait déjà et qui désirait pratiquer, assister à ces grandes manifestations de foi catholique qui réveillaient les plus endormis, sans y prendre part autrement que par ses regrets joints au sentiment de son indignité. Tant il est vrai que la force de caractère ne suffit pas à tout et que les âmes les mieux trempées succombent là où les petits et les faibles remportent la victoire avec la grâce de Dieu.
Nous le retrouvons à Toulon dans le courant du mois de mai, en activité de service et se préparant à une nouvelle campagne. Là sa correspondance, interrompue par son séjour à Paris, se rouvre et nous donne jour sur son intérieur à une époque déjà très-voisine de sa conversion.
« Mon cher père, écrit-il le dimanche 3o mai, je pars demain lundi à bord de la corvette à vapeur le Caïman, pour la station du Sénégal. Je n’ai reçu cet ordre que mercredi. Les occupations d’un départ si précipité et plus encore la certitude de n’avoir pas de réponse à ma lettre m’a fait tarder jusqu’à ce jour pour t’en informer. J’aurais très-vivement désiré recevoir des nouvelles de Paris, principalement au sujet de la dernière lettre que je t’ai envoyée, et comme j’avais l’espoir de jour en jour d’en recevoir, j’ai remis au dernier jour les derniers mots que je t’écris de France. Cet embarquement, auquel je ne songeais pas le moins du monde, est évité autant que possible par chacun ; aussi m’est-il revenu de droit. Je regrette de n’avoir pas été embarqué sur un vaisseau. Mais le plus fâcheux, c’est que me voilà encore au loin et peut-être pour longtemps. Je compte sur une campagne au moins d’une année, mais il est impossible de rien prévoir maintenant. Malgré tous les inconvénients de cette campagne, je crois que je m’y suis résigné assez philosophiquement. Je suis très-convaincu qu’on ne peut avoir assez de sagacité pour prévoir à l’avance et pour si longtemps. Cependant je ne saurais dire que j’aie bon espoir. Je compte sur de la tranquillité et de la paix à bord, et voilà tout. Moyennant cela, j’aurai, j’espère, de quoi m’entretenir à bord pendant la campagne. »
Il emportait des livres, comme toujours ; mais sa bibliothèque de campagne s’était renouvelée et les ouvrages religieux y tenaient une large place. Il ne savait guère où Dieu le menait ; par un pressentiment instinctif, il se dérobait à l’aiguillon dont il allait sentir les plus vives atteintes.
Autre lettre, commencée en mer le 22 juin et terminée le 27, devant la barre du Sénégal.
« Nous avons, ce matin 22 juin, mon cher père, dépassé les îles Canaries sans y toucher, et nous aurons demain le soleil dans le nord. Madame Pagès t’aura probablement communiqué une lettre que j’ai envoyée de Cadix, et il ne me reste à te mettre au courant de mes affaires que depuis ce moment. Tu sais par conséquent qu’avant d’aller à Cadix nous avions déposé à Tanger le consul de Mogador. Nous devions l’aller reprendre après qu’il se serait abouché avec le consul général de France et le conduire à sa destination. Nous quittâmes donc Cadix le 13 pour l’aller prendre. Mais nous trouvâmes à l’entrée du détroit un vent d’est très-violent et le commandant jugea prudent de retourner à Cadix. Nous y fûmes mouillés dans la soirée. Le lendemain dimanche 14, j’étais de garde, et je m’étais déjà consolé de ne pouvoir partager le plaisir d’aller à terre. C’est que la chose en valait la peine : il s’agissait d’une course de taureaux à Cadix. Mais ne voilà-t-il pas que le commandant m’engage à y aller et me propose de faire la garde pour moi. Moi, pas fier, j’accepte, et me voilà de la partie. Il n’y a, décidément, que l’absurde de raisonnable, que l’impossible qui se réalise. Où a-t-on jamais vu, même dans les contes de fées, des commandants qui font la garde pour leurs officiers afin de les laisser aller à des courses de taureaux ? C’est absurde et c’est impossible. »
Il assiste donc à ce sanglant spectacle, à cette boucherie dont les apprêts ne lui inspiraient d’abord qu’un insurmontable dégoût. Puis il s’étonne d’être gagné par la curiosité, par l’émotion du drame, et il subit l’espèce de frénésie qui s’est emparée de tous les spectateurs.
« Aux deux premiers chevaux horriblement éventrés, j’étais baigné de sueur, le cœur me gonflait dans la poitrine. J’aurais bien voulu avoir conservé ma garde à bord. Et cependant je suis resté jusqu’à huit heures du soir, j’ai vu tuer huit taureaux, éventrer une dizaine de chevaux et emporter deux picadors à moitié morts. Cela aurait duré vingt-quatre heures, que j’y serais resté, je crois, sans boire ni manger. Enfin, le croirais-tu ?au second taureau, j’applaudissais les beaux coups soit de la bête, soit des hommes ; je huais les maladroits, je demandais les chiens quand le taureau me semblait trop pacifique. On se dit :« Les chevaux sont des rosses qu’on mène au cirque au lieu de les mener à l’abattoir ; quant aux picadors, ils valent à peu près autant que leurs montures. » Oh !que je comprends bien à présent les prouesses des gladiateurs ! Quelle gloire de transporter d’admiration par son adresse ; sa force et son courage un peuple tout entier ! Quel enivrement que celui d’une telle victoire et de tels applaudissements en plein soleil !Il y avait un matador maladroit : à sa place, je me serais fait tuer par le taureau, ou je l’aurais tué d’un seul coup.
« Que de cruauté et de folie dorment cependant à notre insu dans un recoin ignoré de notre cœur !Aurais-je jamais cru que je dusse sentir et penser de la sorte ? Imaginez-vous donc que vous vous connaissez, quand de pareilles épreuves viennent vous donner de pareils démentis !
« Malgré tout cela, je retournerais sur-le-champ revoir tuer des taureaux, éventrer des chevaux et fracasser des picadors, ou tout au moins ne voudrais-je pas pour beaucoup ne l’avoir pas vu. »
A Tanger, il va passer la soirée chez le consul français, qui avait réuni pour la circonstance tous ses collègues européens. Là il danse, il valse et il s’abandonne à une franche gaieté, tout en observant du coin de l’œil cette société cosmopolite et en faisant à part soi de piquantes réflexions sur l’aimable concorde qui règne entre les représentants des différentes puissances, grâce à la nécessité où ils sont de frayer ensemble pour ne pas vivre comme des hiboux.
Encore un trait qu’il lance à tout hasard en s’éloignant de Tanger :« Nous avons fait à ce très-aimable empereur de Maroc la gracieuseté de lui transporter à Mogador une demi-douzaine de petits négrillons, esclaves et eunuques destinés à son sérail. Et nous allons au Sénégal pour empêcher la traite ! Mais il est défendu de voir et de prendre aucun négrier, à ce qu’on dit. La suite me permettra d’affirmer ou de nier cette singulière consigne. Je crois que tout le clabaudage de M. Billault avec son droit de visite est la cause de la présence dans cette affreuse station de vingt-six bâtiments de l’État. Si on m’envoyait quelquefois payer de leurs personnes tous ces palabreurs, cela produirait, je crois, un bon effet. Mais attendons à voir pour être bien sûr. »
Il avait raison de ne pas précipiter son jugement. A quelques jours de là le Caïman, ayant rencontré un négrier, fit son devoir en conscience. Quant à sa mauvaise humeur contre M. Billault et les orateurs négrophiles, intraitables sur le droit de visite dont ils parlaient fort à leur aise, c’était un sentiment très-répandu parmi les marins et autres gens avisés qui soupçonnaient la philanthropie anglaise de n’être pas désintéressée dans la revendication d’un droit extrêmement onéreux au pavillon français.
Chemin faisant, il esquisse le portrait des officiers du bord, dont il a généralement à se louer. Le commandant, capitaine Rousse, est un provençal, déjà sur le retour, qui regrette un peu les figuiers et les oliviers de sa bastide, mais bon, indulgent pour ses inférieurs et fort bien disposé en faveur de l’enseigne Clerc, auquel il apprend son métier. « Hier soir, il m’a tenu une longue conversation, où il m’a indiqué les meilleurs et les plus dignes moyens de faire son avancement, c’est-à-dire le sommaire des matières dont la connaissance est utile, la manière de les étudier et de les employer à son profit. Tout cela sentait l’expérience et la bienveillance. Tu vois, mon cher père, que je suis bien tombé. Il fait, il est vrai, profession d’un positivisme très-prosaïque ; mais (ajoute-t-il judicieusement), comme ce sont les excès des sentiments contraires qui l’ont ainsi transformé et que c’est maintenant un homme très-bon, je me félicite de l’avoir pour maître. Le second du bâtiment est M. Esmangard, lieutenant de vaisseau, gracieux dans sa personne et dans son esprit. Dès le premier jour nous nous sommes donné dans l’œil, et si le diable ne s’en mêle, j’aurai un jour en lui un ami. »
En effet, ils devinrent amis. Si je suis bien informé, ce jeune officier se réclamait de l’école de Fourier, qui comptait alors beaucoup d’adeptes, comme on put le voir en 1848. La conversion de Clerc, dont Esmangard fut témoin, laissa leur affection entière, sans qu’il s’opérât entre eux de rapprochement sur le terrain des croyances.
Cependant Alexis ne perd pas son temps ; il réfléchit, il étudie tantôt les mathématiques, tantôt l’économie politique, mais plus souvent encore la religion, et l’on sent bien que c’est là au fond sa grande affaire.
Un jour il écrit à son frère Jules ces lignes singulières, dont le visible embarras trahit la pensée qui l’obsède et le domine bien malgré lui.
« Il y a un quart d’heure que je tourne ma plume dans mes mains sans oser rien écrire. C’est très-ennuyeux à la fin de parler toujours de soi. Je te jure que si tu ne me renvoies pas la monnaie de ma pièce, et avec les intérêts, c’est fini, je ne t’écris plus.
Cela posé, je continue. Le peu de temps qui échappe au jeu, au sommeil ou au service, je lis J.-B. Say et l’Histoire des Variations. C’est un contraste assez frappant ; l’un ne s’occupe que des biens matériels et ne s’imagine pas qu’il y en ait d’autres, et l’autre n’en a guère souci. Mais il y a des livres qu’il faut connaître ; on doit y prendre ce qu’il y a de bon et laisser le reste. Notre métier, d’ailleurs, nous oblige à apprendre dans les livres ce que, vous autres citadins, vous apprenez malgré vous. Il faut que nous sachions à quoi nous en tenir sur les questions douanes, commerce, industrie, colonie, traités de commerce. Nous pouvons avoir à y intervenir, et il serait alors trop tard pour commencer à les étudier ; et voilà le pétrin où je me suis fourré pour quelque temps. Il est minuit passé, mon quart aussi. Bonsoir : je m’en vais prendre Bossuet. Il a le privilège de me tenir compagnie jusqu’au moment du sommeil, »
Prenant de nouveau la plume, il ajoute :« Je fais toute sorte d’efforts pour devenir plus sage et plus religieux ; mais c’est difficile, et mon voyage à Paris a contribué à augmenter les obstacles. J’espère que, de ton côté, tu es dans la même voie et je ne doute pas que tu n’y marches plus vite que moi. Je te recommande les Méditation s et les Élévations de Bossuet ; ce sont deux excellents livres. »
Les deux frères avaient puisé aux mêmes sources le germe de l’indifférence religieuse. Mais la grâce agissait simultanément sur leurs cœurs et l’heure approchait où la joie de chacun d’eux, en revenant à Dieu, allait être doublée par le retour et la réconciliation accomplie d’un frère bien-aimé.
Un peu avant d’arriver au Gabon, Alexis écrit encore à son père ; il faut lire entre les lignes pour deviner ce qui se passe dans son âme.
« Mon cher père, nous avons rencontré ce matin un pauvre diable de négrier. Nous nous rendions tranquillement à la voile au Gabon. Nous avons allumé les feux des chaudières et, une heure après, le bâtiment recevait un de nos canots [6]. Il va partir, je lui confie cette feuille.
« Tu sais fort bien, cher père, que ce n’est que dans les romans que les marins mènent une vie aventureuse. En réalité rien n’est si uni, si régulier ; c’est une vie presque monastique et, en vérité, je n’ai absolument rien à te raconter, car il ne s’est rien passé que du temps. Mais il est assez reçu de parler sans rien dire. Donc, je me porte très-bien ; je ne m’ennuie pas et je ne sens pas encore ce besoin terrible de Paris qui me tourmentait si fort il y a à peine une année. Cela ne m’empêche pas de le désirer et de le regretter, mais ce n’est pas une souffrance.
« Je suis toujours au mieux à mon bord, et je désire cependant le quitter pour aller avec Esmangard sur un bâtiment à voiles.
« Le départ de l’officier qui commande notre prise de ce matin me laisse, après le lieutenant, le plus ancien officier du bord, de sorte que la prochaine prise pourrait, si je le voulais, m’échoir et par suite me ramener en France. Qu’en penses-tu ?— Mais ne vendons pas la peau de l’ours…
« J’espère trouver des lettres au Gabon, où nous serons dans quelques jours. Je n’en ai point encore reçu. On ne sait pas à Paris le bien que cela fait à un pauvre exilé. Vous restez ensemble, vous !
« Ne trouves-tu pas qu’il y a eu une sorte de fatalité pour me faire embrasser ce métier ? Je ne m’en plains pas, je suis à peu près aussi heureux que possible ; mais il me semble qu’il y a eu quelque chose d’étranger à ma volonté qui m’a poussé, il y a cinq ans, à cette résolution. Cinq ans !j’ai été obligé de recompter plusieurs fois. Oui, il y a cinq ans que je vous ai quittés ; cinq ans !j’en ai vingt-sept à présent. Comme le temps passe vite même lorsqu’on est malheureux ! Mais le malheur passé est un bonheur présent ; il est doux de s’en souvenir.
« Je fais tous mes efforts pour devenir sage, mon cher père, c’est-à-dire religieux, car il n’y a pas de sagesse hors de la religion. J’aurais bien besoin de conseils ; j’en suis tout à fait privé ; j’en trouverais de si bons en France !
« Charge-toi, mon cher père, d’embrasser Jules, ce bon et honnête homme ; dis-lui, sans blesser sa modestie, qu’on ne saurait rencontrer un cœur aussi intelligent et aussi dévoué que le sien.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
« Adieu, cher père, je t’embrasse de tout cœur ; porte-toi bien. Se je pouvais te souhaiter du repos ! Mais tu regardes ton travail comme un devoir. On te comprend, mais on préférerait te voir vivre pour toi un peu, à la fin. Adieu, cher père ! »
Enfin il a vu le Gabon, cette terre promise d’un nouveau genre, côte aride et montagneuse située juste sous l’équateur. Là pourtant coula pour lui le lait et le miel ; là il goûta la joie de se sentir en paix avec Dieu et avec sa conscience, et lorsqu’il quitta le rivage africain pour revenir en France, il avait commencé une vie nouvelle.
Nous avons sous les yeux une lettre à son frère, datée de Wydah, le 25 janvier 1847. « Wydah, nous dit un missionnaire qui avait pris passage à Gorée sur le Caïman, est une ville du puissant royaume de Dahomey. Le roi de ce pays est célèbre dans la Guinée par son palais aux murs garnis d’ossements humains, et par sa fameuse garde noble, composée de femmes armées de pied en cap et d’un courage à toute épreuve [7]. »
Dans cette lettre, pleine d’effusions cordiales, éclate la joie de l’enfant prodigue rentré en grâce avec son père. Alexis vient d’apprendre, par des amis qui lui ont écrit de Paris, que son frère, touché comme lui de la grâce, remplit maintenant tous les devoirs d’un fervent chrétien. Il l’en félicite chaudement, en homme qui sait le prix d’une conversion sincère et qui est en train d’en faire l’expérience : « Que ce royaume est éloigné de celui du monde !que la bonté y surabonde !que les fondements en sont stables ! Il ne m’a pas été donné de voir ton bonheur, de m’y associer ; cette joie nous est peut-être réservée, nous prierons tous les deux pour l’obtenir. »
Alors aussi lui apparaît, non plus comme un reproche, mais comme un motif d’espérer beaucoup, la pureté de sa première enfance, protégée par une bonne et pieuse mère. Quoi de plus touchant que cet élan du cœur au moment où il se sent renaître à la foi et à la vertu !a Il nous faut aller tous vers une pauvre sainte femme qui nous tend les bras là-haut. Elle nous appelle, pour sûr, de tous ses efforts. »
Toutes les perspectives de la vie sont agrandies et embellies par celles de l’éternité où il aspire, et il ne se lasse pas de bénir l’infinie miséricorde qui l’appelle à une si grande félicité, lui si coupable !
« Que je serai heureux s’il m’est accordé de me trouver encore au milieu de vous ! Quel heureux changement dans notre société ! Quel déplorable égarement n’a pas été le nôtre, et combien plus déplorables ceux qui ont fait tant d’efforts pour rendre aimable ce qui est si odieux ! Quelle clémence a pu -endurer si longtemps cet orgueil et cette corruption ! Combien mon compte est lourd dans tout cela ! »
Les vertus chrétiennes, qui sont sœurs, ont pris toutes à la fois possession de son âme : humilité, défiance de soi-même, respect sans bornes pour l’autorité de l’Église représentée par ses ministres, crainte salutaire de s’égarer en s’en rapportant trop à ses propres lumières.
Il écrit le ier février : « Je regrette beaucoup de ne pas être à Paris. J’ai le plus grand besoin de conseils. Ma vie — c’est mon ardent désir — doit désormais suivre des voies nouvelles. Je n’ai pas encore de route tracée. Le contact d’un homme pieux et éclairé serait pour moi, comme homme et comme chrétien, de l’influence la plus salutaire. La solitude peut être profitable, mais elle peut aussi être dangereuse, et avec ma Bible latine, que je comprends mal peut-être plus souvent que je ne crois, pour tout entretien, je suis exposé à beaucoup de périls. J’ai des craintes et des incertitudes continuelles, et sans compter les mille erreurs de doctrine dans lesquelles je puis tous les jours tomber à mon insu, je n’ose m’imposer certaines obligations qui pourraient être inutiles ou nuisibles, et je n’ose ne pas me les imposer.
« Il faut, dit saint Paul, nous contenter de la mesure de grâce accordée à chacun de nous. Je ne sais jamais si, par une ambition coupable, je veux aller au-delà, ou si, par lâcheté, je reste en deçà.
« Peut-être, dans une position si différente de la mienne, ne comprendras-tu pas ces sollicitudes, et je t’en félicite. Je ne puis m’empêcher de m’imaginer que tu jouis de la paix promise aux hommes de bonne volonté. Je pense bien que ce n’est pas sans quelques troubles passagers. Mais j’arrête sur toi ma pensée avec bonheur ; il me semble alors que c’est un reflet qui m’arrive. »
Le changement était complet, il fut sans retour. Comment s’était-il opéré ? Nous l’ignorions, lorsque tout récemment, nous avons rencontré un digne témoin de cette grande et consolante conversion. Un fils du R.P.Libermann, un missionnaire de la congrégation du Saint-Cœur de Marie, est revenu du Gabon, ce semble, tout exprès pour nous apprendre ce que nous avions tant à cœur de savoir ; aujourd’hui, rendu à sa chère mission, il continue à évangéliser les pauvres nègres de la côte africaine.
« O malheureuse Guinée ! s’écriait le vénéré P. Libermann, il me semble que je l’ai tout entière dans mon cœur ! Les malheurs de ces pauvres âmes m’oppressent et m’accablent. » Au mois de septembre 1843, il y avait envoyé sept missionnaires qui abordèrent au cap des Palmes le 29 novembre suivant. Trois d’entre eux furent emportés en quelques jours par la fièvre ou l’apoplexie, et le reste fut dispersé par la fureur des nègres. C’est pour remplir ces vides, ou plutôt recommencer à nouveau une entreprise si difficile que les PP. Briot de la Mallerie et Leberre montèrent à bord du Caïman en rade de Gorée. Le P. Leberre, qui a seul survécu et que j’ai pu voir pendant son séjour à Paris, se rappelle très-bien le commandant Rousse et son second M. Esmangard, intimement lié avec l’enseigne Clerc. Esmangard était fouriériste, et les autres officiers faisaient profession d’indifférence, sinon d’incrédulité. Après quelques jours de traversée, l’on se mit à discuter avec les missionnaires. L’un d’eux, M. Briot de la Mallerie, avait été dans la marine, ce qui, joint à l’ascendant de son caractère, lui donnait quelque chance d’être écouté. Nul ne prêtait à ses discours une oreille plus attentive et plus sympathique que l’enseigne Alexis Clerc, toujours prêt à faire honneur à ses convictions. Un jour, engagé lui-même dans la lutte, il rompit en visière à son camarade Esmangard, et, au carré du bâtiment, devant tout l’état-major et tous les passagers, il fit, avec une certaine solennité, la déclaration suivante :« Après tout, messieurs, ce sont encore les principes qu’une mère chrétienne a déposés dans le cœur de son enfant, qui y restent le plus profondément gravés, et ce sont eux aussi qui sont les meilleurs. »
« A partir de ce moment, ajoute le R. P. Leberre, il parut entrer dans une véritable voie de conversion. Il demanda un catéchisme à M. Briot, sans doute pour se remémorer les principales vérités de notre sainte religion et se préparer à la pratiquer. Il fit, à l’établissement de Sainte-Marie du Gabon, une confession générale et y reçut la sainte communion. Un autre officier du Caïman suivit son exemple. »
Enfin une dernière révélation nous arrive inopinément et nous permet de saisir Clerc en pleine lutte, à la veille de son dernier combat, puis encore tout frémissant des angoisses qu’il a traversées avant de remporter cette grande victoire.
Il avait dans la marine un ami chrétien, Claude Joubert, simple enseigne de vaisseau, avec lequel il s’était lié sur la frégate la Charte qui les avait ramenés tous les deux en France après leur première campagne faite dans les mers du Sud. Depuis, Joubert avait quitté le service, non pour se reposer, mais dans la pensée de recevoir les saints ordres et de se vouer un jour aux saintes fatigues de l’apostolat. Apôtre, il l’était déjà, et il pressait son cher camarade de ne pas opposer plus longue résistance à la grâce. C’était, du reste, un de ces amis sûrs auxquels on peut tout confier. Il est mort à vingt-neuf ans, diacre, emportant dans la tombe le secret des entretiens intimes qui lui avaient fait voir un vase d’élection dans cette âme encore asservie à la chair et au sang, qu’il cherchait à conquérir à Jésus-Christ.
Mais les lettres qu’il avait reçues du Gabon, et d’autres encore, il les a gardées ; et voilà qu’après trente ans, elles tombent entre nos mains, pleines de lumière, — d’une lumière qui éclaire la profondeur de l’abîme d’où notre nouveau converti sort avec une joie mêlée de crainte et d’étonnement.
Clerc écrit une première fois à son ami en vue du Gabon, le 8 décembre 1846. Après quelques détails sans intérêt pour le lecteur : a J’arrive enfin, lui dit-il, à te remercier de ta bonne lettre. Qu’elle est arrivée à propos !qu’elle est affectueuse et qu’elle touche au point précis où je sens le mal ! O mon cher ami, écris-moi souvent, je t’en conjure, quand même tu ne recevrais pas de réponse. L’éloignement, tu le vois, peut en être la cause, et je suis bien affligé de penser que tu ne m’as pas écrit depuis le 3o mai, et que tu ne m’écriras qu’après avoir reçu cette lettre. Ne fais plus ainsi à l’avenir, cher ami ; c’est l’utilité de tes lettres qui t’oblige à m’en envoyer souvent. Montre-moi ton cœur, tes luttes, tes succès. Tu me précèdes dans la bonne voie, tu me dois l’exemple et l’encouragement.
« Je suis à bord de la corvette à vapeur le Caïman, station des côtes occidentales d’Afrique. Je suis aussi heureux que possible. Le bâtiment est dans une paix profonde. Je suis au mieux avec le capitaine, et le lieutenant, qui s’appelle Esmangard, est pour moi un ami. Les hommes sont doucement et justement conduits par le lieutenant. C’est un ancien ami de Desmarets. Il ne croit pas ; mais je ferai tant, il a de si belles qualités... il y viendra. Mon cher Joubert, c’est maintenant la paresse qui est mon ennemi. Ce bonheur tranquille m’engourdit. Je suis tourmenté cependant, je ne suis pas dans ma paresse sans remords, mais je ne trouve pas la force de vouloir la surmonter et je suis toujours dans ce dilemme [8] cruel de ne pas oser me former une règle de conduite de peur qu’elle ne soit extravagante ou que je ne la suive que par orgueil, et de vouloir m’en faire une afin que mes efforts vers le bien soient récompensés. J’ai besoin de secours, je suis abandonné, sans conseils ; je te prie, fais-moi une règle, je te promets que je tâcherai de la suivre exactement… Tu as pitié d’une telle faiblesse, mais voilà mon état. Le respect humain me tient aussi. Si j’étais sûr de persévérer, je sens que je ne m’en soucierais pas ; mais je suis si faible que je crains mille rechutes, et mes démarches ostensibles seraient alors bien ridicules. Et puis, aujourd’hui, on feint la piété par ambition, et je mourrais de honte, si une faute, hélas !trop probable, venait justifier l’opinion que j’ai été à la recherche d’une épaulette chez les missionnaires. Tout cela est bien petit, n’est-ce pas ?mais c’est comme cela. Tu vois que j’ai besoin de toi. Je prierai, et peut-être que demain j’aurai la force d’aller chez les missionnaires. Mais envoie-moi tout de même une règle à suivre, compatible avec mon métier. Jésus-Christ a promis de se trouver là où plusieurs seraient réunis en son nom. Mais moi, je le cherche seul ; viendra-t-il ? Peut-être m’égaré-je dans les voies de l’orgueil au lieu de m’avancer dans la voie de la charité. »
Là s’arrêtent les premières confidences de notre jeune marin ; elles trahissent toutes les hésitations de sa volonté en présence d’un devoir qu’il regarde comme certain et qu’il serait heureux d’accomplir s’il était plus sûr de lui-même. Il y a longtemps que cet état dure ; l’on peut craindre que la grâce, après avoir vainement frappé à la porte de son cœur, ne se lasse et ne l’abandonne à une fausse et mortelle sécurité. Mais non, il n’en sera pas ainsi ; Dieu veille sur cette âme généreuse au fond, mais endormie, et il ne se privera pas de la gloire qu’elle saura lui rendre une fois qu’elle se sera pour toujours attachée à son service.
Un mois tout entier se passe, et Clerc, revenant du Gabon, prend de nouveau la plume pour écrire à son ami, le 11 janvier 1847.
« Mon cher Joubert, au moment où je finissais le dernier mot de la feuille précédente, j’ai entendu armer un canot. Je ne sais si j’en ai le mérite, mais sans me consulter je me suis sauvé à terre. J’ai été chez les prêtres et je me suis confessé le 11 décembre. J’ai reçu l’absolution, presque moment pour moment, vingt-sept ans après ma naissance [9] et le même jour nous sommes partis. Félicite-toi avec moi ; voilà un pas difficile de fait et c’est peut-être ta lettre qui m’a décidé. J’ai fait depuis beaucoup d’efforts pour bien vivre, mais tu sais combien c’est difficile et combien il nous faut pour cela de secours. Cependant on est, à la mer, à l’abri de bien des dangers ; les sens sont dans un assoupissement presque forcé. En vérité, l’homme est comme une pierre sur le haut d’une montagne ; elle est ferme sur sa base ; mais, si on l’ébranlé peu à peu et qu’on la fasse à la fin et à grand’peine rouler d’un seul tour, elle continuera à rouler toute seule, lentement d’abord, et peut-être pourrait-on encore l’arrêter ; mais bientôt sa course est impétueuse, les obstacles ne sauraient l’arrêter, elle les franchit par des bonds prodigieux qui augmentent encore sa vitesse ; elle brise, elle entraîne tout ce qu’elle rencontre, elle se précipite, comme avec une fureur toujours croissante, jusque dans la profondeur des abîmes. Oh !mon Joubert, que ma déplorable expérience te serve d’exemple ; puisse-t-elle m’en servir à moi-même ! Je sens que je n’ai pas la force cependant de résister à telle épreuve que mon esprit imagine ; je prie ardemment pour recevoir du secours et je m’efforce de détourner mon esprit de ces fantômes.
« Une jeunesse passée dans les excès de toute sorte est un bien grand malheur ! Tu ignores ces fantômes qui m’ont si longtemps poursuivi ; c’est bien à la grâce seule de Dieu que je dois d’en être moins souvent obsédé. Quand je jette les yeux en arrière, je suis bientôt obligé de les détourner. Ce que je demande le plus souvent et le plus vivement à Dieu, c’est d’avoir horreur du mal, c’est de pleurer sur ce passé ; je ne l’ai point encore obtenu.
« Tu vois, mon cher Joubert, quel état digne de pitié est le mien. Il me semble que s’il fallait mourir pour mon salut, je n’hésiterais pas, et je vis avec appréhension. Quelle créature est l’homme ? Il lui est donc plus facile de sacrifier sa vie que de contrarier ses passions ? La solitude est souvent funeste, la société presque toujours. Croirais-tu qu’il m’est impossible de passer une journée sans dire du mal de quelqu’un ? Je sais combien c’est défendu, mais c’est un thème si fréquent que la médisance qu’il faudrait se condamner à un silence absolu pour ne pas l’aborder.
« Je ne peux pas comprendre la charité. Je ne sais comment faire pour aimer un homme rempli de défauts ; il est difficile de détester les défauts et d’aimer l’homme qui s’y complaît. Le remède serait de ne juger personne, mais c’est encore plus impraticable. Je cherche bien, mais en moi je ne puis trouver à cela aucune solution possible. Comment faire pour ne pas juger des actions qui nous frappent, des sentiments qu’on se plaît à vous développer ? Je sais que je suis moi-même plein de défauts, que je nourris une foule de sentiments coupables où je me complais ; mais cela n’influe pas sur le jugement que je fais des autres ; que cela me rende indulgent s’il fallait condamner, c’est sûr, et je crois que je ne condamnerais personne ; mais juger et penser :c’est bien ou c’est mal, cela est plus fort que moi, je ne saurais m’en empêcher, ni non plus de penser :cet homme est méchant, est sensuel, est injuste, etc. Oh !si le joug est suave et le poids léger, il est bien vrai aussi que la voie est âpre et étroite. »
Enfin le 20 janvier, avant de clore sa lettre, Clerc ajoute encore ces quelques mots :
« Je profite d’une occasion imprévue pour t’expédier cette lettre ; elle laisse encore une foule de choses à te dire. Depuis le 11 il m’est arrivé des lettres de France. La main de Dieu, mon cher Joubert, se révèle pour moi. Mon frère est rentré dans le sein de l’Église et a communié... J’ai éprouvé une contrariété maritime des plus vives. Je ne suis pas fixé. Si cette persévérance de contrariété est un avis de Dieu de quitter le métier, je suis prêt ; mais je ne veux pas le quitter en lâche, c’est-à-dire par des motifs humains. Éclaire-moi et prie pour moi.
« Adieu, cher et fidèle ami, prie pour un malheureux qui est bien souvent ballotté par les choses, bien tourmenté par son cœur. Je t’embrasse. A. C. »
Chose admirable !une fois entré dans cette voie étroite dont il n’approchait qu’en tremblant, Clerc n’éprouva pas les défaillances qu’il redoutait tant et qui semblaient inévitables à n’envisager que sa faiblesse dont il venait de faire, tout récemment encore, une triste mais dernière expérience. Les funestes images de son passé, les odieux fantômes dont il était obsédé s’évanouirent à la clarté du Soleil de justice, et il reconnut avec une joie indicible la vérité des paroles du divin Maître :« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes : car mon joug est doux et mon fardeau léger [10]. »
oOo
[3] Domine, si error est quem credimus, a te decepti sumus ; quoniam iis signis prœdita est religio, quae nonnisi a te esse potuerunt. — Richard de Saint-Victor, cité par Duvoisin. Démonstration évangélique, p. 360.
[6] Le négrier était donc capturé, et le commandant du Caïman avait rempli son devoir en s’opposant au transport des pauvres victimes de la traite.
[7] Lettre de M. Briot, missionnaire apostolique de la congrégation du Saint-Cœur de Marie, à M. Libermann, supérieur de la même Congrégation. — Annales de la propagation de la foi. T. XX, p. 324.
17:27 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0)
VIE DU PERE ALEXIS CLERC PAR CH. DANIEL (Chapitre 1)
ALEXIS CLERC
CHAPITRE PREMIER.
alexis clerc, avant sa vingt-septième année. — son entrée
dans la marine et sa première campagne.
Alexis Clerc naquit à Paris le 12 décembre 1819, sur la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, où il fut baptisé le lendemain.
C’était, de toute façon, un véritable enfant de Paris, appartenant à cette classe moyenne dont le rôle était déjà grand alors, mais l’ambition plus grande encore, et dont l’importance politique atteignit son apogée sous la monarchie de juillet. L’éducation d’Alexis, confiée de bonne heure à l’université, fut ce qu’elle pouvait être sous le régime du monopole, ni pire, ni meilleure que celle de tant d’enfants de la bourgeoisie parisienne, auxquels leurs professeurs inoculaient tous les jours l’indifférence et le doute et qui ne voyaient le prêtre que de loin en loin, comme un fonctionnaire dont on n’a besoin que dans trois ou quatre circonstances de la vie et après la mort.
Disons-le toutefois, Alexis eut pour mère une fervente chrétienne, d’une ancienne famille lyonnaise où la piété était héréditaire ;« une sainte, humble et douce, » — c’est le témoignage qu’il lui rendait plus tard — sur les genoux de laquelle il fut initié à la vie de l’âme en apprenant à connaître Jésus-Christ. Mais il la perdit à l’âge de treize ans.
Combien de temps fut-il encore fidèle à ses exemples et à ses leçons ? Quelques mois, une année peut-être au plus ; après quoi il suivit le grand courant et devint étranger à toute pratique religieuse. Treize années se passèrent ainsi, treize années qu’il devait pleurer avec des larmes amères et pendant lesquelles il avait vécu dans l’oubli de Dieu.
Il n’était pas né pour être incrédule, et il avait même de grandes dispositions — nous l’apprenons encore de lui — à tourner son cœur du côté de l’infini. « Lorsque j’allais à l’école tout petit, racontait-il plus tard à un ami, on lisait dans un grand livre relié en veau, les merveilleuses histoires des Saints. C’était si beau, que j’avais toute sorte d’envie d’en faire autant. Et bien certainement, pour être naïf, mon désir de plaire à Dieu et de faire de grandes choses pour lui n’en était ni moins vrai ni moins raisonnable. »
Comment cette belle ardeur s’éteignit-elle ? Hélas !la chose n’est que trop simple à expliquer, et son histoire est celle de milliers, de millions d’enfants, victimes d’un odieux monopole.
« Le poison du collège, ajoutait-il, eut vite et longtemps raison de ma naïveté et de mon désir de sainteté. » Cela se conçoit de reste ; quel est l’écolier, fréquentant les établissements universitaires, tels qu’ils étaient en ce temps-là, — je ne recherche pas ce qu’ils sont aujourd’hui, et je les suppose notablement améliorés, — quel est, dis-je, l’écolier qui n’eût été bafoué par ses condisciples, et peut-être par ses maîtres, s’il eût fait profession d’imiter de loin, de bien loin, les exemples d’un saint Stanislas ou d’un Berchmans, moins encore, d’aller à confesse et de fréquenter l’église ? On n’en convenait pas, officiellement du moins ; car si athée que fût la loi, l’État enseignant ne pouvait honnêtement se donner pour tel. Mais les professeurs, les chefs de l’instruction publique ne se faisaient pas faute d’attaquer dans leurs leçons ou dans leurs livres l’Église catholique, le clergé, l’épiscopat français tout entier, et tel d’entre eux se faisait applaudir en célébrant les funérailles du christianisme et en écrivant :Comment les dogmes finissent.
Dans la famille, après la mort de sa pieuse mère, Alexis ne trouva plus personne pour lui parler de Dieu, pour le rappeler à l’observation des devoirs du christianisme. Loin de là, son père, homme honorable d’ailleurs, et qui ne manquait ni de culture d’esprit, ni d’élévation de caractère, était un philosophe de la vieille école, un voltairien, pour dire le mot ; ardent patriote, mais d’une façon tant soit peu révolutionnaire, qui ne devait détester ni les chansons de Béranger, ni les pamphlets de Paul-Louis Courier. Si nous en croyons un ami d’enfance de notre Alexis, qui venait à la maison partager ses jeux et pour lequel on n’avait guère de secrets, M. Clerc, entraîné dans le mouvement libéral du temps et très-hostile au gouvernement du roi Charles X, ne resta pas simple spectateur pendant les événements de juillet 1830 ; et quand le trône, sapé par tant de mains, s’écroula pour le malheur de la France, le père de notre Alexis s’applaudit d’un pareil succès, et put se regarder comme l’un des vainqueurs. Ses affaires, car il était à la tête d’un commerce important, n’en allèrent pas mieux ; même il fit pendant la crise des pertes sensibles, dont il ne se releva jamais. Ses convictions politiques n’en furent point ébranlées ; il ne ménagea pas les sacrifices pour ce qu’il estimait être la bonne cause, et quand fut fondé le Siècle, il tint à honneur d’inscrire des premiers son nom sur la liste des actionnaires fondateurs. On voit d’ici dans quels principes Alexis fut élevé et quelles maximes on lui inculqua : de l’honneur, oui, beaucoup d’honneur, un grand désintéressement, un dévouement sans bornes à la patrie et à la sainte cause de la liberté ; mais de religion il n’en était pas question, si ce n’est peut-être pour s’élever contre les empiétements du parti-prêtre.
Alexis épousa-t-il les passions et partagea-t-il les préventions de son père en matière religieuse ? Je ne le crois pas, et je ne vois pas qu’il se le soit reproché après sa conversion, alors qu’il repassait avec amertume sur ses années de jeunesse. Non, il ne haïssait ni les hommes ni les choses d’Église ; indifférence et dédain, voilà tout ce qu’il croyait leur devoir, et sa philosophie, toute négative, n’allait pas plus loin.
Il fit ses études avec succès en partie au collège Henri IV, en partie dans une institution où l’on enseignait d’après la méthode Jacotot. « L’éducation que nous recevions dans cette maison, nous écrit un de ses anciens camarades, était l’idéal de l’éducation sans Dieu. Ce serait calomnier M. de S. que d’en faire un ennemi de la religion. Mais ce serait lui prêter un mérite qu’il n’avait pas que d’en faire même un simple déiste. Je ne croirais pas cet homme-là possible si je ne l’avais connu. Nous avons poussé là comme nous avons pu. »
Voici maintenant une petite esquisse de ce qu’était alors le jeune écolier dont la carrière devait être si laborieuse et semée jusqu’à la fin de tant d’épreuves. C’est toujours le même témoin qui parle.
« Alexis était la paresse même ; mais, grâce à son intelligence, il était l’un des élèves les plus distingués. Pour son caractère, je n’en ai jamais connu de plus facile et de plus aimable. Je ne crois pas lui avoir vu jamais une seule querelle. Il n’était mal avec personne, et nous étions deux ou trois particulièrement bien avec lui. »
Parmi ces intimes, il faut placer au premier rang son frère Jules, plus âgé que lui de deux ans au plus, et qui, le précédant à peu d’intervalle, n’avait pas d’autres camarades, d’autres amis que les siens. Leur mutuelle amitié était des plus tendres ; plus tard la religion, en faisant presque au même jour la conquête de l’un et de l’autre, resserra encore les liens déjà formés parle sang et par la sympathie des caractères.
A dix-sept ans, Alexis était bachelier ès-lettres. Que faire alors ? Le commerce n’était pas son fait ; n’ayant aucun goût à compter et à débattre ses intérêts, il y aurait réussi moins encore que son père. On pensa que la grande industrie ouvrirait un champ assez vaste à son besoin d’agir et de payer de sa personne. M. Clerc comptait parmi ses amis un M. G collet, qui dirigeait une filature de laine et qui, par parenthèse, venait d’acheter le château de Voltaire à Ferney. On fit entrer Alexis dans la filature. Mais les affaires de son patron ne prospéraient pas ; il fallut tout vendre, même Ferney ; et Alexis, rentré chez son père, se trouva de nouveau en quête d’une position, et moins fixé que jamais sur la carrière qu’il lui conviendrait d’embrasser.
« C’est alors, nous dit le témoin fidèle auquel nous empruntons ces détails intimes, et qui s’est mis de la meilleure grâce du monde à notre disposition, en nous faisant part de ses souvenirs, — c’est alors que M. Clerc, ne sachant que faire d’un enfant fort intelligent et qui était l’objet de toute sa tendresse, me fit l’honneur de me consulter, moi enfant plus âgé qu’Alexis de quelques mois à peine. Un de mes parents venait de sortir de l’École polytechnique dans un des premiers rangs. Je parlai de l’École polytechnique. M. Clerc me demanda :« Mais à qui m’adresser pour préparer Alexis ? » Je lui parlai de l’école préparatoire où avait été mon cousin. Il nous envoya, Alexis et moi, trouver le chef de cette institution. C’est ainsi qu’Alexis entra chez M. de Reusse, rue de Vaugirard, au coin de la rue Férou [1] »
Là encore il fut tel qu’il s’était montré pendant tout le cours de ses études classiques ; et nous en recueillons le témoignage de la bouche d’un de ses nouveaux condisciples, qui le suivit, à une année d’intervalle, à l’École polytechnique, et qui devait le retrouver, à trente ans de là, prêtre et jésuite, se préparant aux suprêmes épreuves que la Providence lui réservait. Nous n’avons garde d’enlever à ces quelques lignes leur couleur locale, dont nos lecteurs ne s’offenseront pas, surtout s’il leur est arrivé de fréquenter la jeunesse plus ou moins studieuse dans les rangs de laquelle se recrute la grande et illustre école où voulait entrer notre héros.
« J’ai fait sa connaissance, dit ce condisciple, à l’institution de Reusse, en 1839. La bonté de son caractère, son esprit vif et enjoué le faisaient aimer de tous, en même temps que sa facile intelligence de l’X le mettait en haute considération parmi les taupins (c’est ainsi qu’en argot scolaire on appelle ceux qui, se préparant à l’École polytechnique, font leurs mathématiques spéciales). Il était en même temps très-fort sur les compositions littéraires. Ce sont deux aptitudes qui vont rarement ensemble. Il y avait aussi de l’enthousiasme dans son caractère, et cela n’excluait pas un grand bon sens. »
Ce dernier trait achève de le peindre et tel, en effet, nous l’avons connu jusqu’au dernier jour. Son enthousiasme, loin de s’affaiblir ou de s’éteindre, — comme il arrive trop souvent à mesure que l’on multiplie les expériences, — s’était plutôt avivé en s’épurant au contact des saintes réalités de la foi et des espérances éternelles.
Après une préparation rapide, il fut reçu à l’École polytechnique en fort bon rang, le 26e de sa promotion. Les mêmes qualités aimables et toutes françaises qui l’avaient fait bien venir de ses camarades de pension ou de collège, lui valurent dans cette réunion de jeunes gens, si divers d’origine et de caractère, une véritable popularité qu’il conserva jusqu’à la fin et que nous avons retrouvée encore toute vive dans les souvenirs de plusieurs d’entre eux. Ils ne tarissent pas sur l’enjouement plein de charme, sur l’esprit vif et alerte, sur le caractère serviable et « bon enfant » du petit Clerc ; et si on les en croyait, on se laisserait aller à raconter les jolis tours et les jolis mots, d’ailleurs fort inoffensifs, par lesquels il égayait ses camarades. On sait qu’il existe à l’École un usage, une tradition sur la manière d’accueillir les nouveaux venus et de mettre quelque peu à l’épreuve leur bon caractère. Ce n’est pas chose nouvelle dans la jeunesse des écoles, et dont il y ait tant à rougir ; Athènes, en ce genre, avait devancé et probablement surpassé Paris, où, pendant tout le moyen-âge, les recteurs de l’Université eurent beaucoup de peine à protéger les arrivants dont on mettait la bourse à sec en leur faisant payer leur béjaune. Qu’est-ce auprès du béjaune que la colle d’absorption ? Je lâche le mot sans périphrase. Peut-être un jour ira-t-il rejoindre béjaune dans le Dictionnaire de l’Académie.
Toutefois, il faut l’avouer, la plaisanterie, assez souvent, dépassait les bornes et tournait en véritable vexation. Il n’en fut pas ainsi quand le petit Clerc fut choisi (avec le général Thoumas, nous assure-t-on) pour soumettre à cette épreuve la nouvelle promotion. Tout se passa de la manière la plus agréable pour tout le monde. Nous avons sous les yeux un spécimen des problèmes qu’il proposait, des questions qu’il adressait à ses recrues ; c’est fort drôle ; la subtilité grecque y donne la main à l’esprit gaulois, sans parler de l’agrément obligé des formules mathématiques brochant sur le tout ; mais il n’y a pas un mot dont on puisse s’offenser, et il paraît que ceux qui passaient par ses mains en sortaient légèrement chatouillés mais non froissés.
Aussi avait-il le droit de tout dire, à toute heure, sûr d’être écouté. Un jour qu’on venait de terminer je ne sais quel travail des plus ingrats, on voulut en détruire jusqu’aux dernières traces, et voilà nos grands écoliers amassant au milieu d’une cour des monceaux de papiers ; ils y mettent le feu, puis, se prenant par la main, ils forment autour une ronde effrénée. A un moment, Clerc se détache de la bande et s’approche du brasier : il voulait tout simplement allumer sa cigarette. Mais on prend le change sur son intention et ce cri est lancé :« Clerc veut parler ! » Au même instant la danse s’arrête, chacun fait silence et prête l’oreille. Bon gré mal gré, il dut prendre la parole pour dire qu’il n’avait pas envie de parler.
Il était entré vingt-sixième à l’école ; il en sortit vingt-troisième, preuve qu’il ne s’abandonna pas trop à son penchant pour la paresse. En pareil rang, il avait le droit de choisir entre plusieurs carrières, quelques-unes très-enviées, agréables et même lucratives. Quel ne fut pas l’étonnement de ses camarades quand ils apprirent qu’il avait choisi la marine ? « Un fameux marin, disait celui-ci, qui n’a jamais navigué que sur la Seine, entre Bercy et Charenton ! » — « Il veut faire le tour du monde, ajoutait un autre ; sait-il ce que c’est, lui qui n’est jamais sorti de Paris, si ce n’est pour aller, en coucou, à Versailles ou à Montfermeil ? » Et les quolibets d’aller leur train.
Le fait est que la vocation d’Alexis pour la marine était bien subite et, pour un natif de la rue des Bourdonnais, tout à fait extraordinaire. Il y débuta, sans préparation aucune, par une campagne de quatre ans dans les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquises, » nous disait un de ses amis. Comment avait-il pris une résolution si étrange, si inopinée ? Je soupçonne fort, tout d’abord, que tout emploi administratif lui répugnait, et qu’il ne voulait à aucun prix s’enfermer dans un bureau. Il lui fallait de l’air et du soleil, de l’espace, les coudées franches. Puis il avait son ambition à lui, non pas petite, mais fort grande ; ambition de faire quelque chose et de servir son pays en y mettant tout son savoir-faire et même, au besoin, son sang et sa vie. C’est la belle ambition de l’adolescent qui croit à la gloire et aux dévouements magnanimes, celle que Virgile a si noblement exprimée par la bouche de son Nisus :
Aut pugnam aut aliquid jamdudum invadere magnum
Mens agitat mihi, nec placida contenta quiete est. [a]
Après cela, si je regarde aux causes extérieures, j’en découvre une qui agit, paraît-il, sur notre Alexis. Il y avait parmi les amis de sa famille une excellente femme, Mme Pagès, qui lui portait un vif intérêt et dont le nom se retrouve fréquemment dans ses lettres. Elle avait un frère capitaine de corvette, le commandant Baligot, qui se préparait à partir pour les mers du Sud. « Si tu veux te faire marin, dit-elle au jeune homme, mon frère te prendra à son bord et moi je te donnerai ton épée. » — « Je ne demande pas mieux, » répondit-il. Ce qui fut dit fut fait, et l’on ajoute qu’il ne savait en partant ni le but ni la durée de l’expédition.
Il n’y avait pas de temps à perdre ; nommé aspirant de première classe le ier octobre 1841, il dut s’embarquer à Brest, sur la Triomphante, le 22 du même mois, et s’y trouva, lui futur officier, plus novice que le dernier des mousses, ne sachant rien de la manœuvre ni même de la langue du bord. Mais aussi, dès le début, il parut dans tous les avantages de son heureuse nature, plein d’énergie et de ressources, joignant à une grande décision de caractère cet esprit français qui n’y gâte rien, et conquérant par là tous les cœurs.
Admirablement placé pour le juger, le commandant Baligot écrivait, en mer, le 17 décembre :« Quant à Alexis, c’est un brave et courageux jeune homme, qui a fait preuve d’énergie dans les commencements de notre campagne. J’espère trouver l’occasion de lui en tenir compte. »
L’occasion vint bientôt, hélas !tout autre que ne l’attendait cet excellent homme, qui donna au jeune aspirant une marque d’estime et de confiance réservée d’ordinaire à un âge plus mûr et à une plus longue expérience. M. Baligot mourut en mer avant de toucher les côtes d’Amérique, nommant Alexis son exécuteur testamentaire, et celui-ci se trouva privé, dès son entrée dans la carrière, des conseils du vieil officier sans lequel il n’eût jamais songé à se faire marin. « Le commandant Baligot, écrit-il à son père (de Valparaiso, 19 août 1842), était, autant que j’ai pu en juger, de beaucoup le meilleur marin que j’aie vu jusqu’ici. Si c’est une perte pour le bâtiment, quelle perte n’est-ce pas pour moi que la sienne ! » Et il ajoute, nous révélant son caractère alors tant soit peu présomptueux :« Depuis que je crois avoir de la raison, — et c’est longtemps avant que j’en eusse, si toutefois j’en ai, — j’ai toujours jugé moi-même, me suis conduit par mon propre sentiment, ai voulu par ma propre volonté. Ce cher commandant était si sage, si éclairé, si noble, que, sans m’en rendre compte, je lui avais laissé le soin de vouloir pour moi : il m’aimait assez pour le faire. Sa mort me laisse sans intention, sans but, sans volonté. Je me suis laissé aller sans aucune direction. J’avais besoin de sa force. Une de mes opinions était une vérité pour moi s’il la partageait. Personne n’a jamais eu sur moi un pareil empire. »
Voilà bien le jeune homme au cœur enthousiaste et fier, qui se donne sans réserve et sans calcul, heureux, au delà de toute expression, d’avoir enfin rencontré un homme, un caractère, chose rare !
Mais que va-t-il devenir, lui dont la vocation de marin tenait à ce seul homme, et à qui vient à manquer l’appui dont il avait besoin plus que tout autre au début d’une carrière pour lui si nouvelle ?
Le ressort qui était dans sa nature, l’énergie indomptable de sa volonté suffirent à tout ; non qu’il éprouvât la même confiante allégresse qu’au moment du départ ; les épreuves lui furent rudes, et ne lui furent pas épargnées ; il les ressentit très-vivement, mais sans défaillance ; se demandant quelquefois s’il n’avait pas fait fausse route et s’il ne vaudrait pas mieux se raviser à temps et chercher un meilleur emploi de ses forces ; en attendant, faisant bonne contenance, surmontant tous les dégoûts, toutes les difficultés du métier, et ne s’abandonnant jamais lui-même.
Tel nous le montre un ancien officier de marine, son camarade dans cette longue et lointaine expédition, mais plus jeune que lui de quelques années et qui, sorti du vaisseau-école, n’était encore qu’aspirant de deuxième classe, tandis que Clerc, venu de l’École polytechnique, était d’emblée aspirant de première classe. « Il avait sur moi une grande supériorité d’instruction scientifique, nous dit ce digne officier, mais, d’un autre côté, mes connaissances pratiques, acquises au vaisseau-école, étaient supérieures aux siennes ; et, sentant bien que s’il ne demandait pas des explications, il ne connaîtrait jamais le détail de certaines manœuvres qu’il serait obligé de commander aux matelots, il me pria de l’aider dans ce travail. Il venait donc près de moi, la nuit, quand j’étais de service, et je lui expliquais les détails du gréement du navire, la manière de faire les nœuds et amarrages les plus usuels ; je lui apprenais le nom des cordages et leur position. Il fut ainsi en bien peu de temps au courant de tous les détails qu’il aurait toujours ignorés s’il n’avait eu l’humilité d’en demander l’explication à un ami. »
En parlant d’humilité, M. le vicomte de M. sait fort bien et il a soin d’ajouter que la religion de son camarade était alors « à l’état latent. » L’humilité, cette vertu essentiellement chrétienne, ne pouvait donc se greffer sur la foi absente. Mais le jeune marin était préservé, par son seul bon sens, de tout sot orgueil.
Ce genre de mérite, si rare chez un débutant, plaisait singulièrement aux hommes d’expérience et leur paraissait de fort bon augure, « Monsieur, écrivait au père d’Alexis M. Nielly, commissaire de la marine, mon second fils, qui, depuis six mois, habite la même chambre que votre Alexis, et s’en trouve au mieux, me charge de vous prévenir que son ami se portait bien le 10 novembre 1842 ; que leur corvette partait le lendemain de Valparaiso pour les Marquises, où elle stationnerait pendant six mois sur la rade de Nouka-Hiva, pour ne retourner qu’ensuite à Valparaiso ; qu’enfin la caisse contenant le reste des valeurs ayant appartenu à feu M. Baligot, capitaine de corvette, se trouvait en rade de Brest sur la frégate de l’État la Thétis. » Suivent des détails relatifs à la succession du commandant Baligot. M. Nielly termine sa lettre par ces mots qui durent combler de joie M. Clerc :« Je n’ai plus qu’à me féliciter d’avoir eu l’occasion d’adresser quelques mots au père d’un marin qui, tout jeune qu’il est, paraît réunir à l’habileté et au courage la sagesse qui en assure les fruits à ses amis et à soi. »
Sagesse tout humaine, encore une fois ; à l’époque où il s’attirait de tels éloges, ses mœurs étaient loin d’être irréprochables et il ne sentait pas même l’aiguillon du remords. Cependant l’heure de la grâce approche, et bientôt tant d’heureux dons seront transformés en vertus chrétiennes.
La crise intérieure à laquelle il dut son salut commence un peu après son départ de Valparaiso, aux îles Gambier, qu’il rencontra sur sa route en se rendant aux Marquises. Dieu lui ménageait là un spectacle dont son esprit observateur fut singulièrement frappé et qui le fit profondément réfléchir ; le spectacle d’une chrétienté naissante, renouvelant les merveilles de la primitive Église sur les ruines encore fumantes d’une idolâtrie abjecte et sanguinaire.
Le théâtre où éclatait ainsi la vertu de l’Évangile, était bien petit, bien obscur et presque ignoré du reste du monde. On parlait souvent de Tahiti, la nouvelle Cythère, qui devait au capitaine Cook et à d’autres navigateurs aussi peu scrupuleux, une célébrité de mauvais aloi. Mais à part les catholiques, — attentifs aux travaux des missionnaires et tenus au courant par les Annales de la propagation de la foi, — qui donc avait souci de connaître, autrement que de nom, et d’étudier dans cette phase si intéressante de leur histoire, ces petites îles d’origine volcanique, Mangaréva, Taravaï, Aokéna, Akamarou, qui forment l’archipel de Gambier, perdu dans l’immensité de l’Océan Pacifique, à trois cents lieues environ de Tahiti et à même distance des Marquises ? La première fois qu’ils y abordèrent, au péril de leur vie, les missionnaires français, prêtres de la congrégation de Picpus, n’y trouvèrent pour toute population que d’affreux cannibales, allant tout nus, faisant la guerre à leurs voisins pour se repaître de la chair et du sang des vaincus, joignant, en un mot, des appétits de bêtes féroces à des instincts d’enfants dépravés. Pays enchanteur, au reste, et d’une fertilité prodigieuse. L’étroite ceinture de terre qui entoure chaque cratère éteint produit à souhait et sans culture le cocotier, le bananier, l’arbre à pain, qui fournissent aux insulaires non-seulement la nourriture et le vêtement, mais encore la charpente, la toiture et tout le mobilier de leurs humbles cases. Malgré la richesse du sol et la beauté du climat, tout cela était l’empire du démon avant les années 1834, 1835 ; le Soleil de justice n’avait pas encore lui sur ces infortunés, qui dormaient assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort ; pas une âme, dans tout l’archipel, qui ne fût en proie à la superstition, à l’anthropophagie, à la lubricité la plus honteuse, et pas une parole de salut n’avait retenti sur ces plages inhospitalières. En débarquant à Mangaréva, la plus grande des quatre îles, — elle mesure à peu près une lieue d’étendue, — messieurs Caret et Laval virent du premier coup d’œil à quelle sorte d’hommes ils avaient affaire et quelles étaient les mœurs de l’endroit. On leur fit un accueil bienveillant et même empressé, mais qui ne leur inspira nulle confiance. Le chef d’une peuplade assez nombreuse leur ayant offert l’hospitalité vers le coucher du soleil, ils acceptèrent de lui un peu de nourriture, mais ne voulurent pas coucher dans sa case, pensant qu’ils seraient plus en sûreté dans le bois voisin. Vaines précautions ! La nuit venue, ils furent l’objet de poursuites sans nom, et on leur fit (racontent-ils eux-mêmes) « des propositions opposées à la plus sainte des vertus. » Ils s’enfuient ; on les pourchasse à outrance. Ils se cachent et se blottissent dans les roseaux de la plage ; on y met le feu et on les environne d’un cercle de flamme, dont on assiège toutes les issues afin de les faire tomber dans le piège infâme. Ils ne parvinrent à sauver leur honneur et leur vie que par un miracle de la Providence. Voilà ce qu’étaient les insulaires de Mangaréva vers 1834.
Eh bien ! à quelques années de là, ces mêmes insulaires seront de fervents chrétiens et des hommes civilisés, qui doubleront par le travail la fécondité d’un sol déjà si productif, qui cultiveront les arts nécessaires à l’entretien ou à l’ornement de la vie, qui accueilleront l’étranger avec une charité vraie et secourable, qui seront chastes, doux, désintéressés, sincères, reconnaissants, et qui puiseront dans l’amour de Jésus-Christ et de sa sainte Mère l’idéal et l’inspiration de toutes les vertus.
Ce que je dis là, notre jeune aspirant de marine le vit de ses yeux en débarquant aux îles Gambier dans le courant de l’année 1842. On lui montra une église, la première construction en pierre de Mangaréva, bâtie avec d’énormes blocs de corail que les indigènes allaient arracher aux entrailles de la mer, à cinq lieues des côtes, et rapportaient sur des radeaux. Il fit connaissance avec l’ancien grand-prêtre de l’île, Matua, espèce de géant, naguère encore anthropophage et maintenant doux comme un agneau. Matua avait accueilli des premiers la bonne nouvelle et son exemple avait décidé le roi Maputeo, son neveu, à recevoir le baptême. Dans une lettre datée de Valparaiso, où il était de retour après avoir stationné aux îles Marquises, Alexis raconte à son père ces choses si nouvelles dont il vient d’être l’heureux témoin et lui communique, sans beaucoup de commentaires, les premières impressions qu’excite dans son âme le spectacle de cette chrétienté au berceau. Je détache quelques passages de cette lettre.
« Quand nous sommes partis de Valparaiso, nous ne savions pas encore le but de notre voyage. Nous sommes allés aux îles Gambier.
« Il y a dix ans qu’une corvette anglaise y relâcha pour faire de l’eau. Les naturels s’emparèrent du lieutenant et d’un matelot, les tuèrent et les mangèrent. Ils étaient les plus féroces et les plus sauvages de l’Océanie, allaient complètement nus. Voici ce que nous avons vu.
« Ce groupe d’îles en renferme quatre ; nous ne sommes allés que sur les deux principales, Mangaréva et Akéna. L’abord en est très-difficile, il y a beaucoup d’écueils formés par des coraux. Il y va peu de navires, ces îles ne fournissant que des perles et de la nacre.
« Deux missionnaires français s’y établirent, il y a huit ans, avec deux ouvriers. Ils apprirent la langue. Par les bons conseils qu’ils leur donnèrent et par leur conduite, ils s’acquirent l’estime et l’affection des sauvages ; alors ils essayèrent de les convertir et de les civiliser. Il est impossible de concevoir par quels prodiges de dévouement et à quel point ils ont atteint ce but. Les naturels maintenant sont tous chrétiens ; ils sont honnêtes, bons, laborieux et très-religieux.
« Le grand-prêtre, qui avait égorgé les Anglais, fut un des premiers convertis. C’est un grand, gros, bel homme, tout tatoué, qui raconte naïvement les supercheries qu’il employait pour exploiter la crédulité de ses fidèles. Le roi fut plus difficile à baptiser, mais il y vint, puis tout le peuple.
« Maintenant les enfants vont à l’école : il y en a deux, une pour les filles, l’autre pour les garçons. Ils y apprennent à lire, à écrire, à compter ; on leur enseigne la religion, surtout les bons principes. Les garçons y ajoutent le latin.
« Le coton vient en abondance dans ces îles ; on leur a appris à le filer, à le tisser, à s’en faire des habits : tous les habitants sont vêtus.
« La nourriture de tous les naturels de l’Océanie est le fruit de l’arbre à pain, préparé d’une façon tout à fait détestable pour un Européen : cela s’appelle popoi.
« Les missionnaires leur ont appris à la mieux préparer, à conserver le fruit de l’arbre à pain sous terre, pour éviter ces famines épouvantables qu’un orage peut causer tout d’un coup.
« Enfin ces bons Pères ont construit une église, simple, mais plus belle que beaucoup de nos églises de campagne, — avec deux ouvriers. Les sauvages allaient chercher des masses de rochers, à cinq lieues de là, sur des radeaux, apprenaient des ouvriers à les tailler, à les élever et à les mettre en place. Les missionnaires ont trouvé dans les coraux si abondants et si nuisibles à la navigation, une mine inépuisable de la plus belle chaux du monde. Ils se sont élevés, à eux-mêmes et au roi, deux maisons en pierre qui servent de modèles pour les habitants.
« Les missionnaires n’ont pris aucune autorité dans le pays ; ils l’ont régularisée et laissée aux mains du roi. Il faut une piété bien vraie pour inspirer une pareille conduite. Nos missionnaires ont un caractère très-différent de ceux des Anglais. Ceux-ci travaillent pour leur pays, les nôtres pour le pays où ils sont. Les îles où il y a des missionnaires anglais deviendront anglaises ; celles où sont les nôtres se constitueront en petits états.
« Nous passâmes trois jours dans cet heureux pays, entre autres un dimanche qui était une grande fête. Tout l’état-major, officiers, élèves et la compagnie de débarquement en armes, assista à la messe. L’église était pleine d’un peuple immense qui chantait, dans la langue du pays, sur un air qui appartenait à leur ancienne religion, une prière que les missionnaires leur ont composée. Cette harmonie simple, pleine de contrastes, me produisit une impression comme je n’en ai pas ressenti…
« Après la messe, les missionnaires nous firent déjeuner chez eux avec le roi et le grand-prêtre. Un repas très-frugal nous fut offert, mais d’un si bon cœur ! Ces pauvres gens se servent de coquilles pour assiettes ; ils avaient du pain, mais ils ont été souvent réduits à la popoi. Quel beau dévouement, mais quelle récompense dans un pareil résultat ! Je croyais rêver, et voir la réalité d’un chapitre des Natchez.
« Enfin, — chose merveilleuse dans l’Océanie, — .es femmes sont chastes, les mariages respectés.
« Depuis lors la population, qui diminue chez tous les sauvages, s’accroît d’un tiers par an. Mais je veux vous réserver des choses à vous raconter pour mon retour ; car, enfin, je reviendrai peut-être. »
C’est là tout, et l’on soupçonnerait à peine, à lire ce récit entremêlé de rares et courtes réflexions, quelle impression profonde et durable Alexis avait remportée de sa visite à la mission des îles Gambier. Mais on l’a entendu souvent depuis rapporter à cette date le travail longtemps secret de sa conversion, qui aboutira, sur une autre plage, quatre années plus tard. S’il avait communiqué à son père toutes ses pensées, il n’eût pas été compris. Et puis avait-il bien conscience lui-même, à cette date, de ce qui se passait dans les profondeurs de son âme ? Si je ne me trompe, c’est après avoir vu et admiré de fort bonne foi toutes ces merveilles et pendant son second séjour à Valparaiso, qu’il se vit à deux doigts de la mort et que, se croyant perdu, il n’eut pas une seule pensée pour l’éternité.
Comme il l’a plusieurs fois raconté à ses amis et à ses frères, un jour qu’il gravissait une pente escarpée et dangereuse, ayant peut-être entrepris l’ascension de quelque morne du Chili, le pied lui manqua et il se sentit rouler dans l’abîme. Il pouvait y rester, mais on l’en retira vivant quoique fort meurtri. La lettre que je viens de citer parle de deux esquilles sorties sans trop de peine et de l’assurance d’une complète guérison. Or, au moment critique où, perdant tout espoir, il disait en lui-même adieu à la vie, parmi les mille réflexions qui traversèrent son esprit, rapides comme l’éclair, la plus saillante fut celle-ci :« C’était bien la peine, mon pauvre Alexis, d’entrer à l’École polytechnique et de faire un si rude apprentissage du métier de marin, pour aller ensuite te casser le cou si loin des tiens et laisser tes os dans ce misérable trou ! » A cela se bornait encore sa philosophie ; mais patience, la bonne semence est dans son âme, et elle portera ses fruits.
La vie de marin a cela de bon qu’en isolant les hommes elle les mûrit, pour peu qu’ils soient disposes à ne pas écarter par frivolité les graves et sérieuses pensées que doivent éveiller en eux les grands spectacles de la nature. L’homme se sent si petit entre le ciel et l’eau, si faible dans sa lutte sans cesse renouvelée contre les éléments, que, bon gré mal gré, il se souvient qu’il n’est pas maître de sa vie, qu’il ne s’est pas fait lui-même, que sa destinée ne lui appartient pas et qu’il est irrésistiblement poussé vers un rivage lointain sur lequel sa raison n’a que des lumières incertaines. Comment n’accueillerait-il pas, lorsqu’elle se présente à lui dans sa simplicité radieuse et consolante, l’idée d’une révélation et celle d’un Sauveur ? Son oreille est fermée aux mille bruits qui s’élèvent de la fourmilière humaine, et il n’est pas troublé dans sa méditation solitaire par le conflit des opinions et des systèmes ; la Vérité, dont la voix mystérieuse n’est jamais muette, se fait entendre plus facilement à son cœur et elle s’empare de tout son être du moment qu’il consent à l’écouter.
A dater du jour où il reçut aux îles Gambier ce premier trait de lumière, le jeune marin devient plus grave, plus appliqué, et sans avoir rien perdu de l’aménité de son charmant caractère, on sent, dans tout ce qu’il écrit, qu’il commence à envisager la vie par ses côtés sérieux, et à en mieux comprendre les devoirs. Sa tendresse pour son père et pour ses frères, toujours très-vive, s’exalte et s’épanche tantôt en touchants regrets, tantôt en aspirations et en désirs. Comme il comprend, maintenant qu’il en est privé, la douceur et le prix de la vie de famille !
« J’ai devant moi, dans mon secrétaire, écrit-il à son père, ma bibliothèque dont la vue seule me fait un grand bonheur. Qu’il m’est doux et triste à la fois d’avoir sous les yeux ces gages de ton affection et de celle de mes frères et de mes amis.
« Hélas !c’est là le cruel du métier : tout est fini, je ne vous verrai peut-être que trois ou quatre fois jusqu’à ce que j’aie ma retraite.
« Avoir été si près du bonheur, et l’avoir quitté pour toujours ! Où retrouverais-je de pareilles affections, et d’ailleurs pourrais-je briser les liens qui m’attachent aux anciennes ? Non, et je ne le voudrais pas. Ah !mon cher et bon père, combien je comprends que j’ai gaspillé mon bonheur en ne jouissant pas plus que je ni fait de ta tendresse pour moi et en te cachant la mienne ! Stupide caractère qui se révoltait contre les meilleures choses, qui ne voulait rien céder, rien pardonner ! Seuls, isolés des événements extérieurs, sans souci pour les choses matérielles de la vie, nous comprenons mieux combien le vrai bonheur de la vie vient de la famille, et combien des affections partagées et certaines sont délicieuses. Nous en sommes privés pour toujours, vous êtes perdus pour moi. Quel dédommagement peut-il y avoir à cette perte ? Aussi n’y en a-t-il pas, et la destinée de l’officier de marine est de devenir d’une insensibilité de pierre. Il a rompu avec toutes ses affections et ne se trouve plus capable d’en concevoir de nouvelles pour les rompre encore. »
Cette conclusion, que personne ne sera tenté de prendre au sérieux, est tout simplement une boutade. Non, certes, — et Clerc en est lui-même la meilleure preuve, — l’officier de marine n’est, par profession, ni indifférent, ni insensible, et il peut dire avec autant de vérité que n’importe qui :
Homo sum et humani nihil a mealienum puto. [b]
Comme le pauvre Alexis est triste lorsque, rentrant à Valparaiso après une première expédition dans les mers du Sud, il n’y trouve aucune lettre de son père ou de ses frères, aucune nouvelle de sa famille ! Mais aussi quelle effusion de joie lorsque le courrier ne lui a pas fait défaut et qu’il a revu cette chère écriture !« Laisse-moi t’exprimer, écrit-il à son tour, la plus vive reconnaissance, à toi d’abord pour tes lettres si bonnes, si affectueuses. Quelle sollicitude pour moi ! Ah !mon cher père, l’ardeur de mes embrassements pourra seule te donner une idée de la douceur qu’ont pour mon cœur les preuves multipliées d’une si tendre affection. Chère providence qui protège encore un pauvre enfant si éloigné, tes bons conseils me font le plus grand plaisir et je me fais un devoir de les suivre. »
Répondant à ce que son père lui avait dit, qu’il avait à lui rendre des comptes de tutelle et qu’il se reconnaissait son débiteur :« Je suis payé, archipayé, écrit Alexis. Je me sens presque en colère de cette idée qu’un père doive des comptes à ses enfants. Je n’en veux jamais entendre parler. »
Quant aux conseils que le jeune marin sollicitait et qu’il prenait toujours en bonne part, ils avaient pour objet non-seulement la direction générale de sa vie, mais encore le menu détail en matière de convenances et de savoir-vivre. En voici un exemple assez singulier. Après deux années de campagne, le temps de passer officier étant venu pour lui, Alexis avait le désir bien naturel de revenir en France où, après un examen, il aurait été régulièrement promu au grade d’enseigne de vaisseau. Autrement il faisait bien le service d’officier, mais il n’en avait pas le grade, position doublement fausse pour lui que son âge et sa qualité d’ancien élève de l’École Polytechnique mettaient déjà à part des autres aspirants. Si vous joignez à cela le désir non moins vif de revoir son pays, d’embrasser son père et ses frères, vous concevrez sans peine qu’il ait fait une démarche auprès de l’amiral qui commandait la division navale, — c’était, je crois, l’amiral Hamelin, — afin d’obtenir de lui son retour en France à la prochaine occasion. Jusque-là rien que de parfaitement correct et M. Clerc lui-même n’y trouvait rien à redire. Mais il avait couru certain commérage qui, selon la manière de voir de cet excellent père, avait atteint dans son esprit des proportions énormes. Son fils, — la chose est-elle croyable ? — avait demandé audience à l’amiral par écrit. Par écrit !n’était-ce pas oublier toute dignité et se donner fort gratuitement des airs de solliciteur ? Je suppose du moins que c’était là ce qui choquait tant un homme si épris des principes de 89, si chatouilleux en matière d’égalité. Il n’en était rien ; Alexis s’était tout simplement adressé, selon l’usage, à l’aide-de-camp de l’amiral, et sur la demande banale de celui-ci :« Que lui voulez-vous ? » il avait répondu :« Veuillez me nommer, et je présume que cela suffira pour que l’amiral sache de quoi il s’agit. » Comme M. Clerc dut être heureux d’apprendre que son fils n’avait pas commis ce qui lui semblait être une platitude ! Ces susceptibilités, peut-être excessives, feront comprendre, mieux que beaucoup de paroles, ce qu’avait dû être l’éducation d’Alexis, et quel était le niveau des idées et des sentiments dans son honorable famille.
Alexis n’obtint pas son retour au bout de deux ans, ni même de trois, et ce ne fut que la quatrième année qu’il revint en France très-fatigué d’une campagne dont les résultats, à ses yeux, n’étaient pas magnifiques. A la vue de ces rochers dénudés et inhabitables dont se compose presque tout l’archipel des Marquises, songeant au mystère impénétrable dont on avait couvert jusqu’au bout cette expédition et aux grands résultats attendus, il n’avait pu s’empêcher de s’écrier avec sa verve parisienne : « Oh !montagne, quel accouchement ! » Il pensait peut-être en lui-même qu’un aspirant de plus ou de moins dans la flotte n’importait guère aux projets de colonisation dont on s’occupait, tandis qu’il lui importait beaucoup, à lui Alexis Clerc, de ne pas rester indéfiniment simple aspirant de première classe. Il le dit à l’amiral qui, sans aucun succès, essaya de lui persuader que, pour le moment, il valait beaucoup mieux pour lui être aspirant qu’officier, et qui, de plus, eut la maladresse, le mot ne me paraît pas trop dur, d’ajouter :« De tous les anciens élèves de l’École polytechnique que j’ai rencontrés dans la marine de l’État, je n’en connais pas un seul qui soit marin. »
Pour le coup, c’était trop fort et vraiment il s’adressait mal. Si Alexis eût été un de ces jeunes pédants bourrés d’équations qui ne toucheraient pas du bout du doigt le moindre cordage, la leçon, si leçon il y a, eût été peut-être à sa place ; mais on a vu que notre aspirant ne la méritait en aucune façon, et que, par son courage, sa résolution, son désir passionné de s’instruire et d’apprendre son métier même de ses inférieurs, il avait fait concevoir de lui les meilleures espérances. Ainsi cette qualité d’élève de l’École Polytechnique qui, dans le civil, lui eût ouvert toutes les portes, devenait un obstacle à son avancement ; ces études, ces connaissances théoriques, partout ailleurs si appréciées, on en faisait fi et c’était marchandise à jeter par-dessus bord. Cela lui donna fort à réfléchir ; il envisagea de sang-froid sa position et se vit dans l’isolement où l’avait laissé la mort du regretté commandant Baligot. Point de nom, point de fortune, point de notoriété militaire ou maritime dans sa famille, point de ces hautes relations qui aident le mérite à percer quand elles ne tiennent pas lieu de tout mérite. Pouvait-il se fier à la détermination si subite qui avait fait de lui un marin ? S’il s’était trompé, ne valait-il pas mieux revenir sur ses pas, pendant qu’il en était temps encore ? Là-dessus il s’examine, il s’analyse de la tête aux pieds, après quoi il consulte son meilleur ami et son plus sûr conseiller, ce père si éclairé auquel il a recours en toute occasion :
« Je n’ai pas, que je croie, beaucoup d’ambition pour me soutenir dans ces luttes continuelles. Faut-il imposer un peu silence à cet orgueil qui vous réclame à un poste élevé ?ou bien faut-il s’y sacrifier, faut-il à tout prix, sauf celui de l’honneur, prétendre à des grades ?ou faut-il, remplissant tous mes devoirs avec modestie, attendre que la fortune daigne songer à moi ?
« La carrière de l’ambition est difficile, incertaine et irritante par les mécomptes qu’elle rencontre toujours ; elle est bien difficile pour moi qui n’ai pas de guide et qui ne sens que rarement cette espèce de feu sacré qui anime les hommes qui ont une noble ambition. Or, je ne ressentirai jamais l’étroite ambition de certaines gens que je connais, qui ne voient dans l’élévation que l’élévation elle-même, le prestige qui y est attaché et l’argent, mais qui n’y voient pas du tout un poste où ils sont appelés à faire valoir avec importance et succès leurs talents.
« Le système suivant ne serait-il pas le meilleur ? M’occuper tranquillement des idées que j’aime, nourrir les sentiments qui me sont doux, et, remplissant les devoirs du métier le mieux possible, me remettre à l’avenir pour les heureux hasards. »
Noble nature, après tout, qui, même avant d’être transfigurée par la grâce, connaissait tout le prix du désintéressement et n’aspirait jamais à rien de bas.
Ce que répondit son père, nous l’ignorons. Sans doute il réserva ses conseils pour le temps où, son fils étant de retour à Paris, leurs mutuels épanchements seraient plus doux et plus intimes. Ce moment semblait toujours s’éloigner. Alexis disait qu’on le trouverait bien changé et que, parti à vingt-deux ans, il en aurait vingt-six au retour, grand espace de la vie, comme dit Tacite, grande spatium[c], pour les hommes de cet âge.
Dans les premiers jours de janvier 1845, faisant la traversée d’Arica à Islay (Pérou), il écrivait à son père et lui communiquait quelques-unes de ses réflexions mélancoliques. Il terminait sa lettre en disant :« Je me propose de faire à notre arrivée à Callao, qui, j’espère, sera prochaine, de nouvelles tentatives pour débarquer ; mais j’ai peu d’espoir de réussir. Je crois que je pourrai t’en apprendre le résultat par cette lettre que je n’expédierai qu’à Callao. » Cependant il touchait au terme de cette longue et pénible campagne et, contre toute espérance, il put clore sa lettre par ce post-scriptum :« Aujourd’hui 21 janvier la corvette est arrivée à Callao. J’ai obtenu d’embarquer sur la frégate la Charte, commandée par M. Penaud. Elle part demain pour Valparaiso, et de là, pour la France. Ce sera environ le 25 février, de façon que je serai probablement au commencement de juillet à Brest et en août auprès de vous. Mais je n’y suis pas embarqué comme officier. Rien ne m’a arrêté quand il s’est agi de revenir plus vite. » Il se soumettait donc à une dernière épreuve en reprenant, à 26 ans, le rang et le service d’aspirant ; mais il allait enfin revoir la France et embrasser son père.
Quand il débarqua, il comptait quatre années de service à la mer ; il avait visité, en Amérique, les côtes du Brésil, du Chili et du Pérou, et traversé l’Océanie en tout sens, s’arrêtant tour à tour aux îles Gambier, aux Marquises, à Tahiti, aux Nouvelles-Hébrides. Son expérience de marin, nulle au départ, commençait à dépasser celle d’un aspirant de première classe. Nous en avons pour preuve la note que lui donna au retour le capitaine (depuis amiral) Penaud, officier de mérite, mais qui ne péchait pas, nous a-t-on dit, par excès d’indulgence. La voici :« Actif et servant fort bien ; a du goût pour la marine et beaucoup plus d’acquis en pratique qu’on ne pourrait en attendre d’un élève sortant de l’École polytechnique [2]. »
Mais le grand résultat de cette campagne, c’était pour lui le rayon divin qui avait pénétré dans son âme à la vue de la mission de Gambier, rayon dont la clarté toujours croissante allait illuminer sa vie tout entière et lui découvrir la voie droite où Dieu lui-même guide ses élus. Où en était-il de cette merveilleuse transformation à l’expiration de ses quatre années de campagne ? Nous savons de bonne source qu’au moment de partir de Valparaiso pour la France, il découvrit à un officier, dont les sentiments lui étaient connus, son désir de devenir chrétien comme lui, et qu’il le pria de l’adresser à des amis dont l’exemple et les conseils pussent favoriser un si louable dessein. L’indifférence était donc bannie de son âme et on pouvait le regarder comme en pleine voie de retour. Nous serions mieux édifiés sur ses dispositions intérieures, si nous avions pu retrouver une lettre qu’il envoyait à son père pour une tierce personne et sur laquelle il attirait cependant son attention, par les paroles suivantes :« Ce paquet renferme une lettre pour mon oncle Bourgeois, que je te prie de lui faire parvenir. Je désirerais que tu en prisses connaissance sans trop t’étonner et surtout sans croire que je n’y suis pas sincère. Il y a tant de faces dans le cœur de l’homme, que l’on y peut voir les choses les plus contraires. »
Qu’est-ce donc que cet épanchement, dans lequel il se révèle à son oncle sous un jour tout nouveau pour son propre père, et dont il veut avoir ce même père pour témoin ? On le devinera, lorsqu’on saura que l’oncle Bourgeois était un parfait chrétien, esprit distingué d’ailleurs et d’une certaine valeur scientifique. Alexis espérait sans doute faire, par ce moyen, parvenir à son père des réflexions qui, bien nouvelles pour lui-même, seraient accueillies avec bonheur par son oncle, mais qui ne pouvaient sans préparation être adressées à celui des trois qui avait le plus besoin de s’en pénétrer.
On le connaît, ce semble, maintenant, non-seulement par les témoignages si unanimes de ses compagnons d’enfance et de jeunesse, mais encore par la vivante image qu’il a laissée de lui-même dans ces lettres à son père dont nous venons de citer quelques fragments.
Nature transparente, au reste, sans le moindre repli, loyale et généreuse au possible, toute de flamme. Malgré bien des pages perdues et qui ne se retrouveront probablement pas, sa vie nous apparaît déjà comme un livre ouvert où tout le monde peut lire couramment, et où le sens des choses se révèle sans le secours d’aucun commentaire.
En parcourant ses papiers, j’ai rencontré une note singulière, d’une écriture inconnue et qui ne reparaît pas dans les pièces de sa volumineuse correspondance. Est-ce une somnambule qui a griffonné cela ? Est-ce quelqu’un qui se piquait de déchiffrer le caractère des gens et de lire leur destinée dans quelques lignes de leur écriture ? Un honnête homme se prête quelquefois, ne fût-ce que par jeu, à ces tentatives de divination, et si la pièce est réussie, on la jette dans ses cartons et on la garde à titre de curiosité et de souvenir.
Quoi que cela puisse être, voici plusieurs traits qui caractérisent assez bien l’original et qu’on me permettra de citer :
« Actif, énergique, impressionnable, irritable ; très-entreprenant, faisant les choses avec enthousiasme et se décourageant néanmoins. Besoin d’être soutenu par les autres. » — Sans doute, mais sachant aussi se soutenir par lui-même, lorsque tout appui extérieur vient à lui manquer, et luttant avec courage contre le découragement.
« Beaucoup de spontanéité, flottant, ne se décide pas de suite ; passions vives, facile à s’emporter. »Il y a de l’un et de l’autre dans ceci, mais plus de vrai que de faux.
« Voix brève et saccadée par instants. » Fort bien. « Idées excentriques et fantasques. » Vrai encore, avec cette réserve que l’imagination folâtre et fantasque était dominée par un grand bon sens. « Aura des chicanes et procès. » Sur ce point la sagacité de notre devin est tout à fait en défaut ; Alexis ne pouvait avoir de procès par la raison toute simple que sa bourse peu garnie était ouverte à tout le monde, et à qui lui aurait demandé deux, il aurait donné trois et plus encore.
« Franchise accentuée, exagérée quelquefois. » à merveille.
« II a dû voyager beaucoup et des voyages lointains. » Je soupçonne que cela n’a pas été dit par divination pure et simple, mais à l’aide de certaines inductions faciles à saisir.
« Vie agitée, perturbation dans les affaires (pas plus d’affaires que de procès). Chances heureuses parfois, mais n’en tirant pas tout le parti possible.
« Rendant service aux amis et dévoué. »
Oui, et nous en verrons plus d’une preuve.
Enfin, un dernier trait, quasi-prophétique celui-là :
« Courra divers périls violents. » Comment le devin a-t-il su cela ? Probablement par de très-vagues conjectures et qui auraient bien pu ne se réaliser jamais.
Cependant, étant donné le caractère si bien trempé de notre héros, une certaine philosophie chrétienne pouvait amener à conclure que la Providence lui réservait sans doute des épreuves à la hauteur de son énergie et de son courage.
A brebis tondue
Dieu ménage le vent.
C’est un vieux proverbe, et qui a du bon, car il rassure et console ceux qui ne se sentent pas suffisamment armés pour les luttes de la vie.
Mais, en revanche, par une raison toute semblable, aux forts les grandes et fortes épreuves ! A ce compte, notre Alexis devait s’attendre à rencontrer combats et tempêtes.
oOo
[2] Archives du ministère de la marine.
Notes additionnelles
Les notes situées en bas de page sont de l’auteur (par ordre numérique)
Les notes additionnelles situées en fin de chapitre sont de la rédaction du weblog http://alexisclercmartyr.hautetfort.com/ (par ordre alphabétique)
[a] « Depuis longtemps, insatisfait de cette inaction paisible, j'ai l'esprit hanté du désir de me battre ou d'entreprendre une action d'éclat »Virgile, Eneide, chant IX, 186-187.
[b] « Je suis homme et rien de ce qui touche à un homme ne m’est étranger » Térence, L’homme qui se punit lui-même, Acte I, scène 1.
[c] Tacite, Vie d’Agricola, Chap. iii.
12:26 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0)
03/03/2013
Journées de Mai 1871 à la Grande Roquette
LES COQUILLES DU DOCUMENT PDF ONT ETE CORRIGEES
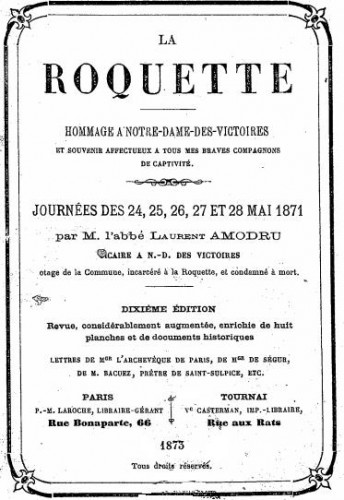
L'abbé Laurent AMODRU fut otage de la Commune, incarceré à la Roquette et condamné à mort. Il pu échapper à ses bourreaux. En 1873, il publie un ouvrage intitulé La Roquette dans lequel il retrace les journées des 24, 25, 26, 27 et 28 mai.
Outre l'intérêt de ce témoignage, l'ouvrage propose de nombreux plans de quartier ou de la prison, qui sont aujourd'hui fort précieux : la prison ayant été détruite et le plan du quartier quelque peu transformé.
A noter que l'endroit où les corps de Mgr Darbois, des Pères Clerc et Ducoudray, de l'abbé Deguerry, de l'abbé Allard ainsi que de Mr Bonjean ont été déposé au cimetière du Père Lachaise est clairement identifié. Il correspond à l'angle sud-est du cimetière et jouxte l'actuel "Mur des fédérés".

Nous donnons ici un extrait de l'ouvrage et quelques illustrations des plus significatives (fichier PDF a trouver ici : La_Roquette journees mai 1871.pdf)
17:25 Publié dans Biographie, Commune de 1871 | Lien permanent | Commentaires (0)



