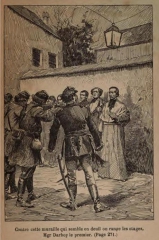24/12/2014
Abbé Escalle : Rapport sur la mort des otages
RAPPORT
SUR LA
MORT DES OTAGES
DE LA COMMUNE
Adressé le 3 juin 1871
A M. LE GÉNÉRAL DE LADMIRAULT
Commandant le 1er Corps de l’Armée de Versailles
PAR L’ABBÉ ESCALLE
Aumônier militaire
Chargé du Service religieux du 1er corps.
PARIS – IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT – 1874
oOo
Cédant aux désirs de quelques personnes qui m’ont souvent demandé un récit de la mort des otages, je fais imprimer ce rapport tel que les journaux le publièrent quelques jours après la défaite de l’insurrection. Écrit, je puis le dire, sur les lieux encore humides du sang des malheureux otages, en présence de leurs cadavres et d’après le témoignage de témoins oculaires, je n’essaie ni de le compléter, ni de le rectifier. Les débats auxquels ces crimes ont donné lieu devant les conseils de guerre ont mis en évidence certaines culpabilités, révélé certaines circonstances extérieures, mais ils n’ont, sur les crimes eux-mêmes, ajouté que très-peu de renseignements à ceux mentionnés dans ce rapport.
Les quelques mots que j’ai placés dans la bouche de l’archevêque de Paris résument fidèlement, et quant au sens et quant aux expressions elles-mêmes, les paroles prononcées par l’illustre victime. Elles ont été dites, soit clans le chemin de ronde, soit au pied du mur d’enceinte. Je les ai recueillies en écoutant l’interrogatoire de Virigg et les accablantes dépositions sur lesquelles il fut jugé quelques heures après notre entrée à la Roquette.
Il est certain maintenant que les victimes du massacre du vendredi 26 ne quittèrent la Roquette que deux ou trois heures avant l’assassinat et furent conduites par le boulevard de Ménilmontant, la rue de Belleville (alors rue de Paris) et la rue Haxo jusque sur le lieu du crime. Le temps d’arrêt d’une demi-heure à la Mairie et le rôle odieux joué par Ranvier sont également certains. Les détails donnés dans le rapport sur l’attitude des victimes dans la rue Haxo et celle de la foule avant et après l’assassinat viennent de témoins oculaires et sont absolument exacts. Je n’ai pu savoir ce qui s’est passé dans le fatal enclos de la cité Vincennes : aucune des victimes n’a survécu, et quant aux témoins, s’il y eut de simples témoins, ils auraient trop de peine à se distinguer des coupables pour ne pas rester silencieux.
Il n’est pas probable que nous en sachions jamais davantage sur ces massacres, épisode terrible entre tous de la plus terrible des guerres civiles. Peut-être vaut-il mieux que Dieu, dans sa justice tempérée de miséricorde, prononce seul sur la culpabilité des assassins et le mérite des victimes, et que le secret de tant de barbarie, d’égarement, de résignation et de souffrance reste à jamais enseveli dans son sein ! Nonne hoec condita sunt apud me, et signala in thesauris meis ? (Deut., 32.)[1]
A. E.
Paris, 31 mai 1874.
oOo
RAPPORT
Adressé le 3 juin 1871
A M. LE GÉNÉRAL DE LADMIRAULT
Commandant le 1er corps de l’armée de Versailles
PAR L’ABBÉ ESCALLE
aumônier militaire, chargé du service religieux du 1er corps.
—————
Mon Général,
Dans les journées du dimanche 28 et du lundi 29 mai, je me suis occupé, d’après vos ordres ? de retrouver les restes des otages mis à mort dans le courant de la semaine et de leur faire donner une sépulture chrétienne. J’ai l’honneur de vous adresser le rapport que vous avez bien voulu me demander à ce sujet, ainsi que les détails que j’ai pu recueillir sur ces odieux assassinats.
Dès les premiers jours de notre entrée dans Paris, je fus informé qu’un certain nombre d’otages, parmi lesquels l’archevêque de Paris, avaient été transférés de la prison de Mazas dans celle de la Roquette. Tout en remplissant mes devoirs d’aumônier militaire, je désirais me trouver avec les troupes qui opéraient dans cette direction ; j’espérais me rendre utile si quelque démarche pouvait être tentée encore pour la délivrance des prisonniers.
Le samedi 27 mai, à midi, je quittai le 1er corps et vins me mettre à la disposition de l’amiral Bruat, dont la division s’approchait en ce moment de la prison où les otages étaient détenus. Ce n’est que le lendemain dimanche, à quatre heures du matin, que nos soldats s’emparèrent de la Roquette. En y entrant nous acquîmes la douloureuse conviction que monseigneur l’archevêque de Paris ; M. le Président Bonjean, M. l’abbé Deguerry et un grand nombre d’autres otages avaient été mis à mort.
Les premiers renseignements que me fournirent les gardiens et d’autres personnes appartenant au personnel administratif de la prison m’apprirent qu’il y avait eu trois massacres d’otages ; un premier commis dans la prison elle-même le mercredi 24 mai, vers huit heures et demie du soir, un autre à Belleville le vendredi 26, à une heure que je ne pouvais encore déterminer, un troisième enfin la veille même, samedi 27, à six heures du soir, sous les murs de la prison, dans l’espace ouvert qui sépare le Dépôt des condamnés de la prison des jeunes détenus.
Ce sont les victimes de ce dernier assassinat que je retrouvais et que je fis exhumer les premières.
Meurtres du samedi 27 mai.
————
Tandis que nos troupes mettaient en liberté cent soixante neuf otages et écrouaient leurs propres prisonniers, quelques habitants du quartier, attirés par mes vêtements ecclésiastiques, vinrent m’apprendre que plusieurs otages, parmi lesquels devaient se trouver des prêtres, avaient été massacrés la veille au soir, au moment où ils venaient de franchir la porte du Dépôt des condamnés. Ils me désignaient en même temps, sur l’emplacement où bivouaquaient quelques soldats du génie, le lieu où s’était commis le crime.
Une fouille pratiquée aussitôt, nous fit découvrir, sous quelques centimètres de terre fraîchement remuée, quatre cadavres. Malgré de graves mutilations et de nombreuses meurtrissures, je n’eus aucune peine à reconnaître le corps de Mgr Surat, protonotaire apostolique et premier vicaire général de l’archevêque de Paris. Un autre cadavre était celui de M. Bécourt, curé de Bonne-Nouvelle : les deux autres étaient ceux d’un laïque qu’on a su depuis être employé de la préfecture.de la Seine, M. Charles Chaulieu, et d’une autre personne dont nous ne pûmes alors constater l’identité[2].
Je fis déposer ces corps dans une salle de la Maison des jeunes détenus et je pris les dispositions nécessaires pour que les familles intéressées fussent promptement averties.
Malheureusement, ce n’étaient pas là les seules victimes des misérables qu’avaient à combattre nos soldats. Au dire des habitants du voisinage, les victimes que nous venions d’exhumer avaient été assassinées dans un certain tumulte : six malheureux otages, délivrés par la pitié des gardiens, et voulant fuir une mort certaine, avaient franchi les portes de leur prison. Mais mal déguisés, connaissant peu les lieux, deux seulement étaient parvenus à sauver leur vie[3]. Les quatre autres, reconnus après avoir fait à peine quelques pas, étaient immédiatement tombés sous les balles, à la place même où nous venions de retrouver leurs corps. Les meurtres du 24 et du 26 avaient été commis plus froidement et dans des circonstances tellement révoltantes, que les témoignages les plus irréfragables ont pu seuls m’amener à y ajouter foi.
Meurtres du mercredi 24 mai.
————
Parmi les prisonniers que nos soldats amenaient en grand nombre à la Roquette, il en était un que les gardiens se désignaient avec horreur : c’était un homme en blouse, de taille moyenne, maigre, nerveux, d’une physionomie dure et froide et qui paraissait âgé d’environ trente ans. D’après ce qui se disait autour de lui, cet homme aurait commandé le peloton d’exécution des victimes du 24 et achevé de sa main l’archevêque de Paris. Interrogé minutieusement en ma présence par le commissaire civil attaché à l’armée, accablé par de nombreux témoignages, il fut, en effet, convaincu de ce crime et sommairement passé par les armes. Il s’appelait Virigg, commandait une compagnie dans le 180e bataillon de la garde nationale et se disait né à Spickeren (Moselle).
Voici ce qui s’était passé :
Le mercredi 24, un détachement commandé par ce misérable s’était présenté au Dépôt des condamnés, demandant six détenus, qui lui furent livrés, je n’ai point su ni sur quel ordre ni par qui. Ces six détenus furent appelés l’un après l’autre dans l’ordre des cellules qu’ils occupaient. C’étaient : —Cellule n° 1, M. le premier président Bonjean ; — cellule n° 4, M. l’abbé Deguerry ; — cellule n° 6, le P. Clerc, de la Compagnie de Jésus, ancien lieutenant de vaisseau ; — cellule n° 7, le P. Dncoudray, supérieur de la maison de Sainte-Geneviève ; — cellule n° 12, M. l’abbé Allard, un prêtre dévoué du clergé de Paris, dont on avait admiré le courage et le zèle au service des ambulances, et enfin, cellule n° 27, Mgr l’archevêque de Paris.
Les victimes, en quittant leurs cellules situées au premier étage, descendirent une à une et se rencontrèrent au bas de l’escalier : elles s’embrassèrent et s’entretinrent quelques instants, parmi les injures les plus grossières et les plus révoltantes[4]. Deux témoins oculaires me dirent, qu’au moment où ils avaient vu passer le cortège, M. Allard marchait en avant, les mains jointes, dans une attitude de prière ; puis Mgr Darboy, donnant le bras à M. Bonjean, et derrière, le vieillard vénéré que nous connaissions tous, M. Deguerry, soutenu par le P. Ducoudray et le P. Clerc.
Les fédérés, l’arme chargée, accompagnaient en désordre. Parmi eux se trouvaient deux Vengeurs de la République ; çà et là des gardiens tenant des falots, car la soirée était avancée : on marchait entre de hautes murailles, et le ciel couvert de nuages était encore assombri par la- fumée des incendies qui brûlaient dans Paris. Le cortège arriva ainsi dans le second chemin extérieur de ronde, sur le lieu choisi pour l’exécution.
On rapporte diversement les paroles qu’aurait prononcées Mgr Darboy. Les témoignages sont unanimes à le représenter disant à ces misérables « qu’ils allaient commettre un odieux assassinat, — qu’il avait toujours voulu la paix et la conciliation, — qu’il avait en vain écrit à Versailles, — qu’il n’avait jamais été contraire à la vraie liberté ; — que, du reste, il était résigné à mourir, s’en remettant à la volonté de Dieu et pardonnant à ses bourreaux. »
Ces paroles étaient à peine dites, que le peloton fit indistinctement feu sur les victimes placées le long du mur d’enceinte. Ce fut un feu très-irrégulier, qui n’abattit pas tous les otages. Ceux qui n’étaient pas tombés essuyèrent une seconde décharge, après laquelle Mgr Darboy fut encore aperçu debout les mains élevées. C’est alors que le misérable qui présidait à ces assassinats s’approcha et tira à bout portant sur l’archevêque. La vénérable victime s’affaissa sur elle-même : il était huit heures et vingt minutes du soir.
Les corps des six otages arrivèrent vers trois heures du matin au cimetière du Père-Lachaise et furent enfouis pêle-mêle, sans suaires et sans cercueils, à l’extrémité d’une tranchée ouverte tout à fait à l’angle sud-est du cimetière.
C’est là, qu’après avoir rendu les derniers devoirs aux quatre victimes tuées la veille (samedi soir), je me rendis vers huit heures du matin. Une brigade d’infanterie de marine occupait le cimetière et nous entendions, non loin de nous, la fusillade des troupes du 1er corps s’emparant des hauteurs de Belleville. Je ne pensai pas qu’il fallût surseoir un seul instant à l’exhumation des restes mortels qui gisaient dans la terre, sans sépulture depuis trois jours. L’amiral Bruat partagea cet avis ; et, aidé d’un petit nombre de personnes[5], je pratiquai les fouilles nécessaires. Nous retrouvâmes les corps sous l m 50 de terre, détrempée par les pluies des jours précédents, et je les mis dans les cercueils que j’avais pu me procurer.
Le corps de Monseigneur était revêtu d’une soutane violette toute lacérée. Il était dépouillé de ses insignes ordinaires : ni croix pectorale, ni anneau épiscopal. Son chapeau avait été jeté à côté du corps dans la terre, le gland d’or avait, disparu. La tête avait été épargnée par les balles ; plusieurs phalanges des doigts étaient meurtries. Les corps de M. Bonjean, du P. Ducoudray et des autres victimes portaient des traces de traitements odieux. Le premier avait les jambes brisées en plusieurs endroits ; le second avait la partie droite du crâne absolument broyée.
Je fis transporter rue de Sèvres, 35, les corps du P. Ducoudray et du P. Clerc ; on déposa dans la chapelle du cimetière ceux de M. Bonjean et de l’abbé Allard ; enfin j’accompagnai moi-même à l’archevêché, sous l’escorte d’une compagnie d’infanterie de marine, ceux de Mgr Darboy et de l’abbé Deguerry.
Ce n’est que le lendemain, lundi 29 mai, que je pus me mettre à la recherche des victimes du 26.
Meurtres du vendredi 26 mai.
————
Des renseignements recueillis la veille à la Roquette m’avaient appris que, dans la soirée du jeudi 28 mai, quatorze ecclésiastiques et trente-six[6] gardes de Paris avaient été extraits de cette prison et conduits à Belleville, où des bandes de fédérés les auraient fusillés en masse le lendemain. On savait vaguement que l’assassinat avait eu lieu quelque part sur le plateau de Saint-Fargeau.
Quand j’arrivai le lundi matin à Belleville, nos troupes procédaient au désarmement de ce quartier, encore très-agité. Nos propres soldats ne pouvaient me donner aucune information, et ce n’est qu’à grand’peine que les habitants, pleins de défiances et de colères, consentaient à parler. Je ne tardai pas cependant à acquérir la conviction que le massacre avait eu lieu rue Haxo, dans un emplacement appelé la cité Vincennes.
Je demandai au colonel de Valette, commandant les volontaires de Seine-et-Oise, quelques officiers de bonne volonté, et nous nous rendîmes sur le théâtre de ce nouvel attentat. MM. Lorras, chef du contentieux de la Compagnie d’Orléans, et le docteur Colombel, tous deux comptant de leurs parents au nombre des victimes, s’étaient joints à nous.
L’entrée de la cité Vincennes est au n° 83 de la rue Haxo : on y pénètre en traversant un petit jardin potager ; vient ensuite une grande cour précédant un corps de logis de peu d’apparence dans lequel les insurgés avaient établi un quartier-général. Au delà et à gauche, se trouve un second enclos qu’on aménageait pour recevoir une salle de bal champêtre, quand la guerre éclata. A quelques mètres en avant d’un des murs de clôture, règne, en effet, jusqu’à hauteur d’appui, un soubassement en briques destiné à recevoir un des treillis qui devaient former la salle de bal. L’espace compris entre ce soubassement et le mur de clôture forme comme une large tranchée de dix à quinze mètres de longueur. Un soupirail carré, donnant sur une cave, s’ouvre au milieu.
C’est dans cette cave que nous trouvâmes entassés en un seul monceau les cadavres de cinquante-deux victimes. Je donnai l’ordre de les retirer, et c’est sur les lieux mêmes et pendant que nous accomplissions ce pieux devoir que je pus recueillir, en contrôlant les uns par les autres plusieurs témoignages, les renseignements qui suivent sur le crime du 26.
Je n’ai pu savoir exactement en quel lieu les prisonniers, en les supposant sortis le 25 de la Roquette, auraient passé la nuit suivante et une partie de la journée du 26[7]. Quoiqu’il en soit, ce jour-là, entre cinq et six heures du soir, les habitants de Belleville les voyaient défiler dans la rue de Paris. Ils étaient précédés de tambours et de clairons marquant bruyamment une marche et entourés de gardes nationaux.
Ces fédérés appartenaient à divers bataillons : les plus nombreux faisaient partie d’un bataillon du XIe arrondissement et d’un bataillon du Ve. On remarquait surtout un grand nombre de bandits appartenant à ce qu’on nommait les Enfants perdus de Bergeret, troupe sinistre parmi ces hommes sinistres : c’est elle qui, selon tous les témoignages, a pris la part la plus active à ce qui va se passer.
Ainsi accompagnés, les otages montaient la rue de Paris parmi les huées et les injures de la foule. Quelques malheureuses femmes semblaient, en proie à une exaltation extraordinaire et se faisaient remarquer par des insultes plus furieuses et plus acharnées. Un groupe de gardes de Paris marchait en tête des otages, puis venaient des prêtres, puis un second groupe de gardes. Arrivé au sommet de la rue de Paris, ce triste cortège sembla hésiter un instant, puis tourna à droite et pénétra dans la rue Haxo.
Cette rue, surtout les terrains vagues qui sont aux abords de la cité Vincennes, était remplie d’une foule manifestant les plus violentes et les plus haineuses passions. Les otages la traversaient avec calme ; quelques-uns, surtout des prêtres, le visage meurtri et sanglant. Victimes et assassins pénétrèrent dans l’enclos.
Un cavalier qui suivait fit caracoler un instant son cheval aux applaudissements de la foule, et entra à son tour en s’écriant : « Voilà une bonne capture. Fusillez-les. » Avec lui, et lui serrant les mains, entra un homme jeune encore, élégamment vêtu. Ce misérable, qui paraissait être d’une éducation supérieure à celle de ceux qui l’entouraient, exerçait une certaine autorité sur la foule. Comme le premier, il suivait les otages, et comme lui il excitait la foule en s’écriant : « Oui, mes amis, courage, fusillez-les ! »
L’enclos était déjà occupé par les états-majors des diverses légions. Les otages et les bandits qui leur faisaient cortège achevèrent de le remplir. Très-peu de personnes, faisant partie de la foule massée aux alentours, purent pénétrer à l’intérieur. En tout cas, aucun témoin ne voulut m’avouer avoir vu ce qui s’était passé dans l’enclos.
Pendant dix minutes à un quart d’heure, on entendit du dehors des détonations sourdes, mêlées de cris tumultueux. Il paraît certain que les victimes, une fois poussées et parquées dans la tranchée dont j’ai parlé plus haut, furent assassinées en masse à coups de revolver par tous les misérables qui se trouvaient sur les lieux. On n’entendit que très-peu de coups de chassepots. Il y eut à la fin quelques détonations isolées, suivies de quelques instants de silence.
Un homme en blouse et en chapeau gris, portant un fusil en bandoulière, sortit alors du jardin. A sa vue, la foule applaudit avec transport ; de jeunes femmes vinrent lui presser les mains et lui frapper amicalement sur l’épaule : « Bravo ! bien travaillé, mon ami ! »
Les corps des cinquante-deux victimes furent jetés dans la cave : les prêtres d’abord, puis les gardes de Paris[8].
C’est de là, qu’avec beaucoup de peine et en prenant toutes les précautions qu’exigeait la salubrité publique, nous avons retiré tous les cadavres. Malgré l’état de putréfaction avancée dans lequel nous les avons trouvés, il nous a été possible de reconnaître la plupart des prêtres. De pauvres femmes arrivées dans la soirée, reconnurent les corps de quelques-uns des gendarmes et des gardes : leurs maris.
Nous fîmes transporter le soir à Paris les corps du père Olivaint, du père de Bengy, du père Caubert, tous les trois jésuites de la rue de Sèvres ; de M. l’abbé Planchat, directeur d’une maison d’orphelins à Charonne, et de M. Seigneret, jeune séminariste de Saint-Sulpice. Les autres corps ont été mis dans des cercueils et inhumés chrétiennement, soit par les membres de leurs familles, soit par les soins du clergé de Belleville.
En terminant, mon général, permettez-moi d’exprimer ma très-vive reconnaissance pour le concours ému et pieux que m’ont prêté tous les officiers et soldats avec lesquels ces tristes circonstances m’ont mis en relation. Je me permets aussi de signaler à votre attention le dévouement exceptionnel des militaires dont je joins les noms à ce rapport.
Veuillez, mon général, agréer l’hommage de mon profond respect.
Votre très-humble serviteur,
A. ESCALLE,
Aumônier militaire, chargé du service
religieux du 1er corps.
Quartier général du 1er corps de l’armée de Versailles, Paris, 3 juin 1871.
[1] « Cela n’est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors ? »(Deut, XXXII, 34) [ndlr]
[2] C’était le R. P. Houillon, des Missions étrangères.
[3] M. l’abbé Bayle, vicaire général, et M, l’abbé Petit, secrétaire général de l’archevêché.
[4] Les épithètes de canaille, de crapule étaient celles qui revenaient le plus souvent sur les lèvres de ces misérables et dont ils poursuivirent jusqu’à la fin les illustres victimes. L’un des assassins fut lui-même révolté par ces injures et dit brusquement « qu’ils n’étaient pas là pour eng... les prêtres, mais pour les fusiller. » Le père Ducoudray avait ouvert sa soutane sur sa poitrine pour se communier, car plusieurs prêtres portaient sur eux la Sainte Eucharistie. Ces détails paraissent certains.
[5] M. l’abbé Thévenot, jeune séminariste plein de dévouement et de bravoure, qui accompagnait comme infirmier la division Bruat. M. l’abbé Lacroix, vicaire à Billancourt, qui demanda à se joindre à nous quand nous commencions les fouilles, et quelques soldats d’infanterie de marine.
[6]J’ai pris ces chiffres sur le carnet du gardien de la prison qui a fait l’appel des otages. En réalité, onze ecclésiastiques, trente-sept gardes de Paris et quatre otages civils ont été massacrés à la Roquette. La circonstance que la plupart des prêtres étaient vêtus en laïques explique l’erreur des gardiens de la prison quant à la qualité des otages. Quant au nombre, je crois que cinquante seulement sont sortis de la Roquette. Il peut se faire que deux malheureux prisonniers aient été adjoints aux otages de la Roquette, soit à la mairie de Belleville, soit au quartier général de la rue Haxo.
[7] Les dépositions orales des gardiens de la prison de la Roquette me donnaient unanimement cette date du jeudi 25. Elle est maintenue dans une lettre écrite par l’un deux et citée dans le Figaro du 2 juin. Les otages délivrés parlent, au contraire, du 26. J’ai sous les yeux le journal de l’un d’eux, d’après lequel il se serait entretenu avec différentes victimes dans la matinée du vendredi. Il ne paraît pas d’ailleurs que les victimes soient sorties de la Roquette en deux groupes séparés. Je n’ai su comment concilier ces versions différentes de ce qui parait être un même fait.
[8] Voici les noms de ces cinquante-deux otages.
Ecclésiastiques :
Les pères Olivaint, Caubert, de Bengy, tous trois de la Compagnie de Jésus. Les pères Radigue, Tuffler, Rouchouze, Tardieu, de la Maison de Picpus. MM. Planchat, Sabatier, Benoit, Seigneret, du clergé de Paris ; le dernier, jeune séminariste de Saint-Sulpice.
Gardes de Paris et gendarmes :
MM. Bermond, Biollan, Breton, Burlotti, Bianchardini, Bodin, Bellamy, Carlotti, Chapuis, Cousin, Colombain, Coudeville, Ducros, Dupré, Doublet, Fischer, Fourès, Geanty, Cavodct, Keller, Mannoni, Marchetti, Marguerite, Marty, Mouillie, Mougenot, Millotte, Poirot, Paul, Pons, Pauly, Pourtot, Riolland, Valder, Vallette, Villemin, Weiss.
Les otages civils étaient :
MM. Deverte, Largillière, Ruault et Greff.
16:43 Publié dans Commune de 1871 | Lien permanent | Commentaires (0)
30/11/2014
A propos d'une fausse relique
Nous donnons ici un court texte d'E. Misset - et à titre anecdotique - au sujet de la prétendue port N°21 de la prison de Mazas qu'aurait occupé Mgr Darboy, avant son transfert à la prison de la grande Roquette. Il s'agit d'une enquête méticuleuse et fort bien menée.
Au-delà de l'anecdote, ce texte présente un double intérêt :
1. Il restitue quelles étaient les conditions de détention à Mazas et en quoi pouvait consister la vie quotidienne des otages.
2. Il montre quelles sortes d'histoires étaient véhiculées à l'époque où le discernement cédait souvent la place à l'empressement. Le mérite de l'auteur est de garder la tête froide et de restituer les faits dans leur rigueur sèche.
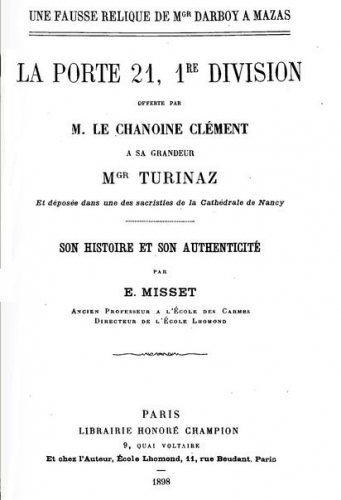
LA PORTE 21, 1ère DIVISION
OFFERTE PAR
M. LE CHANOINE CLEMENT
A SA GRANDEUR
MGR TURINAZ
I
Sitôt que la démolition de Mazas fut décidée, M. le chanoine Clément, directeur de l’école Gerson, résolut d’acheter la porte de la cellule où Mgr Darboy avait été enfermé en 1871. C’était une pieuse pensée. En conséquence, il dépêchait à la prison, dès le 30 juillet, à la première heure, exactement à sept heures du matin, un représentant de la maison Guy (51, avenue de Villiers) pour « faire livrer à l’école Gerson, 31, rue de la Pompe, la porte 21, première division. »
M. le chanoine Clément devança ainsi tous ses concurrents, même Son Eminence. Pour avoir fait vite, il avait fait vite.
Il commanda également ce même jour les portes :
11, troisième division ;
19, troisième division ;
21 , troisième division ;
30, troisième division.
Le mercredi 3 août, il commanda en outre les portes :
9, troisième division
et 23, troisième division.
Non content d’acheter vite, il voulait acheter beaucoup. Sans doute toutes ses demandes ne purent pas être satisfaites. Mais il eut livraison de la porte 21, première division. C’était pour lui l’important.
Aussitôt le Figaro du 3 août, dans un entrefilet évidemment communiqué, enregistra l’acquisition de la cellule de Mgr Darboy par l’école Gerson. Le Gaulois du 4 août imprima de son côté :laporte de la cellule de Mgr Darboy a été acquise par l’école Gerson, à Passy. Et M. le chanoine Clément put écrire, non sans quelque satisfaction, à la date du 3 août :« J’ai offert au cardinal de Parislaporte de Mgr Darboy. »
Ces premiers jours d’août furent des jours de gloire pour la porte 21, première division. Elle était la seule, l’unique, l’indiscutée. Elle triomphait sans conteste, et le nom de son heureux acquéreur était répété par toutes les feuilles publiques. Ce triomphe, hélas !devait être éphémère.
Le 10 août, M. l’abbé Odelin, vicaire général de Paris, s’aperçut en effet, fort à propos, que la porte offerte à Son Eminence était — comment dirai-je ? — d’une authenticité plutôt approximative. A la suite d’une conversation avec un ancien otage, M. l’abbé Delfau, second vicaire de Saint-Augustin (je le tiens de M. Delfau lui-même) il obtint la certitude que Mgr Darboy avait été enfermé, non pas dans la première division, mais dans la sixième. Cette découverte préliminaire, relativement facile et grave, en amena une seconde beaucoup plus importante. Sur les indications de M. Delfau, M. Odelin alla trouver l’ancien médecin de Mazas, le vénérable M. de Beauvais, qui a visité si souvent Mgr Darboy dans sa cellule et qui a conservé, avec la lucidité parfaite de ses souvenirs, des notes extrêmement précieuses, contemporaines des événements. M. Odelin obtint ainsi (je ne crains pas d’être contredit) le numéro exact de la cellule de l’Archevêque. C’était le n° 62. En conséquence, le cardinal Richard, à qui la porte 21, première division, avait été gracieusement offerte sept jours auparavant (ainsi que nous l’avons dit) acheta la porte 62, sixième division, et rendit à son premier et légitime propriétaire, à M. le chanoine Clément, la libre « disposition » de la porte 21, première division.
Ce fut un rude coup pour la porte 21. Ses beaux jours étaient passés. Elle avait une rivale.
Sans doute, on ne dit pas en haut lieu à M. le chanoine Clément :« Votre porte est fausse, nous en sommes sûrs, gardez-la. » On était certain de l’authenticité de la porte 62 ; on n’avait ni à contester ni à démontrer celle de la porte 21. Ce soin incombait tout entier à M. le Chanoine et à sa perspicacité.
A ce moment, en effet, il fallait opter entre deux systèmes. L’un était radical et net : déclarer fausse, ou tout au moins douteuse, la porte 21, première division, et n’en plus parler. C’était, croyons-nous, le seul acceptable en l’occurrence, car une relique douteuse n’est pas une relique, et, lorsqu’il s’agit d’une porte de prison, le douteux confine à l’horrible.
M. le chanoine Clément préféra prendre un biais. (Les biais ont quelquefois du bon... — pas toujours, malheureusement !) Il se dit :« L’Archevêché a une porte qui est certainement authentique. Mais, moi aussi, j’ai une porte, achetée avant celle de l’Archevêché. Pourquoi ma porte ne serait-elle pas authentique aussi ? Pourquoi Mgr Darboy n’aurait-il pas occupé deux cellules à Mazas ? J’ai lu « dans la Vie du Prélat » que son médecin avait dû le faire transporter de sa cellule primitive dans une cellule « plus large et mieux aérée. » — Voilà l’affaire. Je possède la porte de la cellule moins large ;l’Archevêché, celle de la cellule plus, large. C’est évident. »
On reconnaîtra sans peine, avec moi, qu’avant de prendre une conclusion ferme, surtout dans une matière aussi délicate, il eût été élémentaire d’interroger sur ce point M. de Beauvais, ainsi que l’avait fait M. Odelin avec tant de succès. Mais, hélas ! M. le chanoine Clément n’y pensa pas ; ou, s’il y pensa, il ne le fit pas ; ou, s’il le fit, il passa outre.
Il conclut donc résolument de l’existence d’une double porte à l’existence d’une double cellule. Et aussitôt les journaux qui, dix jours auparavant, parlaient de la cellule unique de Mgr Darboy, achetée par M. le chanoine Clément et par l’école Gerson, parlèrent, comme par enchantement, de la double cellule du Prélat. C’était habile. Etait-ce vrai ?
Nousavons dit, imprimait le Gaulois, à la date du 15 août, que le cardinal Richard avait manifesté l’intention d’acquérir les portes des cellules qui furent occupées à la prison de Mazas, pendant la Commune, par Mgr Darboy et par l’abbé Deguerry, et que cette dernière seule avait pu lui être réservée, la première ayant été acquise par l’école Gerson.
Depuis lors y MgrRichard a pu acquérir la certitude que Mgr Darboy n’a fait qu’un très court séjour dans la cellule 21 de la première division — celle que l’école Gerson a achetée — et qu’il occupa beaucoup plus longtemps la cellule 62 de la sixième division. En conséquence, le cardinal Richard a acheté la porte de la cellule 62 de la sixième division.
La note est identique pour le fond dans le Figaro du 15 août.
Quand le terrain fut ainsi préparé, M. le chanoine Clément prit un grand parti. On avait refusé sa porte à Paris ; il résolut de la faire accepter en province et de l’offrir à Sa Grandeur MgrTurinaz, évêque de Nancy.
A la date du 17 août, il lui écrivit une lettre dont voici le début :
Monseigneur,
On a découvert qu’il y eut à Mazas deux cellules occupées successivement par Monseigneur Darboy. — M. le Chanoine, on le voit, pose en axiome ce qui est précisément en discussion. — Il continue :La première, celle dont j’ai les débris, était proprement la cellule du condamné. M. le Chanoine oublie qu’il n’y avait pas de condamnés à Mazas, mais seulement des prévenus, et, dans la circonstance, des otages. Il poursuit en racontant (non sans y mettre quelques formes) qu’il a offert sa porte 21 à l’Archevêché et que M. Odelin, de la part de Son Eminence, lui a rendu la libre « disposition » de sa porte 21. C’est, conclut-il, ce qui m’a permis de l’offrir à Votre Grandeur. Je vais la faire emballer et expédier à Nancy. Je ne doute pas que notre Cardinal ne soit heureux de la savoir en votre possession. Et moi, il me sera agréable d’avoir procuré à mon diocèse d’origine cet émouvant et suggestif souvenir.
Les lecteurs à qui ces fragments donneraient le désir de lire la lettre entière la trouveront dans la Semaine religieuse de Nancy et de Toul, n° du 27 août, p. 784.
MgrTurinaz, confiant dans le sens critique de M. le Chanoine, n’eut pas une ombre d’hésitation. Sa Semaine religieuse nous dit en effet :Monseigneur l’Evêque s’est empressé d’accepter ce triste, mais précieux souvenir. Elle poursuit :Les diocésains de Nancy seront reconnaissants de la délicate initiative qui codifie à leur garde respectueusecette porte derrière laquelle leur ancien Evêque et l’illustre victime de la Commune se prépara au sacrifice. L’article se termine par cette promesse :Nous dirons plus tard où cette porte sera conservée. (27 août.)
Ouvrons maintenant la Semaine du 3 septembre. Nous y lisons :
Cette porte est parvenue à l’Evêché le 26 août. Monseigneur l’Evêque l’a fait transporter dans une des sacristies de la cathédrale, ou l’on s’occupe de lui trouver une place définitive[1]. (page 807.)
Hélas !ce n’est pas dans une sacristie de cathédrale que doit « définitivement » trouver place, j’en ai peur, la porte 21 de la première division. Mgr Darboy, l’« illustre victime de la Commune, » ne s’est jamais « préparé à aucun sacrifice derrière cette porte. » Et « ce pieux, ce triste, cet émouvant, ce suggestif souvenir » n’est en réalité (nous allons le démontrer) qu’un bois sans valeur et sans authenticité.
II
Nous demanderons nos preuves, non pas à des ouvrages de seconde main, mais uniquement à des témoins oculaires. Les principaux sont : l’abbé Crozes , ancien aumônier de la Roquette, otage ; il est mort, mais il a laissé des Mémoires[2]. Mgr Déchelette, aujourd’hui vicaire général de Lyon, otage ; il a publié les Souvenirs de sa captivité. M. l’abbé Delfau, second vicaire de Saint-Augustin, otage ; il a tenu pendant sa détention un journal personnel qui lui a permis de me donner une date très importante et très précise. Enfin, le médecin si dévoué de Sa Grandeur à Mazas, aujourd’hui médecin en chef de la Santé, M. le docteur de Beauvais.
Tous ces témoins nous diront que, depuis le premier jour de sa détention jusqu’au dernier, Mgr Darboy fut dans la sixième division. Il y était le 22 mai, les 12, 11 et 10 mai, le 29 avril, le 13 avril et, enfin, le 7 avril au matin. Etant donné qu’il est entré à Mazas le 6 avril au soir et qu’il en est sorti le 22 mai, que peut-on souhaiter de plus ?
Précisons.
Où était Mgr Darboy, le dernier jour de sa détention à Mazas, le jour de son transfert à la Roquette, c’est-à-dire le 22 mai ?
L’abbé Crozes va nous répondre. Grâce au capitaine fédéré Révol, il resta à Mazas le 22 mai, lors du transfert des otages : ce qui lui sauva la vie. « Je m’approche, dit-il,du guichet de ma porte et je regarde par le petit judas... et bientôt je vois passer successivement devant moi les otages de mon corridor (c’est-à-dire de ma division) Mgr Darboy, Mgr Surat, M, Deguerry, M. Bonjean[3], etc. (3° édition, p. 41 ). Or, l’abbé Crozes occupait à Mazas la cellule n° 8 de la sixième division. Il nous le dit lui-même, p. 29. Si donc il a vu passer devant lui, le 22 mai, Mgr Darboy (étant donné que la disposition ‘de Mazas, en éventail, empêchait un prisonnier de sortir autrement que par sa propre division) il faut que Mgr Darboy ait été dans la même division que l’abbé Crozes ; il faut qu’il ait été dans la sixième division.Que vaut, pour cette date, une porte quelconque de la première division ?que vaut la porte 21 ? — Rien.
Remontons. Où était Mgr Darboy dans les premiers jours de mai, du 10 au 12 mai en particulier ?
A cette époque, nous dit encore l’abbé Crozes, le citoyen Miot, membre de la Commune, obtenait du directeur Garreau,pour les otages seulement de ma division, de se promener deux ensemble dans les grands promenoirs de faveur. Ce fut alors que j’eus l’honneur et la consolation de quelques promenades solitaires avec Mgrl’Archevêque. (3eédition, page 33.) EtM.Deguerry,le vénérable curé delà Madeleine, dans une lettre à M. Thiers, datée de Mazas, le 12 mai, précise le témoignage de M. Crozes :La promenade, dit-il, nous étant toléréependant une heure depuis quelques jours[4] ;je viens d’apprendre de Mgr l’Archevêque qu’il est question de l’échanger contre Blanqui. (Mgr Foulon, page 630.) Si l’autorisation de se promener deux à deux fut accordée « seulement » aux otages de la sixième division ; si l’abbé Crozes qui occupait le n° 8 de la sixième division, a pu se promener avecMgrDarboy ;siM. Deguerry qui occupait le n° 68 de celte même division a joui de la même faveur, c’est donc que MgrDarboy occupait alors une cellule de la sixième division. — Que vaut pour les premiers jours de mai, que vaut pour le 12, le 11, le 10 mai une porte quelconque de la première division ?Que vaut la porte 21 ? — Rien.
Remontons plus haut encore, et arrivons au 29 avril. Où était à cette date MgrDarboy ?
Ce n’est pas cette fois l’abbé Crozes, c’est M. l’abbé Delfau qui va nous répondre. Il occupait à Mazas la cellule 25, 3edivision. Or, le samedi 29 avril (son journal permet de préciser la date) M. Delfau était souffrant. Il reçut, à 10 heures du matin, la visite du médecin, M. de Beauvais, qui lui dit :« Je pourrais bien vous faire transporter dans la sixième division, section de l’infirmerie, où se trouve Monseigneur... Mais, réflexion faite, restez ici. » Donc, le 29 avril, à 10 heures du matin. Mgr Darboy était dans la sixième division. Que vaut pour cette date la porte 21 ? — Rien.
Du 29 avril, remontons au 13. Ce jour-là un otage dont M. le chanoine Clément a, je crois, acheté la porte et dont il ne récusera pas, à coup sûr, le témoignage, Mgr Déchelette, vicaire général de Lyon, arrivait à Mazas comme simple séminariste, et était installé, non loin de M. l’abbé Delfau, au 21, 3edivision. Il nous dit en toutes lettres dans ses Souvenirs :« Nous fûmes placés dans la troisième division. Mgr l’Archevêque, M. Bonjean et plusieurs autres otages occupaient la sixième. » (page 20.) — Que vaut donc pour le 13 avril la porte 21, première division ? — Rien.
Remontons encore, et arrivons à la première journée de la détention de Mgr Darboy à Mazas, c’est-à-dire au 7 avril dans la matinée[5]. Nous sommes ici au cœur même de la question et il est important d’être très précis.
MgrDarboy arriva à Mazas, en compagnie de M. Bonjean, à la nuit close, le 6 avril. Il avait probablement dîné au Dépôt. Son premier repas à Mazas eut donc lieu le lendemain, 7, à l’heure ordinaire de la prison, c’est-à-dire vers 10 ou 11 heures. Or, écoutons l’abbé Crozes :Dès le premier repas qu’il fît à Mazas, Mgr Darboy vit bien que la personne qui veillait sur lui était là. (Il s’agit de Mme Coré, qui fut si dévouée à Sa Grandeur.) L’abbé Crozes poursuit :Il envoya un billet à M. Bonjean,son voisin, pour lui demander s’il avait reçu, comme à l’ordinaire, son repas du dehors. (3° édition, p. 143.) Quel que soit le sens qu’il convienne d’attribuer ici au mot « voisin », il nous indique, au minimum, que M. Bonjean et Mgr Darboy étaient dans la même division. Or, où était située la cellule de M. Bonjean ? Aucun doute n’est possible. Elle était située au numéro 14 de la sixième division, La famille de M. Bonjean, lors de la démolition de Mazas, en a pieusement fait acheter la porte et les barreaux. Cela étant, que vaut pour le 7 avril, une porte quelconque de la première division ?que vaut la porte 21 de M. le chanoine Clément et de MgrTurinaz ? — Rien . Elle ne vaut rien pour le 7 avril, rien pour le 13 avril, rien pour le 29 avril, rien pour les 10, 11, et 12 mai, rien pour le 22 mai. C’est M. Crozes, M. Deguerry, M. Delfau, Mgr Déchelette qui nous l’affirment. Voilà une porte bien compromise !
Ce n’est pas M. de Beauvais qui consentira, je le crains, à lui refaire une authenticité ! Et cependant c’est le nom de M. de Beauvais que les partisans d’une double cellule ont mis résolument en avant. Voici en effet le passage textuel de Mgr Foulon dans sa Vie de MgrDarboy :
La santé de Monseigneur, déjà si délicate, était fortement ébranlée, et même le mal avait fait de tels ravages que le médecin en chef de la prison, M. de Beauvais, dut intervenir et déclarer aux geôliers de F Archevêque que, s’ils ne le plaçaient pas dans une autre cellule et s’ils ne luipermettaient pas de suivre un autre régime que celui de Mazas, dans quinze jours ils n’auraient plus entre les mains qu’un cadavre. Cette perspective fit réfléchir les délégués dela Commune. Monseigneur fut donc transféré da ?îs une cellule plus large et mieux aérée. (p. 547.)
C’est bien ce passage, c’est bien cette intervention de M. de Beauvais en faveur de Mgr Darboy « malade » qu’invoque M. le chanoine Clément, pour recommander sa porte 21, dans sa lettre d’envoi à MgrTurinaz :
« M. l’abbé Odelin, affirme-t-il (avec trop de modestie, je crois), a découvert que MgrDarboy, tombé malade, avait été transféré de sa cellule, qui était celle de tous les prisonniers, dans une autre plus vaste. » La découverte, si tant est qu’une erreur puisse s’appeler une découverte, doit avoir un tout autre auteur que M. l’abbé Odelin. Is fecitcuiprodest. Elle est indispensable à M. le chanoine Clément pour sa porte 21. Elle est au contraire très compromettante pour M.Odelin. Quelle porte en effet ce dernier a-t-il achetée ?— La porte de la cellule 62, sixième division. Or, cette cellule était-elle « plus large, plus vaste, mieux aérée » que les autres ? — Non. Je l’ai vue, je l’ai mesurée, j’en ai fait desceller les barreaux : c’était une cellule ordinaire[6], et, pour parler comme M. le Chanoine « celle de tous les prisonniers. » M. Odelin ne me contredira pas.
La question, on le voit, se simplifie de plus en plus et se resserre. M. de Beauvais a-t-il, oui ou non, demandé et obtenu pour MgrDarboy « malade » un changement de cellule ?Tout est là.
Or, grâce à Dieu, M. de Beauvais est vivant. Rien n’est donc plus simple que de l’interroger. C’est ce que j’ai fait. Et, pour ne rien laisser d’imprécis et de vague à mon interview, je lui ai posé respectueusement les simples questions suivantes que j’avais rédigées par écrit :
1° Avez-vous visité Mgr Darboy dans la cellule 21, première division ? — Réponse :Non.
2° L’avez-vous fait changer de division, comme l’affirme Mgr Foulon, et, après lui, M. le chanoine Clément ? — Réponse :Non.
3° L’avez-vous trouvé, lors de votre première visite, dans la cellule 62, sixième division ? — Réponse :Oui ; je l’ai visité fréquemment dans cette cellule, et uniquement dans cette cellule : mes notes en font foi. J’ai vu ces notes.
4° A quelle date l’avez-vous visité pour la première fois ? — Réponse :Certainement dans le courant d’avril.
Est-ce que M. le chanoine Clément n’aurait pas posé par lettre, h la date du 10 octobre, à M. de Beauvais lui-même, des questions à peu près identiques ? Est-ce qu’il n’aurait pas reçu identiquement les mêmes réponses ?
Or ces quatre réponses, nettes, précises, catégoriques, tranchent à tout jamais la question. Si je les ai mal reproduites, qu’on les réfute. Si je les ai bien reproduites — et j’en ai la certitude — elles ont une force contre laquelle on se débattra vainement. Elles sont d’ailleurs corroborées par les souvenirs non moins nets, non moins précis, non moins catégoriques du gardien Pellé, qui fut de service à Mazas en 1871, précisément dans la division de Monseigneur, et qui est aujourd’hui premier gardien à la Santé :« Sa Grandeur, m’a-t-il dit, n’a jamais été qu’à la sixième division et au n° 62. » Elles donnent toute leur valeur aux affirmations de l’abbé Crozes, de l’abbé Deguerry, de l’abbé Delfau, de MgrDéchelette. Elles mettent à néant l’authenticité de la porte 21, première division. C’est désagréable pour M le chanoine Clément et regrettable pour MgrTurinaz. Mais qu’y faire ?
Le lecteur se demandera peut-être comment une erreur de cette envergure a pu prendre naissance et d’où provient le n° 21. Je me le suis demandé moi-même et je suis arrivé à la conjecture que voici : On lit dans une petite brochure sans valeur, signée Ordioni et publiée en 1871, que « MgrDarboy occupait la cellule 21. » Mais Ordioni parlait de la Roquette, et d’ailleurs il faisait erreur, car, à la Roquette, au moment de l’appel des condamnés, MgrDarboy occupait, non pas la cellule 21, mais la cellule 23[7]. N’est-ce pas cette erreur primitive qui aurait ricoché de la Roquette à Mazas, et finalement d’Ordionià M. le chanoine Clément ? Je pose la question ; je ne la résous pas.
Et maintenant, que vont faire les Nancéens du « triste et précieux souvenir qu’une délicate initiative avait confié àleur garde respectueuse ? Quelle place définitive vont-ils lui trouver ? Je l’ignore. En tous cas veulent-ils me permettre, à moi aussi, une « délicate initiative ? » Je possède (comme le journal l’Universl’a annoncé, le 10 octobre dernier) bien et dûment authentiqués, les barreaux en fer de la cellule 62, sixième division, c’est-à-dire de la seule, de l’unique cellule de Mgr Darboy à Mazas[8]. Je les offre aujourd’hui respectueusement à MgrTurinaz. Delà sorte la porte authentique serait à Paris, les barreaux authentiques seraient à Nancy. Et moi, il me serait agréable d’avoir procuré, au diocèse d’origine de M. le chanoine Clément, cet émouvant et suggestif souvenir. Puisse mon offre être acceptée, et ma Jeanne d’Arc Champenoise ne pas trop nuire à mes barreaux !
Paris, 21 octobre 1898.
[1]A la date du 31 août, le Figaro publia cette note, à peine française, et remplie d’erreurs qui ne peuvent être qu’involontaires :
M. le chanoine Clément, directeur de l’école Gerson, qui avait acheté laporte de la cellule de Mazas on fut enfermé, après son arrestation pendant la Commune, Mgr Darboy, archevêque de Paris, vientde l’offrir au cardinal Richard. — C’est faux. L’offre avait eu lieu le 3 août, 28 jours auparavant.
Mais Son Eminenceétant déjà en possessionde la porte d’une autrecellule où Mgr Darboy serait demeuré enfermé pendant plus longtemps, si l’on s’en rapporte ( ?) à l’enquête faite par M. l’abbé Odelin, ainsi que le Figaro l’a annoncé, a décliné cette offre gracieuse. — C’est faux et mal dit. Son Eminence a acheté la porte 62 sept jours après que M. le chanoine Clément lui avait « gracieusement » offert sa porte 21.
En conséquence, poursuit le Figaro, M. le chanoine a fait hommage de la précieuse relique dont il est possesseur, à Mgr Turinaz, évêque de Nancy, diocèse d’où il est originaire. — A part la précieuse relique, c’est vrai.
[2]Episode communal, l’abbé Crozes, otage de la Commune, 3e édition, 1873.
[3]Mgr Darboy était au 62, Mgr Surat au 53, M. Deguerry au 68 et M. Bonjean au 14.
[4]L’expression depuis quelques jours indique au minimum deux jours. La lettre étant du 12, prouve ainsi certainement pour le 10.
[5]M. Washburne, ministre des Etats-Unis à Paris, écrivit à M. Fish, en date du 2 mai : Dimanche dernier (c’est-à-dire le 30 avril) une bande de gardes nationaux s’est dirigée sur la prison Mazas, avec le projet avoué de fusiller l’Archevêque ...Les gardiens ordinaires de la prison ont eu les plus vives alarmes ; il ont fait changer l’Archevêque de cellule et l’ont mis dans une autre partie de la prison. (Maxime du Camp, les Convulsions de Paris, sixième édition, in-i2, t. 1, p. 373.) Il s’agit ici évidemment d’un transfert momentané, de quelques heures sans doute, hors de la sixième division, puisque Monseigneur était dans la sixième, d’après M. Delfau, le samedi 29. Il ne peut en aucune façon être ici question d’un transfert de la première division dans la sixième, ni’ d’un transfert définitif hors de la sixième, puisqu’au 10 mai environ, d’après M. Deguerry, Mgr Darboy avait réintégré la sixième division.
[6]D’après M. Washburne (lettre du 23 avril i871) cette cellule avait six pieds de large. C’est exactement la largeur donnée par le correspondant du Times à la cellule de M. Bonjean (1er mai 1871). Or, la cellule de M. Bonjean n’a jamais passé pour une cellule de faveur.
[7]Cf. Maxime du Camp, Convulsions de Paris, sixième édition, in-12, p. 253 et 261. Mgr Darboy occupa à la Roquette le n° 1, et le n° 23, qui lui fut cédé par M. de Marsy.
[8]Je possède également les attaches en fer du hamac. Mais elles n’ont jamais servi à Monseigneur. Sa cellule, comme la plupart des cellules de la sixième division, avait un lit en 1871.
17:03 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Monuments | Lien permanent | Commentaires (0)
22/11/2014
Le jubilé d’un holocauste 1871 - 1921
Trouvé sur Gallica, l'inépuisable source de documents, cet hommage paru en 1921, à l'occasion du jubilé de la Commune.
La proximité des événements se ressent dans le ton de l'article mais nous le livrons comme tel, à titre de document historique. Le lecteur saura prendre la distance nécessaire.
nb: la photo ne figure pas dans l'article d'origine.
oOo
Revue ETUDES. 58e année – tome 167e de la collection – 5 mai 1921
CHRONIQUE DU MOUVEMENT RELIGIEUX
LE JUBILÉ D’UN HOLOCAUSTE
LES OTAGES DE LA COMMUNE (24-27 MAI 1871)
————
I
Les journées du 22 au 28 mai 187 comptent parmi les plus sanglantes et les plus tragiques de la trop longue histoire de nos discordes sociales et de nos révolutions.
Souveraine maîtresse de Paris insurgé, depuis le 18 mars, la Commune achève sa hideuse agonie de bacchante par le massacre et par l’incendie, tandis que l’armée de la France, sous le regard narquois des états-majors prussiens, doit reconquérir laborieusement la capitale, quartier par quartier, rue par rue, monument par monument. Pour projeter un pur rayon de grandeur morale sur cet effroyable drame de guerre civile et religieuse, dont nous allons revivre le cinquantième anniversaire, il faudra l’héroïsme sublime des élus de Dieu et l’holocauste des martyrs.
L’armée à laquelle est dévolue la redoutable mission de rétablir l’ordre légal par la force des baïonnettes est commandée par le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. C’est le 21 mai, au petit jour, que les troupes du maréchal ont pénétré par surprise dans l’enceinte de Paris, à la barrière de Saint-Cloud, puis se sont emparées du château de la Muette et du Trocadéro, qui étaient devenus des forteresses puissamment armées pour la défense.
Voici quelles seront maintenant les étapes de la conquête de Paris. Le 22 mai, prise du rond-point de l’Étoile, de la gare Saint-Lazare, sur la rive droite ; du Champ de Mars et de l’École militaire, sur la rive gauche. Le 23 mai, occupation du faubourg Saint-Germain, de la Madeleine, de l’Opéra, encerclement et assaut victorieux des hauteurs de Montmartre. Le 24 mai, on s’empare du Luxembourg et du Panthéon, sur la rive gauche ; et, sur la rive droite, du Palais-Royal, de la Bourse, de la gare du Nord, de la gare de l’Est. Le 25 mai, prise de laButte aux Cailles et de la place d’Italie, puis de la gare d’Austerlitz, de la gare de Lyon et de la prison de Mazas. Le 26, progression laborieuse jusqu’à la place de la Bastille, puis jusqu’à la barrière du Trône. Le 27, on réduit le puissant bastion constitué par les Buttes Chaumont et le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, le 28 mai, jour de délivrance, prise de la Roquette, prise de l’église de Belleville, prise de l’hôpital Saint-Louis ; les soldats du général de Ladmirault atteignent le Pré-Saint-Gervais. Le pouvoir insurrectionnel de la Commune révolutionnaire est partout anéanti. Force demeure à la patrie et à la loi.
Mais après combien de catastrophes Cette affreuse bataille de rues avait coûté de 7000 à 8000 tués et blessés aux troupes de Mac-Mahon ; et les pertes des insurgés furent, numériquement, beaucoup plus considérables encore. A partir du 23 mai, jour où l’armée de Versailles atteignait la Madeleine, l’Opéra et Montmartre, commençaient les immenses incendies qui allaient se prolonger et s’étendre jusqu’à la fin de la semaine sanglante. La Commune voulait- s’ensevelir sous les ruines de Paris, sous les ruines de tout ce qui perpétuait l’âme des aïeux, de tout ce qui représentait le culte, la croyance, l’art et la gloire du passé. Il y avait des « savants », des techniciens dévoyés et déclassés qui enseignaient doctement le secret infernal d’incendier avec méthode et succès. Les murailles extérieures et intérieures étaient enduites de pétrole, les grands courants d’air étaient soigneusement provoqués, les plus massifs bâtiments étaient attaqués par leurs recoins ou leurs dépendances les plus vulnérables à l’action dévorante du feu. L’incendie ravagera donc la grande chancellerie de la Légion d’honneur, la Cour des comptes et le Conseil d’État, le château des Tuileries, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice. Des bords de la Seine, il gagnera différents autres quartiers de Paris et atteindra le carrefour de la Croix-Rouge.
Notre génération a vu les ruines de la Cour des comptes, et, plus anciennement, les ruines mêmes des Tuileries, encore debout dans leur désolation navrante et grandiose. Mais la génération de nos parents et de nos aînés a contemplé le spectacle terrifiant du gigantesque incendie, qui laissa dans la mémoire de tous les contemporains une impression atroce, un souvenir fantastique.
Les Études ont publié, par exemple, les souvenirs du R. P. Jean Noury, alors supérieur des Jésuites de Versailles. Relisons la scène qu’il rapporte à la date tragique du 24 mai 1871 :
Ce même jour..., nous nous étions rendus, le R. P. provincial [Armand de Ponlevoy] et moi, dans cet endroit du parc de Saint-Cloud qu’on appelait la « lanterne de Diogène », d’autres disaient « de Démosthène ». C’était le point culminant du parc ; on y avait élevé une tour qui, de loin, avait la forme d’une lanterne. De là, Paris offrait un spectacle horrible et grandiose ! L’incendie, allumé dans tous les quartiers de la ville, faisait monter jusqu’au ciel des tourbillons de flammes et de fumée. Beaucoup de personnes étaient réunies à cet endroit, pour tâcher de se rendre compte de ce qui se passait. Mais on devinait difficilement, même avec les plus puissantes lunettes, quels édifices étaient la proie des flammes. On craignait pour Notre-Dame, pour les autres églises, pour la Sainte-Chapelle surtout, qui disparaissait dans un nuage de feu.
Le R. P. de Ponlevoy regarda longtemps en silence, ému et terrifié. « Tel dut être, dit-il, le spectacle qu’offrit la prise de Babylone et de Jérusalem ! C’est d’un grandiose effrayant et d’une horreur toute biblique »...
Après le témoignage d’un vénérable religieux, il faut reproduire celui d’un illustre soldat, le général du Barail, qui écrivait au tome troisième de Mes Souvenirs :
Ce que je vis de la semaine sanglante suffit à me plonger dans un profond sentiment de désespoir et de terreur, et à expliquer les sévérités de la répression. Je vis, du sommet des collines où je circulais avec mes cavaliers, flamber Paris. Le spectacle était horrible et grandiose. Pendant le jour, sous le soleil impassible de mai, c’était une voûte colossale de fumée noire, où tourbillonnaient les cendres des papiers brûlés, et qui s’étendait, comme un dôme de catafalque, sur la capitale pleine de rumeurs des détonations et de cris de rage. Pendant la nuit, le dessous de ce dôme s’illuminait des éclats rouges des fournaises, tandis qu’au-dessus, là-haut, la lune semblait passer, narquoise, sur le cataclysme.
Et je songeais que, pendant que des Français brûlaient Paris, les officiers prussiens regardaient tranquillement, les deux mains sur leur sabre, l’épouvantable complément de leur victoire…
Plus odieux et plus criminel encore que la destruction des monuments de pierre par la Commune révolutionnaire de Paris, fut l’attentat perpétré contre des vies humaines, contre des citoyens désarmés qui comptaient parmi les plus nobles, les plus bienfaisants et les meilleurs. C’est la cause de l’ordre social, c’est la sainteté même de la religion, que voulurent frapper en leur personne les misérables qui les assassinèrent. Nous sommes en présence du suprême forfait de la Commune le massacre monstrueux des otages.
Parmi ceux-ci, on distingue des laïques et des prêtres. Les laïques, au nombre de quarante-cinq, se répartissent de la façon suivante trente-deux gendarmes et gardes de Paris, deux professeurs auxiliaires et six serviteurs de l’école Albert-le-Grand d’Arcueil, un banquier, un publiciste, deux fonctionnaires, un membre enfin de la haute magistrature, M. Bonjean, sénateur, président de Chambre à la Cour de cassation. Quant aux prêtres et religieux, ils furent au nombre de vingt-quatre, et, dans la présente chronique, nous avons le spécial devoir de les désigner avec plus de détails et d’une manière plus expresse.
L’archevêque de Paris, Mgr Darboy.
L’un de ses vicaires généraux, Mgr Surat.
Le curé de la Madeleine, l’abbé Deguerry.
Le curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, l’abbé Bécourt.
Un vicaire de Notre-Dame de Lorette, l’abbé Sabattier.
Un prêtre des Missions étrangères, le R. P. Houillon.
Un aumônier de patronage, l’abbé Planchat (des Frères de Saint-Vincent-de-Paul).
Un ancien missionnaire, aumônier d’ambulance, l’abbé Allard.
Un séminariste de Saint-Sulpice, l’abbé Seigneret.
Un Frère des Écoles chrétiennes, le Fr. Sauget.
Cinq membres du Tiers-Ordre enseignant de Saint-Dominique, à l’école Albert-le-Grand d’Arcueil :
Le R. P. Captier,
Le R. P. Bourard,
Le R. P. Cotrault,
Le R. P. Delhorme,
Le R. P. Chatagneret.
Quatre religieux de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Picpus) :
Le R. P. Radigue,
Le R. P. Rouchouze,
Le R. P. Tardien,
Le R. P. Tuffier.
Cinq religieux de la Compagnie de Jésus, de la maison de la rue de Sèvres et de Sainte-Geneviève de la rue des Postes :
Le R. P. Pierre Olivaint, Le R. P. Léon Ducoudray,
Le R. P. Alexis Clerc,
Le R. P. Jean Caubert,
Le R. P. Anatole de Bengy.
Les prêtres et religieux que nous venons d’énumérer furent massacrés en quatre groupes distincts, les 24, 25, 26 et 27 mai.
Le 24 mai, jour où l’armée de Mac-Mahon s’empara du Luxembourg et du Panthéon, en même temps que des gares du Nord et de l’Est, six otages furent fusillés dans le chemin de ronde de la Grande-Roquette : l’archevêque de Paris, le curé de la Madeleine, le P. Ducoudray, le P. Clerc, l’abbé Allard, et, seul laïque parmi eux, le président Bonjean.
Le 25 mai, tandis que l’armée de Versailles allait s’emparer de la Butte aux Cailles et de la place d’Italie, et s’ouvrir péniblement un chemin vers la gare d’Austerlitz, les PP. Captier, Bourard, Cotrault, Delhorme, Chatagneret, du Tiers-Ordre enseignant de Saint-Dominique, étaient massacrés, avec deux maîtres laïques et six serviteurs de leur école Albert-le-Grand d’Arcueil, dans une impasse voisine de la place d’Italie et de l’église Saint-Marcel de la Maison-Blanche.
Le 26 mai, jour où la Commune perdait le faubourg Saint-Antoine et tout le secteur compris entre la place de la Bastille et la place de la Nation, avait lieu, sur les hauteurs de Belleville, cité Vincennes, au 85 de la rue Haxo, l’épouvantable scène de boucherie dans laquelle furent mis à mort, à coups de fusil et à coups de baïonnette, ou même à coups de couteau, quarante-sept otages, dont trente-sept gendarmes et gardes de Paris et dix ecclésiastiques les PP. Olivaint, Caubert et de Bengy, de la Compagnie de Jésus ; les PP. Radigue, Rouchouze, Tardien et Tuffier, de Picpus ; l’abbé Sabattier, de Notre-Dame de Lorette ; l’abbé Planchat, du patronage de Charonne ; le jeune abbé Seigneret, séminariste de Saint-Sulpice.
Enfin, le 27 mai, date de la prise des Buttes Chaumont et du Père-Lachaise, les geôliers communards de la Grande-Roquette ayant déserté leur poste devant la perspective imminente d’un châtiment certain, plusieurs d’entre les trente et un prêtres et religieux, encore détenus dans la prison bombardée, avec des gendarmes et des gardes de Paris, se risquèrent à sortir, croyant respirer désormais l’atmosphère de la liberté reconquise. C’était vingt-quatre heures trop tôt : Mgr Surat, vicaire général, l’abbé Bécourt, curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et le P. Houillon, des Missions étrangères, furent abattus, massacrés au coin d’une rue, dans le quartier même de la Roquette.
L’holocauste était consommé. Le lendemain, dimanche 28 mai, sera, nous l’avons dit, le jour de la délivrance pour Paris incendié, ravagé, ensanglanté, sur lequel planait, depuis dix semaines, le plus hideux cauchemar. A la victoire finale du bon droit, avait préludé le sacrifice magnanime offert à Dieu par vingt-quatre « témoins » de sa propre cause et ministres de son immortelle Église.
II
Sur la voie douloureuse de la plupart des otages de la Commune, trois étapes sont particulièrement mémorables : Mazas, laRoquette, la rue Haxo.
Mazas, c’est la maison d’arrêt, la prison cellulaire, où ils demeureront séquestrés, chacun dans son étroit réduit, et sans être l’objet de la moindre instruction judiciaire, depuis la première quinzaine d’avril jusqu’au soir du 22 mai. Prisonniers d’État, ils sont au secret, par mesure de haute police et de suprême arbitraire des commissaires du peuple, notamment du féroce procureur de la Commune, Raoul Rigault.
Le plus important des otages était Mgr Darboy, l’archevêque de Paris. Des souvenirs quelquefois pénibles s’attachaient aux controverses doctrinales qui marquèrent son épiscopat de prélat gallican. Mais tout disparaissait désormais dans l’auréole de son malheur, de ses longues souffrances pour le Christ et l’Église, en attendant la gloire tragique d’une auréole plus splendide encore. Durant sa captivité, il relisait avec amour les livres qui lui étaient envoyés de sa belle bibliothèque de sciences ecclésiastiques, il revivait les jours où il avait été professeur de philosophie au petit séminaire, puis aumônier des normaliens. Sur sa poitrine, il gardait la croix pectorale de Mgr Affre, l’archevêque pacificateur dont le sang avait été le dernier versé au pied des barricades de juin 1848. A son doigt, il portait l’anneau pastoral de Mgr Sibour, cet autre archevêque de Paris poignardé à Saint-Etienne-du-Mont, en 1857, au milieu des fêtes de sainte Geneviève…
Le ministre plénipotentiaire des États-Unis, M. Washburne, obtint de visiter, un jour du mois d’avril 187 1, l’archevêque de Paris, prisonnier à Mazas. Pareil témoignage mérite d’être reproduit dans ses affirmations essentielles :
Je dois avouer que je fus profondément touché de l’aspect de cet homme vénérable. Sa personne amaigrie, sa taille mince et légèrement courbée, sa longue barbe, qui, selon les apparences, n’avait pas été rasée depuis sa captivité, son visage hagard et indiquant une santé ébranlée, tout en lui était de nature à affecter même les indifférents…
Le 19 mai, un autre visiteur pénétrait, par privilège, à Mazas, auprès de l’archevêque captif. C’était Me Edmond Rousse, qui venait briguer le périlleux honneur de le défendre éventuellement devant les tribunaux de la Commune. L’illustre avocat devait plaider, plus tard, pour d’autres nobles causes non moins désespérées, mais non moins dignes de son amour passionné pour le droit. Jusqu’au bout de sa carrière, selon le mot du duc d’Aumale, il unirait au talent de bien dire le courage de bien faire. L’impression de Me Rousse sur Mgr Darboy est aussi douloureuse et aussi émouvante que celle du diplomate américain :
En entrant dans la cellule du pauvre archevêque, je fus frappé de son air de souffrance et de son abattement. Grâce au médecin de la maison, on avait remplacé par un lit le hamac réglementaire des détenus. Il était couché tout habillé, les moustaches et la barbe longues, coiffé d’un bonnet noir, vêtu d’une soutanelle usée, sous laquelle passait un bout de ceinture violette, les traits altérés, le teint très pâle…
… Après une demi-heure de conversation, je lui tendis la main et pressai la sienne avec émotion. Plus d’une fois, je sentis les larmes me gagner. Il me dit adieu avec effusion, me remerciant vivement de ma charité. Ma visite, l’assurance que je lui donnais que le jugement n’aurait pas lieu tout de suite, la promesse que je lui fis de venir le voir souvent l’avaient évidemment remonté. Quand je me levai, il rejeta vivement la couverture de laine grossière qui l’enveloppait à moitié, descendit de son grabat sans que je pusse l’en empêcher, et, me serrant la main dans les siennes, il me reconduisit jusqu’à la porte.
Vous reviendrez bientôt, n’est-ce pas
– Mardi, Monseigneur.
« Mardi » sera le 23 mai. Depuis la veille, Mgr Darboy aura été transféré à la Roquette, la prison des condamnés à mort. Et, le mercredi 24, il sera fusillé sans jugement.
Mais revenons au 19 mai. Après sa conversation avec l’archevêque, Me Rousse fit une visite semblable au vénérable curé de la Madeleine, l’abbé Deguerry, naguère confesseur de l’impératrice Eugénie. Puis il eut un entretien avec le P. Jean Caubert, ancien avocat, Jésuite de la rue de Sèvres, dont il avait personnellement connu le père et le frère. Me Rousse voulut faire entrevoir au prisonnier du Christ une délivrance possible. Le visiteur nous rapporte que les espérances du P. Caubert étaient d’une autre sorte.
Il m’écoutait avec l’indifférence la plus sincère, souriant toujours et ayant l’air de penser : à quoi bon tout cela ? Enfin, il me dit :« Je vous remercie beaucoup de ce que vous faites. Il en sera ce qu’il plaira à Dieu. S’ils veulent nous tuer, ils en sont les maîtres. » Et, s’éloignant tout de suite de ce qui le regardait :« C’est une bien grande épreuve pour le pays, me dit-il, et qui le sauvera ? » Comme je lui exprimais mes doutes à cet égard : « Quant à moi, me dit-il avec le plus grand calme, jene doute pas, je suis sûr, je crois fermement que la France sortira de là régénérée, plus chrétienne, et, par conséquent, plus forte qu’elle n’a jamais été… »
… Je me levai, un peu gêné, et ne trouvant pas grand’chose à dire à un homme si fermement trempé, et dont le courage me semblait si fort au-dessus du mien.
Dans les premiers jours de son incarcération à Mazas (12 avril), Mgr Darboy avait cru devoir, comme tel était indubitablement son droit, écrire une lettre au Chef du pouvoir exécutif, à Versailles, Adolphe Thiers, pour appuyer un projet d’échange entre prisonniers politiques. Moyennant la libération, par le gouvernement légal de Versailles, du révolutionnaire Blanqui, condamné pour acte de sédition et d’insurrection, la Commune de Paris consentirait à remettre en liberté l’archevêque de Paris, le président Bonjean, l’abbé Deguerry, le vicaire général Lagarde et la sœur de l’archevêque, Mlle Darboy (laquelle allait être délivrée, de fait, après trois semaines d’incarcération arbitraire). L’abbé Lagarde, libéré sur parole, fut chargé de porter à Versailles le message de l’archevêque. Adolphe Thiers jugea inacceptable un échange qui semblait supposer ‘une analogie ou une équivalence entre la condition d’un criminel politique, comme Blanqui, et celles des otages de la Commune. Le gouvernement de Versailles interdit à l’abbé Lagarde de rentrer dans Paris, malgré les adjurations pressantes que lui adressait l’archevêque prisonnier. Au total, l’incident laissa, parmi les contemporains, une impression pénible et troublante.
Des projets d’échange continuèrent néanmoins à circuler avec quelque insistance. Le 6 mai, l’un des Jésuites détenus à Mazas, le P. Alexis Clerc, ancien officier de marine et professeur à l’école Sainte-Geneviève de la rue des Postes, recevait inopinément la visite d’une dame qui, durant le siège de Paris, avait été infirmière dans une ambulance où lui-même avait été aumônier. Cette dame avait accès auprès de l’un des potentats de la Commune révolutionnaire, et, en visitant le P. Clerc, amenait au prisonnier de Mazas, son propre frère, M. Jules Clerc, qui allait ainsi le revoir une dernière fois avant la suprême catastrophe. La charitable visiteuse annonce au P. Clerc que, s’il y consent, le haut personnage révolutionnaire ira prochainement le voir pour lui proposer d’être compris dans un échange de prisonniers politiques. Mais, aussitôt, l’ancien officier de marine bondit comme sous un outrage :
— De grâce, contenez-vous, lui dit-on, et, surtout, si l’offre vous est faite, n’allez pas vous compromettre... Il vous en arriverait malheur !
— Quel malheur ? Et qu’ai-je à craindre ? Nous ne pouvons guère être plus mal qu’à la Conciergerie et à Mazas.
— Pardon, mon Père, pardon…
Alors, s’écria-t-il en tressaillant, nous serions fusillés ! Quelle bonne fortune ! Tout droit en Paradis !
Et il avait l’air radieux, les mains étendues, les yeux au ciel...
Le soir même, le P. Alexis Clerc écrivait encore
J’ai entendu parler de propositions d’échange entre certaines personnes. Absit ! Je ne veux pas. Je patiente très bien, et le ferai tant qu’il faudra. Mais il y a tant de raisons pour refuser un échange. Oh !non !
Le P. Clerc n’avait guère d’illusions sur son sort. Néanmoins, sa libération, à la faveur d’un brusque écroulement de la Commune révolutionnaire, demeurait une éventualité possible. Professeur de sciences à la rue des Postes, il avait à prévoir la reprise de son cours au s futurs polytechniciens. Il réclama donc des livres de géométrie analytique, et, durant tout le temps qu’il ne consacra pas aux exercices de piété, il occupa laborieusement sa captivité à préparer son cours, en vue de la prochaine rentrée scolaire. Exemple magnifique de fidélité à la conscience professionnelle !
L’épisode le plus émouvant de la détention des otages est l’entrée mystérieuse de Notre Seigneur lui-même, sous le voile des espèces eucharistiques, dans la cellule de quelques-uns des prêtres et religieux qui s’apprêtaient à lui offrir le témoignage de leur sang.
Trois fois, l’audacieuse et sainte expédition fut accomplie, et avec un heureux succès, par une intrépide chrétienne, Mlle Delmas, directrice de l’Orphelinat des enfants délaissées, rue Notre-Dame-des-Champs. Ce fut, d’abord, le 13 avril, le jour même où les PP. Olivaint et Caubert allaient être conduits de la prison du Dépôt à la prison de Mazas. Ce fut, ensuite, le 15 mai, à Mazas même, quand des intelligences eurent été nouées, avec les garanties de sécurité nécessaires, parmi les geôliers des PP. Olivaint, Ducoudray et Clerc. Ce fut, enfin, dans la matinée du 22 mai, jour où les otages allaient quitter Mazas pour la Roquette. Le bombardement faisait rage, la ligne de feu s’étendait de la gare Saint-Lazare à l’École militaire. Mlle Delmas et une compagne digne de sa vaillance faisaient à pied, dans une prière silencieuse, la longue étape de la rue Notre-Dame-des-Champs à la prison de Mazas, près la gare de Lyon, et elles apportèrent sans encombre le précieux dépôt, qui fut immédiatement transmis aux PP. Olivaint, Ducoudray, Clerc, Caubert et de Bengy. Pour tous les cinq et pour plusieurs de leurs compagnons de supplice, notamment Mgr Darboy, Mgr Surat et l’abbé Deguerry, ce sera le viatique divin du dernier voyage et du suprême combat.
Pour chaque destinataire, le P. Hubin, lors du premier envoi, et le P. Matignon, lors du deuxième et du troisième envoi, placèrent quatre hosties consacrées dans une custode, enveloppée d’un corporal et renfermée dans un sachet de soie, lequel était muni d’un cordon pour être porté au cou. Le tout avait été introduit dans le double fond, hermétiquement fermé, d’un pot de crème, rempli jusqu’au bord. Les prisonniers étaient dûment avertis par des messages écrits en style conventionnel. A chaque envoi, ils purent faire savoir que l’aliment tant désiré leur était fidèlement parvenu et qu’ils avaient le bonheur d’être maintenant christophores.
Une lettre d’actions de grâces, écrite de Mazas, le 16 mai, par le P. Alexis Clerc, mérite d’être rapprochée de l’épitre fameuse aux chrétiens de Rome, où le martyr saint Ignace d’Antioche, au début du second siècle, chante avec amour son ardent désir d’être uni par le sacrifice de son sang au Pain véritable et vivant, Jésus-Christ
Ah !prison, chère prison, toi dont j’ai baisé les murs en disant : bonacrux !quel bien tu me vaux. Tu n’es plus une prison, tu es une chapelle. Tu ne m’es plus même Une solitude, puisque je n’y suis pas seul, et que mon Seigneur et mon Roi, mon Maître et mon Dieu y demeure avec moi...
Oh !dure toujours, ma prison, qui me vaux de porter mon Seigneur sur mon cœur, non pas comme un signe, mais comme la réalité de mon union avec Lui ! Dans les premiers jours, j’ai demandé avec une grande insistance que Notre Seigneur m’appelât à un plus excellent témoignage de son nom. Les plus mauvais jours ne sont pas encore passés. Au contraire, ils approchent, et ils seront si mauvais que la bonté de Dieu devra les abréger. Mais, enfin, nous y touchons.
J’avais l’espérance que Dieu me donnerait la force de bien mourir. Aujourd’hui, mon espérance est devenue une vraie et solide confiance. Il me semble que je peux tout en Celui qui me fortifie et qui m’accompagnera jusqu’à la mort.
Le voudra-t-il ? Ce que je sais, c’est que [s’il ne le veut] j’en aurai un .regret que la seule soumission à sa volonté pourra calmer...
La préparation au martyre est achevée.
L’holocauste sanglant va s’accomplir.
III
Dans la soirée du 23 mai, tous les otages qui venaient de passer, à Mazas, plusieurs semaines au régime de la prison cellulaire, se trouvaient incarcérés à la Grande-Roquette, prison des condamnés à mort. Ceux que le Seigneur avait choisis pour le martyre allaient y passer, les uns deux jours, la plupart quatre jours, quelques-uns cinq jours. Les autres, que l’Ange de Dieu n’aura pas marqués pour le même témoignage, seront délivrés le sixième jour.
Les conditions matérielles et morales de leur nouvelle (mais -combien passagère) installation représentèrent, pour les captifs du Christ, un incomparable adoucissement. Au lieu du jour parcimonieusement mesuré des lucarnes de Mazas, chaque cellule bénéficie d’une vraie fenêtre, s’ouvrant à hauteur d’appui et donnant libre accès à l’air et à la lumière. En outre, ce n’est plus l’isolement. Chaque cellule n’est séparée de la cellule contiguë ̃que par une mince cloison, qui partage par moitié, entre les deux prisonniers, la même fenêtre commune. A un signal donné, l’un et l’autre captif peut se rendre à la fenêtre et converser librement avec son voisin. On retrouve aujourd’hui cette disposition des lieux au numéro 85 de la rue Haxo, où les cellules de quelques-uns des otages ont été parfaitement reconstituées, après achat des diverses pièces de leur matériel (portes, verrous, grillages), lors de la démolition de la Grande-Roquette.
Non seulement les prisonniers pouvaient ainsi converser deux à deux, mais, deux fois par jour, ils avaient récréation commune, avec liberté de se voir dans le chemin de ronde, ou dans le couloir de la prison, ou même dans les cellules les uns des autres. On devine quel réconfort moral les otages de la Commune, prêtres et laïques, trouvèrent dans cette facilité bienheureuse de se communiquer mutuellement les secours fraternels et spirituels que réclamaient leur épreuve déjà longue et l’imminence du dernier sacrifice.
Les entretiens de Mgr Darboy et du P. Olivaint furent d’un caractère particulièrement émouvant les dissentiments des années précédentes disparaissaient à jamais dans la communauté d’un même témoignage rendu à la même cause pour le même amour. Le religieux put donner à l’archevêque le trésor des trésors, le Pain divin de l’Eucharistie.
Le P. Olivaint reconnut, parmi les otages laïques, un de ses anciens camarades de l’École normale, M. Chevriot, proviseur du lycée de Vanves (alors succursale de Louis-le-Grand). Après les premières effusions, le P. Olivaint, abordant un grave sujet, demanda simplement et affectueusement à M. Chevriot s’il comprenait comme lui les devoirs que leur imposait la perspective menaçante de la mort. Le proviseur répondit que rien ne les séparait plus. Dès la vieille, il avait fait sa paix avec Dieu, et s’était confessé au P. Houillon, des Missions étrangères, son voisin de cellule. « Fort bien, mon cher camarade, répliqua en souriant le P. Olivaint. Mais il me semble que vous m’apparteniez, et que j’ai un peu le droit d’être jaloux ! »
Dans une lettre du 25 avril, datée de Mazas, le P. Clerc écrivait à son frère Jules qu’il avait prévu de longue date la probabilité d’une incarcération à subir. « Pour ne pas exagérer les pressentiments que je reçois, continuait-il, je dois ajouter que j’imaginais que cela se ferait par le moyen régulier et officiel d’un M. Bonjean quelconque, magistrat des vieux Parlements, tandis que ce pauvre M. Bonjean trouvemoins étonnant de se voir lui-même en prison, que de s’y voir avec les Jésuites. Oh !fortune !je puis dire aussi : Oh ! Commune, voilà de tes coups ! » Un mois plus tard, à la Grande Roquette, c’était le Jésuite Alexis Clerc qui occupait la cellule contiguë à celle du président Bonjean.
La rencontre pouvait sembler paradoxale. Ce contact suprême et inopiné avec un prêtre de la Compagnie de Jésus n’allait-il pas bouleverser un magistrat qui incarnait, au su de tout le monde, et qui avait formulé avec âpreté, à la tribune du Sénat impérial, les plus violentes préventions des légistes et des césariens du gallicanisme d’État contre la puissance ecclésiastique, contre Rome et surtout contre les Jésuites? Mais, aux approches d’une mort tragique, la grâce de Dieu faisait luire, dans l’âme du magistrat gallican, des clartés nouvelles, lui faisait découvrir d’autres horizons. La charité sacerdotale du P. Clerc, sa droiture et sa générosité chevaleresques émurent, séduisirent, le président Bonjean. Sur le terrain de l’honneur, sur le terrain de la conscience professionnelle, les deux captifs n’auraient nulle peine à s’entendre. Nous connaissons déjà le P. Clerc. Quant au président Bonjean, il était revenu à Paris, en pleine Commune, pour prendre place à la tête de la Cour de cassation, comme doyen des présidents de Chambre, le premier président se trouvant écarté par la maladie.C’est au sortir même de son audience que le président Bonjean avait été arrêté, incarcéré, par les forbans de la Commune. Lorsque, pour des raisons de famille, on avait envisagé, pour lui, la libération temporaire, comme prisonnier sur parole, il avait, d’accord avec sa noble femme, refusé la perspective d’un tel avantage, craignant qu’un obstacle de force majeure l’empêchât de rentrer à Paris et lui donnât l’apparence d’avoir trahi, par crainte de la mort, son engagement d’honneur. Après quoi, le fier magistrat français avait, dans sa prison, écrit, pour ses enfants, cette déclaration admirable :
… Moi qui n’ai jamais trompé personne, moi qui voudrais encore moins tromper mes enfants en ce moment solennel, je vous affirme que, si misérable que puisse être la fin qui paraît m’être destinée, je ne voudrais à aucun prix avoir agi autrement que je ne l’ai fait. C’est que le premier bien, mes chers enfants, c’est la paix de la conscience et que ce bien inestimable ne peut exister que pour celui qui peut se dire :J’ai fait mon devoir.
Entre cet homme d’honneur et de haute conscience qu’était le président. Bonjean, et l’ancien officier de marine, le chevalier intrépide, le prêtre et le religieux au grand cœur, qu’était le P. Alexis Clerc, l’accord ne tarda pas à devenir étroit et cordial.
Tous deux causèrent longtemps, à la commune fenêtre de leurs deux cellules. Ils causèrent encore, seul à seul, dans le chemin de ronde, durant le temps de la récréation des détenus. Les autres otages respectaient l’intimité d’un dialogue dont chacun soupçonnait aisément le caractère. Enfin, les deux interlocuteurs se séparèrent, et le président Bonjean, le visage tout radieux, aborda l’archevêque de Paris :« Eh bien ! Monseigneur, s’écria-t-il, moi, le gallican, qui aurait jamais cru que je serais converti par un Jésuite ?... »
Ces choses étaient dites dans la matinée du 24mai. Dans la soirée du même jour, au pied des hautes murailles de: la Roquette, un double feu de peloton, salué par les acclamations haineuses et féroces de la populace qui avait envahi l’enceinte de" la prison, foudroyait tes six premières victimes Mgr Darboy et le président Bonjean, les abbés Deguerry et Allard, le P. Ducoudray, recteur de la rue des Postes, et le P. Alexis Clerc, son fidèle compagnon de labeur et de martyre. La dernière vision qu’un témoin eût gardée de l’archevêque, dont le corps était déjà criblé de balles, mais avant le coup de grâce, est celle qu’a immortalisée, à Notre-Dame de Paris, le monument de Mgr Darboy par le sculpteur Bonnassieux la main gauche s’appuyait sur le mur, tandis que la main droite demeurait élevéedans un geste de suprême bénédiction. Le Bon Pasteur donnait sa vie pour son troupeau, et, comme le Christ, il pardonnait à ses meurtriers.
Le surlendemain, 26 mai, à Belleville, au 85 de la rue Haxo, avait lieu la grande hécatombe de quarante-sept otages de ta Commune, dont dix ecclésiastiques, parmi lesquels quatre Pères de Picpus et trois Jésuites.
Pour mieux savourer l’amertume du calice d’agonie, les otages qui, depuis la Roquette, venaient de subir l’épuisante fatigue de la voie douloureuse, durent supporter encore une longue attente, rue Haxo, parmi les menaces et les clameurs furieuses de la multitude en délire. Le sort des victimes se discutait confusément, tumultuairement, dans un conseil de guerre improvisé, dont l’issue ne pouvait être douteuse.
Avec le citoyen Hippolyte Parent, dernier commandant en chef de l’insurrection vaincue, la plupart des « juges » réclamaient l’exécution générale des otages, tandis qu’une tardive clémence était plaidée, au nom de l’intérêt politique, par quelques prévoyants de l’avenir.
Mais -à quoi bon tant de palabres ? Le débat se prolonge par trop, au gré de la foule révolutionnaire. Une vivandière de dix-neuf ans décharge son revolver. Un otage tombe foudroyé. Alors, il se produit une poussée formidable, tandis que le boucher Victor Bénot rugit :A mort !et que des centaines de voix avinées répètent :A mort ! A mort ! Ce sera la parole décisive.
Les otages sont entraînés pêle-mêle, vers le fond de la cité Vincennes, par delà le petit mur (haut de 50 centimètres) d’un immeuble en construction, et acculés au pied d’une haute muraille de couleur sombre. L’heure du massacre est venue.
Fédérés et vivandières tirent dans le tas, soit à coups de fusil, soit à coups de revolver, tandis que d’autres assassins, à califourchon sur le mur d’enceinte, dirigentcontre les otages un feu plongeant. Après quoi, la foule se rue sur les malheureux, qui râlent et gémissent encore. On les piétine, on les larde de coups de baïonnette et de coups de poignard, jusqu’à ce que tous soient entrés dans l’éternel silence.
Puis, les quarante-sept cadavres sanglants, horriblement mutilés et défigurés, furent jetés, entassés, dans une fosse de maçonnerie qui était destinée à devenir la fosse d’aisances de l’immeuble en construction. Du regard humain, tous les détails du massacre et de ses suites concourent à augmenter l’épouvante de cette affreuse, de cette répugnante scène de boucherie, qui reste le plus hideux forfait de la Commune agonisante.
Si nous commémorons le jubilé des otages de la Commune, ce n’est pas dans une pensée de haine ou de vengeance, mais en vue de rendre hommage à l’héroïsme de tant de nobles victimes.
C’est en vue de remercier le Dieu très bon et très saint qui, par la vertu spirituelle de leur sanglant holocauste, daigna exercer sur les âmes croyantes et incroyantes, sur les œuvres d’apostolat intellectuel ou populaire, sur la France repentante et consacrée, les magnifiques desseins d’amour dont témoigne, parmi tant d’épreuves, l’histoire religieuse des cinquante dernières années.
Les Dominicains enseignants d’Arcueil, fusillés, le 25 mai 1871, non loin de la place d’Italie, étaient tombés en criant :C’est pour le bon Dieu ! Parmi les prêtres et religieux massacrés rue Haxo, nous en savons deux qui, ayant atteint l’âge d’homme et, suivant déjà une autre carrière, avaient tout quitté, en 1845, pour entrer dans la Compagnie de Jésus proscrite, se sentant impérieusement sollicités par l’attrait de la persécution C’était l’universitaire Pierre Olivaint, dont le P. Charles Clair a retracé avec tant de charme la sainte carrière, et c’était le juriste Jean Caubert, qui aura eu pour historiographe son neveu, le R. P. Pierre Lauras, aujourd’hui directeur de la Conférence Laënnec. Ce qu’ils ont cherché, ils l’ont trouvé au delà de leurs plus magnanimes désirs d’immolation et de sacrifice, quand, le 26 mai 1871, ils donnèrent au Christ, à l’Église et aux âmes le suprême témoignage d’amour.
Sans nous permettre de dire encore les paroles que l’Épouse du Christ veut être la première à prononcer, nous avons le droit de rappeler que, dans le langage de l’antiquité chrétienne, pareil témoignage se nomme le martyre. Archevêque, vicaire général, prêtres du clergé séculier ou régulier, aspirants au sacerdoce ou éducateurs religieux des enfants du peuple, tous les otages de la Commune qui ont été arrêtés et mis à mort en raison même de leur qualité d’ecclésiastiques ou de religieux, et qui ont volontairement accepté la mort pour cette sainte cause, paraissent réaliser chacune des conditions que la Tradition catholique exige pour que le témoignage du sang prenne le caractère et reçoive l’auréole du martyre.
Déjà, notre cœur discerne et salue les témoins du Christ, immolés le 24, le 25, le 26, le 27 mai 1871, dans la blanche armée des cieux qui, selon les paroles du Te Deum, chante la louange du Seigneur par un éternel cantique.
Nous glorifions, par leur mémoire et leurs exemples, le Dieu tout-puissant que leur mort héroïque a plus dignement glorifié. Nous appelons avec espoir et confiance leur secours céleste sur tout ce que nous aimons et tout ce qu’ils ont aimé.
Mais nous nous gardons d’intercéder nous-mêmes pour leur âme et leur salut, comme s’ils pouvaient avoir besoin de notre aide, car nos aillés dans la foi nous ont appris que ce serait une impiété de prier pour des martyrs.
Yves de la BRIERE
la villa des otages.
Nous nous permettons de signaler à la délicate charité de nos lecteurs et lectrices les œuvres d’apostolat populaire (patronage de garçons, patronage de filles, institutions annexes) qui perpétuent la mémoire des nobles otages de la Commune au lieu même de leur massacre 85, rue Haxo.
A la « villa des otages », on retrouve le cadre presque intact de l’horrible scène du 26 mai 1871. Sur le mur sombre du massacre, on lit la liste des victimes qui furent mises à mort, voilà cinquante ans, par haine du droit, de la religion et de la paix, odioiuris, religionis et pacis. Devant ce mur, on contemple la fosse encore béante où furent jetés pêle-mêle les cadavres des victimes. Dans le bâtiment contigu, on visite les cellules des otages, telles qu’elles étaient à la Roquette.
Chaque secours donné aux œuvres de la « villa des otages » sera un hommage rendu à la sainte mémoire des témoins du Christ et une contribution méritoire à la fécondité de leur sacrifice.
Y. B.
Disponible sur Gallica :ark:/12148/cb34348593d/date
15:35 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Compagnie de Jésus, Eglise catholique | Lien permanent | Commentaires (0)