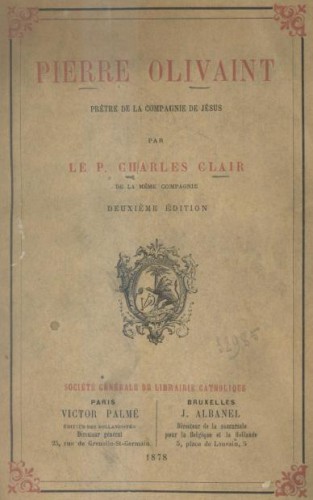17/11/2013
La vie du Père Olivaint - Chapitre XVII
http ://www.archive.org/details/pierreolivaintpOOclai
PIERRE OLIVAINT
PRETRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
PAR LE P. CHARLES CLAIR
1890
CHAPITRE XVII
Le siège de Paris. — La Commune.
Les dernières années qui précédèrent les douloureux événements de 1870, furent signalées par la recrudescence des passions révolutionnaires et antireligieuses. L’Église, les congrégations, les jésuites, dénoncés à la tribune du Sénat et du Corps législatif, redevinrent le thème habituel des déclamateurs de clubs et des journalistes de faubourgs ; le dévergondage des idées fomentait le désordre et préparait l’émeute.
Le P. Olivaint suivait d’un regard attristé les progrès du mal. La faiblesse du pouvoir en face des manifestations démagogiques, l’apathie des bons, leurs divisions intestines lui faisaient prévoir, à courte échéance, la catastrophe ; mais ce qui l’inquiétait plus que la violence des ennemis de l’ordre social, c’était la timidité de ceux qui auraient dû le défendre. Les catholiques eux-mêmes, à les considérer en général, ne lui paraissaient pas déployer un courage égal au péril. Nous trouvons, dans ses notes, cette plainte énergiquement exprimée : « Conduite des catholiques. — Comme ils s’effacent, au lieu de s’affirmer ! comme ils se trahissent, au lieu de se soutenir ! comme ils se retirent, au lieu de s’avancer ! comme, seuls, ils font des concessions ! comme ils exaltent leurs adversaires et rabaissent leurs défenseurs ! comme chacun prétend avoir exclusivement l’Église pour soi et lutte contre les autres !... »
Le profond chagrin qu’il éprouvait à ce spectacle était, grâce à Dieu, adouci par le zèle et la générosité que plusieurs déployaient au service de la religion et du pays. Il était heureux, par exemple, quand quelques-uns de ses enfants, au club du Pré-aux-Clercs ou du Vieux-Chêne, avaient affronté bravement la colère ou les sarcasmes d’un auditoire hostile pour défendre la vérité et venger l’honneur de l’Église.
En voyant se multiplier les attaques contre la Compagnie de Jésus, le P. Olivaint se dit que l’heure était venue de souffrir sans faiblesse la persécution dont le mystérieux attrait avait naguère décidé de sa vie. Il ne cessa de conseiller la résistance par toutes les voies légales, mais sans se faire illusion sur le résultat ; il savait qu’en temps de révolution la loi n’est plus qu’un vain mot. Tout son espoir était en Dieu : « Nous retiendrons sur nous et sur nos œuvres la bénédiction d’en haut, écrivait-il dans un mémoire adressé au P. Provincial, si nous sommes vraiment religieux, religieux avant tout. Devant la loi, c’est le citoyen qui sauve le religieux ; mais, dans la pratique et devant Dieu, il est bien plus vrai de dire que c’est le religieux, par sa fidélité, qui sauve le citoyen ou plutôt qui se sauve lui-même. »
Au moment où la déclaration de guerre jetait tous les esprits dans l’agitation et l’inquiétude, le P. Olivaint sentit le besoin de se recueillir. Le 1er août 1870, il se mit en retraite, pour se disposer à la passion qui était proche. Toutes ses méditations et tous ses efforts tendirent à bien établir en lui le règne du Saint-Esprit par la pureté du cœur ; il prit pour dernier mot d’ordre : « Aimer, c’est souffrir, » et se déclara « prêt à mourir pour l’Église, le Souverain Pontife, la Compagnie… » Il sortit de la solitude pour apprendre nos désastres à Wissembourg, à Woerth, à Forbach, et ce qui lui parut plus humiliant que toutes nos défaites, l’abandon de Rome ! Ce fut pour lui l’annonce des plus grands malheurs, auxquels depuis longtemps il s’attendait. Dans les premiers jours de janvier 1870, il avait dit : « La persécution est à nos portes ; elle sera terrible. » Et comme la personne à laquelle il adressait ces paroles semblait douter de l’imminence du péril, il reprit avec animation : « Mon enfant, nous traverserons un bain de sang[1]. »
« Le 11 août 1870, raconte M. le docteur H. G***, partant avec mon ambulance pour l’armée du Rhin, j’allai faire mes adieux au P. Olivaint, à la maison de la rue de Sèvres. En me reconduisant, il me prit la main et me dit : « Vous avez raison de porter secours à nos blessés ; vous allez au-devant du danger et je vous approuve. Mais vous ne serez pas des plus exposés. La guerre a été follement engagée, nous sommes battus, et nous le serons encore. Profitant de l’impuissance du pouvoir, le parti radical, qui déjà s’agite, provoquera dans Paris un terrible bouleversement. On s’attaquera aux maisons religieuses, on commencera par les nôtres, on viendra ici même. Un nous trouvera tous, chacun à son poste, moi comme les autres, bien entendu. Ce que nous deviendrons… l’avenir vous l’apprendra. »
Peu de jours après, le P. Olivaint confiait au P. de Ponlevoy son jugement sur la situation : « Nous sommes tranquilles pour le moment. Mais la république rouge s’organise à côté de la tricolore. On voit sur les murs les avis de deux gouvernements, si l’on peut parler ainsi. Que la sociale l’emporte un instant, et nous savons d’avance notre sort. »
La prévision de cet avenir, loin de l’intimider, excitait son courage. « Que fera de nous la Révolution ? écrivait-il[2] ; confiance ! courage ! Nous sommes prêts à tout, et nous tâcherons de nous mettre au niveau des circonstances, ad majorem Dei gloriam ! »
Si, dans son patriotisme, il se faisait quelque illusion sur les chances de la lutte contre l’Allemagne, il n’en avait aucune au sujet des menées criminelles de la Révolution. « Comme vous voyez tout en noir ! disait-il dans une autre lettre[3] ; je suis bien loin de juger comme vous. Non. non, tout n’est pas perdu. Les Prussiens seront repoussés et je ne serais pas étonné même qu’ils dussent renoncer au siège de Paris. Mais la Révolution se lèvera probablement quand les Prussiens disparaîtront. A la Providence ! Il me semble que le Seigneur est en train de relever la France par ses humiliations même ; il a fait guérissables les nations de la terre, selon la parole de l’Écriture, et je m’obstine à espérer qu’ils nous guérira. »
En tous cas, il était dès lors énergiquement résolu à ne céder ni à la peur, ni même à la violence. « Je vous suis bien reconnaissant, ajouta-t-il, de m’offrir à tout événement un asile. Certes, j’irais avec une grande confiance sous votre toit, et ce serait pour moi une vraie consolation, si jamais la Providence m’obligeait à partir. Mais je ne vois pas comment cela pourrait arriver, à moins d’un décret de bannissement dont les gendarmes assureraient l’exécution. Autrement, que nous ayons affaire à la Révolution ou aux Prussiens, les âmes dans de tels dangers ont plus que jamais besoin de secours, et vous pensez bien que nous saurons rester à notre poste. »
Dans toutes ses lettres, il tient ce même langage. « Pour moi, écrit-il à Mme la maréchale Randon[4], pour moi, je ne quitte pas Paris : à tout événement je dois rester à mon poste, et pour nos Pères, et pour les chères âmes. » — « Vous le pensez bien, répète-t-il encore[5], je ne songe pas à fuir. Que deviendraient les pauvres âmes, si ceux que Dieu charge de les soutenir, les abandonnaient au milieu de telles épreuves ? Quand les gendarmes me feront sortir par la porte, en attendant que je puisse rentrer par la fenêtre, je verrai s’il y a moyen de visiter votre chère demeure. »
Au milieu de ces graves préoccupations, le P. Olivaint ne perdait rien de son généreux entrain et de sa merveilleuse activité. Dès le 26 août 1870, il organisait une vaste ambulance dans la maison de la rue de Sèvres, et assignait à chaque Père un poste d’aumônier et un poste d’infirmier à chaque Frère. Il fallut vaincre d’étranges résistances pour obtenir la faveur de se dévouer au service de nos braves soldats. Une fois ces obstacles surmontés, le P. Olivaint s’occupa d’un projet qu’il semble avoir eu grandement à cœur. Il s’agissait d’établir un Orphelinat pour les victimes de la. guerre. « Une œuvre de ce genre, dit-il[6], si utile en elle-même et qui ira rien de contraire à notre institut, serait certainement bien accueillie. Je la placerais dans un autre quartier, du côté de Saint-Philippe du Roule.... Auprès de cette œuvre peut-être un externat s’établirait. Dans les temps de révolution surtout, ceux-là seuls réussissent qui savent oser et prévoir. »
Le P. Olivaint a vu, du haut du ciel, se réaliser son pieux dessein. Le vénérable successeur de l’archevêque martyr a recueilli les orphelins de la guerre, et sur la rive droite de la Seine s’est élevé l’externat de Saint-Ignace qui réunit déjà plus de sept cents enfants.
L’investissement de Paris se complétait peu à peu ; la grande ville allait se trouver séparée du reste du monde. « Les Prussiens sont près d’ici, écrit le P. Olivaint dans une lettre qui parvint, à travers mille obstacles, jusqu’en Pologne[7] ; quelle affreuse guerre ! Et si nous n’avions que les Prussiens à combattre ! mais la Révolution se dresse devant nous. A Lyon flotte le drapeau rouge ; un certain nombre de nos Pères sont en prison. A Paris, les rouges sont encore contenus. Cependant plusieurs tentatives ont été faites. Notre collège de Vaugirard, pour sa part, a été attaqué deux fois[8]. J’ai eu, moi, ici, une petite émeute. Mais que Notre-Seigneur est bon ! On ne le voit jamais mieux que dans des temps semblables. Nous avons été remarquablement protégés[9]. Après tout, nous ne demandons pas mieux que de souffrir pour ramener la bénédiction de Dieu sur notre pauvre pays. Non, nous ne savions pas nous-mêmes à quel point la France était malade ! Mais Dieu a fait guérissables les nations de la terre, pourvu cependant qu’elles veuillent guérir. Ah ! si votre chère Pologne avait voulu ‘ Et notre France voudra-t-elle ? Comprendra-t-elle que tout est perdu si elle ne revient à Dieu, si elle ne retourne à la foi catholique, si elle ne renonce à cette corruption de mœurs et de doctrines qui sont au fond la vraie cause de ses malheurs ? Prions, prions, et en attendant des jours meilleurs, si jamais ils doivent luire, sachons nous dévouer pour les âmes et faire notre devoir. Il y a eu à Paris une grande débandade ; à l’approche du siège, des multitudes ont pris la fuite ; tous ceux que des raisons de force majeure ne retenaient pas ont déguerpi. Nous avons, nous, renvoyé nos jeunes gens et nos infirmes, et nous restons au poste pour soutenir les courages et panser toutes les blessures, pour réconcilier les mourants avec le Seigneur et leur ouvrir le ciel. Nous avons une ambulance dans chacune de nos maisons. De plus, nous logeons des mobiles. Nous avons des aumôniers aux fortifications et aux avant-postes. Nous faisons pour la patrie tout ce qui dépend de nous. Quant au danger, grâce à Dieu, nous n’y pensons pas. Je bénis Notre-Seigneur des dispositions calmes et généreuses de tous ceux qui m’entourent. Le canon va gronder, les bombes et les obus vont pleuvoir.... A la bonne Providence ! Ah ! mieux vaut mourir que de voir plus longtemps le triomphe de l’erreur et de l’iniquité sur la terre, mais il faut bien mourir, et quelle plus heureuse mort que de succomber dans le dévouement au service du bien, de la vérité, de l’Église et de Dieu !...
« Après la tempête, nous aurons des jours meilleurs. C’est la justice de Dieu qui passe ; bientôt nous sentirons les effets de sa miséricorde. Écrivez-moi bientôt et dites-moi que vous avez trouvé le secret de ne plus jamais pécher contre l’espérance, et que cette douce vertu soutient votre âme et votre corps même. »
Le P. Olivaint aurait ardemment désiré prendre pour lui, selon sa coutume, le ministère le plus pénible et suivre nos soldats sur le champ de bataille. « Nos Pères se dispersent dans toutes les directions pour relever les blessés avec un zèle bien édifiant, mandait-il le 21 septembre au P. Provincial. On serait vexé de rester là, si le vrai poste de Dieu n’était pas celui de l’obéissance. » Il n’était pas oisif ; son zèle était plus entreprenant que jamais. « La guerre prêche, » disait-il, et il constatait avec joie « un mouvement de retour à Dieu pour bien des âmes[10]. » Ce qu’il passe sous silence, ce sont les épreuves physiques et morales de ces tristes jours, du moins en tant qu’il s’agit de ses souffrances personnelles. « C’est, dit-il[11], la monotonie de l’état de siège, du froid, des privations, de la fatigue ; mais, en vérité, si nous nous comparons à cette multitude qui nous environne, nous avons bien peu à souffrir. Comme nous souffririons volontiers davantage, si le salut devait venir par là ! Ah ! si les âmes se tournaient davantage vers Dieu ! »
« La bonne Providence nous protège d’une manière manifeste. Elle a pour nous, ici particulièrement, pour cette question matérielle devenue passablement difficile, toutes sortes d’attentions touchantes. L’autre jour, les larmes m’en venaient aux yeux de reconnaissance. Sachez bien que nous ne sommes pas du tout au découragement, pas même à l’inquiétude : ce serait vraiment faire injure à Notre-Seigneur[12]. » Le 11 janvier, au lendemain du combat de Buzenval, il exprima avec plus d’énergie encore ce même sentiment : « Nous serions bien ingrats, si nous n’étions prêts à tout dévouement et à une inconfusible confiance. »
Enfin, ce long siège s’acheva dans l’humiliation de la défaite. En jetant un regard en arrière, le P. Olivaint éprouvait, avant tout, un sentiment de reconnaissance. « Qu’il fait bon mettre toute sa confiance en Dieu ! écrivait-il ; nous avons été l’objet d’une providence toute particulière. Sans doute, nous avons eu notre part d’épreuves, cela était juste ; mais en vérité, nous n’avons pas trop souffert. Trois de nos Pères ont été blessés sur les champs de bataille, mais légèrement. Les obus ont sifflé sur Vaugirard, la rue de Sèvres, la rue des Postes : c’était un assez vilain concert ; je ne sais pas pourquoi on vante la musique allemande ; mais personne de nous n’a été atteint. Quelques murs ont été percés, un énorme éclat d’obus s’est arrêté dans la tribune de notre église, juste au-dessus du saint Sacrement ; on eût dit qu’il n’était venu là que pour saluer le maître. Je dois avouer, pour toucher un autre point, que nous n’avons pas vécu certainement dans l’abondance ! Quelques-uns sont un peu plus maigres qu’auparavant ; quelques autres, tombant de fatigue, sont en train de se refaire. Cependant, l’état sanitaire est en général assez bon. Donc, bénissons Dieu et préparons-nous à le mieux servir, car il y aura bientôt beaucoup à faire : noble carrière pour ceux qui aiment le dévouement et vivent par le cœur[13] ! »
A un ancien élève de Vaugirard, impatient d’avoir de ses nouvelles, il disait : « Non, mon bien cher enfant, je ne suis pas mort et je vous aime toujours. Et Vaugirard n’est pas mort non plus, malgré les obus qui pleuvaient dans toute la plaine. Un seul projectile a touché les murs ; la petite chapelle de la nouvelle infirmerie a été saccagée. Dans le parc, les allées sont labourées, mais cette semence prussienne ne poussera pas. Les externes n’ont pas cessé de venir pendant le siège, excepté quand les obus s’opposaient à leur passage. Les internes rentrent maintenant ; bientôt il n’y aura plus qu’un souvenir ! Aux Moulineaux, les Prussiens étaient dans le bois et les Français dans la maison. Les Moulineaux ont échappé comme le reste. Voyez la protection de Dieu[14] ! »
Cette pensée de filiale confiance en Notre-Seigneur se mêle à tout ce qu’il écrit. « Rassurez-vous sur notre sort, mandait-il à une personne inquiète à son sujet[15] ; la divine Providence nous a miraculeusement gardés au milieu des douloureuses péripéties de ces effroyables jours. Malgré les rouges et les Prussiens, malgré les privations et les obus, il n’est pas tombé un seul cheveu de notre tête, car le Seigneur ne l’a pas permis. De toutes les communautés de la rive gauche qui se trouvaient, comme nos trois maisons, dans le tir pendant le bombardement, et sur lesquelles, par conséquent, pleuvaient les obus, je n’ai entendu parler que d’une seule religieuse qui ait été frappée, encore assure-t-on que la bonne Sœur avait demandé à Dieu cette blessure comme une grâce. Les fatigues n’ont pas manqué ; bon nombre d’entre nous, et moi tout le premier, sommes un peu comme des hommes à épuisés qui ont besoin de se refaire ; nous allons nous décarêmer en carême. Bientôt il n’y paraîtra plus. Ah ! s’il pouvait en être ainsi de notre pauvre France ! Si elle voulait, si elle savait comprendre la cause de ses malheurs ! Si, désavouant son impiété sociale, elle revenait à Dieu pour rentrer dans sa vieille mission de nation catholique, armée du glaive, comme un chevalier, pour la défense de la sainte Église, ah ! comme elle se relèverait.... Pauvre France ! comment espérer que le voile épais du mensonge tombe enfin ? »
Et, dans une autre lettre[16], résumant d’un mot ses impressions, il garderait, disait-il, de tous ces événements, « un souvenir mêlé de consolation et de tristesse : tristesse, en pensant à tant de victimes ; consolation, en pensant à tant d’âmes qui s’étaient rapprochées de Dieu. »
Il était loin cependant de croire que tout fût terminé ; l’avenir lui apparaissait bien sombre. « On dort ici comme aux bords de l’Océan, écrit-il quelques jours avant l’insurrection de la Commune[17], sachant bien que l’on peut être réveillé à chaque instant par la tempête ; mais on dort... et le Seigneur garde et Marie étend les mains.... Confiance ! »
« Remerciez avec nous Notre-Seigneur qui nous a si bien gardés et qui nous garde encore, écrivait-il ce même jour à un Père de la Compagnie. Les rouges sont toujours là qui rugissent ; humainement parlant, la position est vraiment critique. La guerre civile peut éclater à chaque instant. Les insurgés ont des batteries de canons et de mitrailleuses braquées sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre. Mais Notre-Seigneur est là. C’est un vrai miracle de sa miséricorde que ces misérables ne soient pas devenus maîtres de tout pendant le siège : il est bien certain que le gouvernement ne les arrêtait pas. Une force mystérieuse, à leur grand étonnement, la main même de Dieu les a contenus et les contient encore. Nous comptons de plus en plus sur le secours de Notre-Seigneur. »
Pour l’obtenir sûrement, le P. Olivaint réclame l’intercession des Saints au ciel et des âmes pures sur la terre. Parlant d’une religieuse du Carmel : « Il ne fallait pas, dit-il, qu’elle quittât Paris. Où donc, au milieu de si cruelles épreuves, où donc eût été la protection et l’expiation pour cette ville coupable, si les anges du sanctuaire avaient fui ? Ne lui parlez pas de partir maintenant. Autant que jamais on a besoin que les prières et les pénitences de la sainte Montagne du Carmel détournent le tonnerre attiré par les hauteurs impies de Montmartre et de Belleville. »
L’horrible assassinat du malheureux Vincenzini (26 février), le meurtre des généraux Lecomte et Clément Thomas (18 mars ;, la fusillade de la place Vendôme (22 mars) servirent de prélude aux atrocités dont les hommes de la Commune allaient se rendre coupables. C’est dans cette inutile manifestation de la paix que tomba, victime de son courage, un des enfants les plus aimés du P. Olivaint.
Paul Odelin, lieutenant au 16e bataillon de la garde mobile de la Seine, avait, durant le siège, fait chrétiennement son devoir. Ce vaillant jeune homme avait toujours rêvé quelque beau dévouement. En 1867, il avait voulu s’engager aux zouaves pontificaux : « Si je meurs, disait-il, je serai martyr, j’irai au ciel tout droit ; c’est la mort qui me convient, à moi ; il faut que ce soit court et bon. » Pendant la guerre, songeant à l’avenir, il entrevoyait la possibilité d’un complet sacrifice de lui-même à Dieu. « Mon cœur, écrivait-il, déborde du besoin de se donner entièrement et sans récompense ici-bas. » Dieu l’exauça ; selon le vœu du généreux enfant, ce fut court et bon...
Le mercredi 22 mars, il marchait donc auprès du drapeau, au premier rang, en uniforme. Épargné par la première décharge, Paul reprocha énergiquement aux fédérés leur indigne guet-apens, et tomba frappé par une balle en pleine poitrine. A cette douloureuse nouvelle, le P. Olivaint accourut et s’agenouillant auprès du mort : « Quelle sérénité, murmura-t-il tout en pleurs ; cher Paul !... J’envie son sort ! » Et s’adressant à la pauvre mère désolée, il ajouta : « Je n’ai pas une parole de consolation à vous dire. Je n’ai pas de consolation pour moi ; comment pourrais-je vous en donner ? Du reste, n’en cherchez pas sur la terre : voyez Paul au ciel et n’en descendez pas. » En disant ces mots, il arrosait de larmes les vêtements ensanglantés de celui qu’il se plaisait à appeler un de ses plus chers enfants de Vaugirard et qu’il pleurait maintenant avec la douleur et l’affection d’un père[18].
Le jour des funérailles, le P. Olivaint, après la messe, fit l’absoute ; mais il put à peine prononcer le» prières ; sa voix était étouffée par les sanglots. Le 25 mars, il écrivait : « Paul Odelin a été tué l’autre jour, à la place Vendôme. Hélas ! pauvre mère !... Priez pour elle, priez pour ce cher jeune homme. C’est une vraie perte : il promettait beaucoup ; il avait le cœur et l’intelligence, la foi et le dévouement, le savoir-faire et le courage. Que de fois je l’ai admiré pendant le siège ! Il était lieutenant dans un bataillon de Belleville, ‘et, bien que parfaitement connu comme catholique, il avait conquis le respect, l’estime, l’affection de ses hommes ; c’était même le catholique qu’on appréciait en lui. Encore un dont le sang noble et pur va peser dans la balance de Dieu du côté de la miséricorde. Sursum corda[19] ! »
Un secret pressentiment l’avertissait qu’il ne tarderait pas à prendre lui-même sa part de l’expiation sanglante. Le lendemain des funérailles de Paul Odelin, le dimanche de la passion, deux mois jour pour jour avant le martyre de la rue Haxo, le P. Olivaint, s’étant rendu une dernière fois au couvent des Oiseaux rempli des souvenirs de sa mère, adressa aux religieuses quelques paroles d’encouragement. Il développait avec une merveilleuse énergie cette divine promesse : « Pas un cheveu ne tombera de votre tête sans la permission du Père céleste[20], » quand, s’interrompant tout à coup : « Vous me direz : il ne s’agit pas d’un cheveu seulement, mais peut-être de la tète.... Eh bien ! si la tête tombe, ce sera avec la permission et la grâce du Père céleste. » Son visage devint radieux, sa voix de plus en plus vibrante : « Quelle faveur serait-ce ? s’écria-t-il. Voyez les apôtres : Ils allaient, transportés de joie d’avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, ibant gaudentes... Soyons, nous aussi, généreux et prêts au sacrifice. Il faut du sang pur à la France pour la régénérer ; mais qui de nous sera jugé digne de verser le sien ? Si nous sommes choisis, quelle grâce ! Si nous sommes laissés, humilions-nous. »
Le même jour, le P. Olivaint visita le P. de Ponlevoy dans la retraite où celui-ci, par obéissance, avait dû se réfugier. Prévoyant un cas extrême qui n’était pas chimérique : « Avant tout, dit-il à son supérieur, si on vient m’arrêter, je veux me poser sur mon terrain et me donner pour ce que je suis : citoyen français, sans doute, mais prêtre, mais jésuite ; car c’est sous ce titre que je vis et que j’entends bien mourir. — Soit, lui fit-il répondu, moriamur in simplicitate nostra[21]. S’il faut mourir, au moins mourons tout entiers et tombons tout d’une pièce[22]. » De retour à la maison de la rue de Sèvres, le P. Olivaint prit avec le plus grand calme ses dernières dispositions. Il réunit les siens autour de lui et leur dit « qu’il fallait s’attendre à servir de victimes.... J’espère être là pour répondre moi-même en cas de surprise, ajouta-t-il. Si on s’en prend à vous, renvoyez à moi ; je suis le responsable. » Puis il indiqua les articles de la Constitution de 1848 et du Code pénal qui protègent la liberté individuelle, le domicile, la propriété....
« A ce moment, raconte un des Pères présents à cette scène, le P. Olivaint remarqua que je souriais un peu en l’entendant parler d’avocat pour nous défendre ; mais il m’expliqua sa pensée : « Je suis le supérieur, me dit-il ; je dois, comme un capitaine de vaisseau, tout tenter pour sauver le navire et ne le quitter que lorsqu’il aura sombré complètement. » Il n’oublia aucun détail dans les conseils qu’il donnait à chacun et qu’il avait eu soin d’écrire en trois grandes pages. Ces notes que nous avons sous les yeux réglaient minutieusement tout ce qui concernait la dispersion, le refuge assigné à chaque Père, la vie religieuse en dehors de la communauté, le fruit spirituel à tirer de ces épreuves, etc. Il se leva en disant : Ils viendront : confiance et courage ! Il savait, à n’en pouvoir douter, qu’ils allaient venir. Le 2 avril, un ami dévoué lui demandant s’il ne jugeait pas prudent de quitter Paris, le P. Olivaint lui répondit du ton le plus naturel : « Nous avons été prévenus par un de ces malheureux[23] qu’une perquisition ici a été décidée. Nous serons probablement arrêtés demain ou après-demain. Que voulez-vous ? Il faut savoir rester à son poste. Qui sait si, dehors, nous ne regretterions pas le bien que peut-être nous pourrons faire dedans ? »
Le 4 avril, de grand matin, on vint lui annoncer que, durant la nuit, un bataillon de fédérés avait violemment envahi l’école Sainte-Geneviève et fait prisonniers huit Pères, quatre frères coadjuteurs et sept domestiques. Ces otages, dont trois, les PP. Léon Ducoudray, Anatole de Bengy et Alexis Clerc, devaient glorieusement mourir, avaient tous été conduits au dépôt près la préfecture de police, vaste prison attenante au Palais de Justice où se trouvait déjà incarcéré M. le président Bonjean, et où, dans la même journée, furent amenés tour à tour Mgr Darboy, Mgr Surat, M. Deguerry, curé de la Madeleine, M. Moléon, curé de Saint-Séverin, M. Crozes, aumônier de la Roquette, l’abbé Allard, ancien missionnaire.
Il avait été décidé d’abord que le P. Olivaint laisserait la maison à la garde de deux Pères et se retire rait en lieu sûr. Mais, à ces tristes nouvelles, « un revirement soudain se fit dans sa disposition, » raconte le P. de Ponlevoy[24]. Tel était son caractère. Tant que le danger n’était que probable, il consentait à s’y soustraire ; maintenant qu’il est à la fois certain et très-prochain, il n’y consentira jamais ; mille fois plutôt s’y précipiter lui-même que d’y abandonner ses frères ! Il apprend ce qui vient de se passer la nuit précédente à l’école Sainte-Geneviève ; il est semi-officiellement prévenu, de la part d’un membre de la Commune, de tout ce qui s’apprête pour le soir. Mais Dieu sans doute lui met au cœur d’attendre ; son parti pris est irrévocable, il attendra de pied ferme. Comme par un mouvement spontané, il va droit au P. Bazin, désigné pour garder la maison : « Mon Père, lui dit-il d’un ton bien décidé, j’ai changé mon premier plan ; vous partez et je reste. » Celui-ci se permet quelques observations en effet très-spécieuses. Mais le P. Olivaint coupe court : « Non, non, ajoute-t-il, il y a du danger, je suis supérieur, je dois et veux rester. » Cela dit, il lui laisse deux cents francs qui restaient encore pour venir en aide à la famille dispersée.
Plusieurs fois dans la journée et jusqu’au soir, les avis se multiplièrent ; au dedans et au dehors on revint à la charge : le P. Olivaint resta inébranlable « Je ne veux pas fuir devant les gens de la Commune, répétait-il ; il faut qu’ils me trouvent ici, s’ils y viennent.... S’ils me font prisonnier, je les suivrai. S’ils font plus, j’espère, avec la grâce de Dieu, leur montrer comment sait mourir un jésuite. »
Un peu avant midi, il répondit encore à une personne qui le suppliait de fuir : « Je suis comme un capitaine de vaisseau qui doit rester le dernier à son bord.... Après tout, si nous sommes pris aujourd’hui, je n’aurai qu’un seul regret, c’est que ce soit le mardi et non le vendredi saint. » A six heures du soir, on vint lui annoncer que la redoutable visite allait avoir lieu entre sept et huit heures. « Allons donc ! répliqua-t-il, pourquoi vous inquiétez-vous ainsi, mon enfant ? le meilleur acte de charité que nous puissions faire, n’est-ce pas de donner notre vie pour l’amour de Jésus-Christ ? »
Il était en habit ecclésiastique, se promenant, d’un pas ferme et décidé, dans le long corridor du rez-de-chaussée, en face de la porte d’entrée, et récitant tranquillement son bréviaire. Un ami vint encore le trouver : « Mais, mon Père, que faites-vous là ? » dit-il. — Le Père lui serra la main et répondit : « J’attends... »
[1]Lettre de Mme la baronne Duchaussoy, du 21 août 1875.
[2]Lettre du 11 septembre 1870 à Mme la marquise de Contactes.
[3]Lettre du même jour à Mme la marquise de Sainte-Marie d’Aigneau.
[4]18 août 1870.
[5]Lettre du 11 septembre 1870 à Mme la marquise de Contados.
[6]Lettre du 11 septembre 1870 au R. P. de Ponlevoy.
[7]Lettre du 14 septembre à Mme la comtesse Laniewska.
[8]M. le comte de Kératry, préfet de police, averti du danger que courait le collège de Vaugirard, s’empressa de prendre des mesures pour le protéger. Le P. Olivaint l’en remercia aussitôt par une lettre que M. de Kératry a insérée dans son livre : Le 4 septembre et le gouvernement de la défense nationale, p. 227. — A ce sujet, le P. Olivaint écrivit au P. de Ponlevoy (14 septembre) : « J’ai remercié le préfet de police de ce qu’il a fait en nous protégeant... Ainsi M. de Kératry devient notre défenseur !... J’ai signé carrément supérieur des Pères jésuites. Ils savent assez déjà ce que nous sommes, et je crois préférable, quelles que soient les difficultés, de ne pas avoir peur de le dire nettement au nom de la liberté. » — Le P. de Ponlevoy répondit : « Vous avez bien fait de remercier : la politesse et la gratitude ne gâtent rien. Si l’on savait combien nous avons à cœur, avec la cause divine, la chose publique ! Tâchons, en faisant nos preuves, de le montrer à Dieu et aux hommes. Le dévouement et la charité sont d’ailleurs le plus sûr de tous les paratonnerres. »
[9]Voici comment le P. Olivaint raconte l’événement auquel il fait ici allusion. « Hier, nous avons eu notre petite alerte. Une méchante fille de quinze ans, qui vient mendier ou voler dans notre église, a été mise à la porte par Xavier (un des sacristains). Alors elle s’est avisée de crier dans la rue qu’on l’avait battue, qu’on l’avait jetée dans une prison toute noire ... La foule s’assemblait et prenait fait et cause pour elle. Je suis arrivé, et j’ai cru que la soutane ne servirait qu’à exciter les colères. Je suis donc resté en observation, attendant le moment où l’église serait envahie. Heureusement Notre-Seigneur a détourné le coup. Notre serrurier qui passait, a empoigné la misérable et, à l’aide de Jeux mobiles, il l’a menée je ne sais où ; la foule alors s’est écoulée et nous n’avons plus rien eu à craindre. Dieu est fidèle ! Croyez, mon révérend Père, que nous comptons bien sur lui, et que nous ne sommes pas déconcertés le moins du monde. Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. » (Lettre au P. de Ponlevoy, 11 septembre 1870.) — Le P. Olivaint s’était demandé si le moment était venu.... Le danger passé, il prit néanmoins la précaution de se jeter sur son lit tout habillé, ne voulant pas être surpris, lendemain, faisant le récit de ce qui s’était passé, il répéta encore : Ce n’était pas encore le moment.
[10]14 octobre.
[11]29 décembre.
[12]26 novembre.
[13]Lettre du 10 février 1871.
[14]Lettre à M. Franco Doria.
[15]Lettre du 26 février 1871 ; à Mme Cabat.
[16]17 mars.
[17]8 mars.
[18]Notice sur Paul Odelin, p. 183 et suiv.
[19]Lettre à Mme Duparc, 25 mars.
[20]Luc, xxi, 18.
[21]Mourons dans notre simplicité (I Mac, n, 35.)
[22]Actes de la captivité et de la mort, etc., par le P. de Ponlevoy, xie édit., p. 23.
[23]Cet homme, que la Commune improvisa maire du Ve arrondissement, avait reçu un service important du P. Olivaint et ne se montra pas ingrat.
[24]Actes..., p. 41.
16:09 Publié dans Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)
30/11/2012
Les Convulsions de Paris (extrait)
Dans son œuvre monumentale (quatre volumes) consacrée à la Commune de 1871, intitulée Les Convulsions de Paris (Paris, Hachette, 1883) Maxime du Camp évoque la massacre de la Roquette (voir le volume premier, Chapitre VIII, pages 243-274).
C’est cet extrait que nous vous proposons ici.
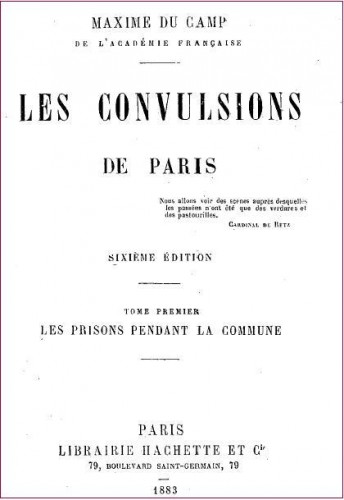
oOo
CHAPITRE VIII
LA GRANDE-ROQUETTE
i – l’arrivée des otages
La maison d’éducation correctionnelle transformée en prison militaire. — Clovis Briant. — Le vin blanc. — Arrêt de mort. — Isidore François, directeur du dépôt des condamnés. — Le brigadier Ramain. — Le personnel des employés. — Un honnête criminel. — Le capitaine Vérig. — La guillotine est brûlée. — Visite de la prison. — Vérig a compris. — A mort les calotins ! — Reçu quarante curés et magistrats. — La mise en cellule des otages. — L’archevêque et le président Bonjean. — Les Pères jésuites. — L’abbé Deguerry. — Deux anciens camarades de collège.
La rue de la Roquette, qui commence place de la Bastille pour aboutir au cimetière du Père-Lachaise, s’élargit vers le dernier tiers de son parcours en une sorte de place carrée, célèbre dans la population parisienne, car c’est là que se font les exécutions capitales. De chaque côté de cet emplacement s’élèvent les hautes murailles de deux prisons : à gauche, c’est la maison d’éducation correctionnelle, que l’on nomme aussi les Jeunes-Détenus et plus communément la Petite-Roquette ; à droite, c’est le dépôt des condamnés, la Grande-Roquette.
L’histoire de la Petite-Roquette pendant la période insurrectionnelle ne présente aucun fait notable. Par suite de l’énorme quantité de soldats, troupe régulière, garde nationale, qui encombraient Paris lors de la guerre franco-allemande, la maison d’éducation correctionnelle était devenue maison de correction militaire. Au 18 mars, elle renfermait soixante et onze gardes nationaux et trois cent trente-six soldats détenus disciplinairement ou par suite de jugement ; ils furent mis en liberté entre le 19 et le 22 mars [1]. On y réintégra les enfants que les nécessités du service avaient forcé d’interner dans d’autres prisons ; il en existait cent dix-sept dans les cellules le 27 mai ; à ce moment ils furent délivrés et armés ; on les poussa à la défense des barricades ; quelques heures après, quatre-vingt-dix-huit d’entre eux étaient volontairement rentrés et demandaient aux surveillants une hospitalité qui ne leur fut pas refusée. C’est dans cette prison que du 20 au 25 mai la Commune fit enfermer les soldats réguliers abandonnés à Paris par le gouvernement légal et qui avaient refusé de s’associer à l’insurrection. Vers la dernière heure, ils étaient à la Petite-Roquette au nombre de mille deux cent trente-trois ; plus tard nous aurons à dire ce que l’on en fit.
Le directeur installé dés le 20 mars par le Comité central et par le délégué à la Préfecture de police se nommait Clovis Briant. C’était un lithographe, jeune, viveur, ami des longs repas, auxquels il conviait ses collègues Carreau de Mazas, Mouton de Sainte-Pélagie, François de la Grande-Roquette ; le sexe aimable ne faisait point défaut à ces fêtes intimes, ni le vin non plus. L’administration normale avait, pendant le mois de janvier, expédié, par erreur, deux pièces de vin blanc à la prison des Jeunes-Détenus ; ces deux pièces étaient gerbées dans la cave, en attendant qu’on vînt les reprendre. Clovis Briant les découvrit, les fit mettre en perce et les but en douze jours avec ses amis. Il avait abandonné la direction de la prison à son personnel, qu’il avait conservé, et ne s’occupait que d’opérations militaires ; c’est ce qui le perdit.
Jusqu’au dernier moment il tint tète sur les barricades du quartier aux troupes françaises ; il fut arrêté le 28 mai, au point du jour ; on avait déjà donné l’ordre de l’incarcérer, et il eût été épargné, lorsqu’un capitaine de fusiliers marins le fit fouiller. Dans un portefeuille rempli de papiers insignifiants, on découvrit le brouillon d’une dépêche ainsi conçue, et adressée au Comité de salut public : « Envoyez-moi des renforts ; faites brûler le quartier de la Bourse et je réponds de tout. » A cette heure, cela équivalait à un arrêt de mort ; il fut immédiatement exécuté.
L’histoire de la Grande-Roquette est moins simple ; car cette prison, qui reçoit les condamnés avant leur départ pour les maisons centrales ou pour le bagne, qui garde un quartier spécialement réservé aux condamnés à mort, fut la dernière étape des otages destinés à mourir. L’homme qui eut à la diriger méritait toute confiance de la part des gens de la Commune. C’était un emballeur, nommé Jean-Baptiste-Isidore François, que la protection et l’amitié d’Augustin Ranvier, directeur de Sainte-Pélagie, avaient fait élever à ce poste. Il fut implacable et fit le mal avec une sorte d’énergie fonctionnelle qui semblait inhérente à sa nature. Se défiant de son personnel d’employés, il avait pris à la maison des Jeunes-Détenus un surveillant, nommé Ramain, à la fois irascible et cauteleux, pour en faire son brigadier. Ces deux hommes aidèrent sans scrupule à tous les crimes qui leur furent demandés.
La haine dévorait François ; pour lui les gendarmes étaient moins que des galériens ; l’idée qu’il existait des prêtres l’affolait. « Voilà quinze cents ans, disait-il, que ces gens-là écrasent le peuple, il faut les tuer ; leur peau n’est même pas bonne à faire des bottes ! » Son ignorance, ses instincts mauvais, son immoralité en faisaient un homme dangereux en temps ordinaire et terrible en temps d’insurrection. François et quelques acolytes de sa trempe gardaient avec soin la Grande-Roquette, non point dans les bureaux de la direction, mais de l’extérieur, chez le marchand de vin qui est au coin de la place et de la rue Saint-Maur. Les bombances, du reste, ne languissaient pas ; comme Clovis Briant, François aimait à traiter ses collègues et à deviser après boire, à côté de la table, dessus ou dessous, des grandes destinées qui s’ouvraient pour le peuple français régénéré par la Commune. Lorsqu’il n’était pas trop gris, il allait, le soir, dans les clubs, et ce qu’il y entendait ne le rappelait guère à la mansuétude.
Les premiers temps qui suivirent la journée du 18 mars furent assez calmes à la Grande-Roquette. En outre de deux cent trente individus légalement condamnés [2], la prison ne contenait guère que des gendarmes et des sergents de ville, arrêtés à Montmartre. Ces braves gens, appartenant à l’élite de l’armée, avaient été si cruellement insultés, frappés, maltraités, qu’ils en avaient conservé un affaissement étrange. Toute force de résistance semblait les avoir abandonnés ; l’idée d’un massacre dont ils seraient victimes les épouvantait et les avait rendus faibles comme des enfants malades. On put le constater à l’heure suprême : nul d’entre eux n’essaya de se soustraire à la mort, ou de lutter contre les assassins ; ils surent mourir et ne surent pas se faire tuer. Malgré le brigadier Ramain, les surveillants étaient fort bons pour les gendarmes, recevaient leur correspondance sans la faire passer par le greffe, leur prêtaient des journaux et ne les laissaient pas manquer de tabac. Quant au vin, les otages pouvaient en avoir lorsque François n’avait pas bu celui de la cantine.
Le personnel des gardiens était remarquable, très dévoué, plus encore que dans nulle autre prison. Cela se comprend : la Roquette renferme en temps normal des criminels fort dangereux, presque toujours exaspérés d’être condamnés à subir bientôt le régime des maisons centrales et rêvant d’y échapper en commettant quelque nouveau méfait qui pourrait leur valoir la déportation ; pour veiller sur ces malfaiteurs prêts à tout, il faut des hommes disciplinés, énergiques et en même temps très justes, car ils ne doivent jamais fournir prétexte aux sévices dont trop souvent ils sont les victimes. La Commune trouva donc à la Roquette un groupe de surveillants animés d’un excellent esprit ; elle crut s’en être rendue maîtresse en leur imposant François, qui leur infligea Ramain ; mais elle avait compté sans leur courage, et ce sont eux qui se sont opposés aux derniers massacres projetés. Elle se trompait souvent sur la qualité des hommes qu’elle appelait à la servir, elle en eut la preuve sans sortir du dépôt des condamnés.
Un homme, que nous appellerons Aimé, y subissait une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée contre lui pour faits de banqueroute frauduleuse. Il était entré en prison à une époque voisine de la guerre et les événements empêchèrent son transfèrement réglementaire à la maison correctionnelle de Poissy. Pendant le siège, une épidémie scorbutique se déclara parmi les détenus de la Grande-Roquette ; Aimé se dévoua, fit le métier d’infirmier, et prouva un bon vouloir dont on lui tint compte. Il était assez intelligent, avait une belle écriture, et il plut à François, qui en fit un commis greffier. François croyait bien avoir fait là un coup de maître, car avoir un homme à soi parmi les détenus, c’est avoir grande chance d’obtenir sur ceux-ci des renseignements secrets dont on peut tirer parti. Clovis Briant vit Aimé au greffe de la Roquette ; il s’y intéressa, voulut lui donner la haute main dans sa prison et le 13 avril 1871 écrivit à Raoul Rigault pour lui demander d’accorder à son protégé une fonction à la maison d’éducation correctionnelle. Aimé fut nommé entrepreneur des travaux de la Petite-Roquette ; pour lui c’était la liberté ; il en profita et s’enfuit de Paris. Il se réfugia en province et prévint sans délai le préfet de police qu’il se tenait à ses ordres « pour se rendre dans telle prison qu’il lui plaira de désigner afin de purger sa peine, car il ne peut et ne veut regarder comme régulière sa mise en liberté accordée illégalement par les agents de la Commune ». L’administration prit d’urgence toute mesure afin d’obtenir une commutation de peine qui équivalait à une grâce entière.
Le poste des fédérés qui gardait la Grande-Roquette n’était guère composé que d’une soixantaine d’hommes ; on fut surpris de voir arriver, le lundi matin 22 mai, un détachement formé de six compagnies empruntées au 206e et au 180e bataillon, qui étaient redoutés dans ce quartier populeux, à cause de leur exaltation et de leur violence. Ces hommes s’établirent dans le poste, au premier guichet et dans la première cour. Ils étaient sous le commandement du capitaine Vérig, ouvrier terrassier, petit homme brun, sec, anguleux, nerveux, ayant des bras d’une longueur démesurée, ce qui lui donnait la démarche oscillante d’un quadrumane, âgé de trente-cinq ans environ, propre à toutes les besognes où il ne faut que de la cruauté et l’amour du mal. Il ne quittait point un long pistolet d’arçon, qui lui servait à accentuer ses ordres ; il commandait : « En avant, marche, ou je fais feu ! » Il était de cette race d’hommes qui ne peuvent supporter d’autre autorité que celle qu’ils exercent eux-mêmes et dont ils abusent insupportablement. La Commune avait eu la main heureuse en choisissant François comme directeur du dépôt des condamnés, car ce fut lui qui découvrit Vérig, sut l’apprécier et lui confia le poste de la prison lorsque l’exécution des otages eut été décidée. Lorsque François avait pris possession de la prison, il y avait trouvé deux malheureux condamnés au dernier supplice, Pasquier et Berthemetz. Le 6 avril, la guillotine fut solennellement brûlée devant la mairie du Xle arrondissement, parce que la Commune répudiait « toute la défroque du moyen âge ».François se rendit dans la cellule d’un des condamnés, le félicita, lui prit les mains et se mit à danser avec lui [3]. Ce bon mouvement de chorégraphie humanitaire ne l’empêcha pas d’agir avec un singulier discernement lorsqu’il mit la prison et les détenus sous la garde de Vérig.
Il promena celui-ci dans la maison et, sous le prétexte de lui en « faire les honneurs » , il lui en montra toutes les dispositions. Après la première cour, l’on entre dans une sorte de vestibule qui est le second guichet ; à gauche s’ouvre le parloir, pièce étroite, séparée en deux parties égales dans la longueur par un double grillage en fer ; à droite, c’est le greffe et à côté l’avant-greffe, c’est-à-dire la chambre où l’on fait la toilette, l’inutile et cruelle toilette des condamnés à mort. En face et dans l’axe du vestibule, une petite porte lamée de fer permet de pénétrer dans la cour principale, large préau d’où se voit l’ensemble de la maison pénitentiaire proprement dite ; au fond, la chapelle ; à droite, le bâtiment de l’ouest, composé d’un rez-de-chaussée où sont les ateliers et de trois étages renfermant chacun une section de cellules ; à gauche, le bâtiment de l’est, avec une distribution analogue ; toutes les fenêtres sont munies de barreaux. Dans l’angle de la cour, à droite, une porte, fortifiée par une grille que l’on ferme le soir, conduit à une assez vaste pièce, qui est le guichet central ; des surveillants y sont en permanence jour et nuit. Lorsque l’on a traversé le guichet central, on entre dans un petit jardin où trois lilas et un marronnier apportent quelque gaîté : c’est là un quartier isolé ; en face, au rez-de-chaussée, la bibliothèque, au-dessus l’infirmerie : à droite, une galerie à arcades où sont situées les trois grandes cellules réservées aux condamnés à mort.
Au bout de la galerie, une porte basse, — la porte de secours, — domine cinq marches par lesquelles on descend dans le premier chemin de ronde qui enveloppe la prison, comme ce chemin de ronde est lui-même enveloppé par un second ; des murs de trente pieds de haut séparent les deux chemins l’un de l’autre et enferment toute la maison derrière deux remparts construits en pierres meulières. Dans leur minutieuse visite, Vérig et François s’arrêtèrent au milieu du petit jardin de l’infirmerie, l’examinèrent avec soin et parurent hésiter ; ensuite ils inspectèrent les deux chemins de ronde et regardèrent longtemps le mur élevé entre le second et un terrain vague qui s’étend jusqu’au coude de la rue de la Folie-Régnault.
C’était là une sorte de promenade extérieure. François et son ami Vérig revinrent au second guichet, traversèrent l’avant-greffe, gravirent un large escalier qui les mena à la quatrième section, long couloir où vingt-trois cellules se font face de chaque côté, de façon que l’on peut y enfermer quarante-six détenus. François fit remarquer à Vérig tout au bout de ce corridor, en face de la vingt-troisième cellule, une forte porte en chêne ; il la fit ouvrir par le surveillant qui les accompagnait, et s’engagea dans l’escalier de secours, escalier étroit, en colimaçon, aboutissant à la galerie du quartier des condamnés à mort ; là il montra du doigt la porte du premier chemin de ronde : Vérig eut un sourire, il avait compris. On parcourut ainsi toute la maison, on constata que chacune des galeries formant une section distincte est fermée à chaque extrémité par une grille de fer, ce qui permet d’isoler les divisions et d’empêcher toute communication d’un étage à l’autre en cas de révolte, car les grilles sont si solides, si puissamment scellées dans les pierres de taille, que nulle force humaine ne parviendrait à les briser ou à les arracher.
François donna encore quelques détails à Vérig ; il lui expliqua que le « bouclage », c’est-à-dire la fermeture des cellules, se faisait régulièrement à six heures du soir ; chaque jour on promène les otages dans le chemin de ronde ; ils sont assez nombreux, quatre-vingt-seize gendarmes, quarante-deux anciens sergents de ville, quatre-vingt-quinze soldats de ligne, quinze artilleurs, un chasseur d’Afrique, un zouave, un turco. Après cette énumération, François ajouta : « Tous capitulards! Cette longue tournée dans la Grande-Roquette, ces explications que Vérig, avait semblé écouter avec intérêt, avaient altéré les deux fauves ; ils allèrent s’abreuver chez le marchand de vin.
Ce même soir, vers dix heures, on entendit un grand bruit sur la place de la Roquette ; les cabarets avaient dégorgé leurs buveurs sur les trottoirs, les fédérés réunis devant la prison battaient des mains et criaient : « A mort les calotins ! » C’étaient les otages enlevés à Mazas qui arrivaient sur les chariots où ils avaient été secoués par les cahots, insultés par la populace, menacés par les gardes nationaux armés qui les escortaient. Un témoin oculaire raconte que Mounier, surveillant de Mazas, chargé de présider à ce transférement, était « plus mort que vif », tant il avait été ému par les injures dont ces malheureux avaient été accablés pendant leur route, sur une voie à demi dépavée, à travers les barricades et parmi les bandes qui vociféraient en leur montrant le poing.
Les deux voitures pénétrèrent dans la cour de la Grande-Roquette ; les otages descendirent et furent réunis pêle-mêle, dans le parloir éclairé d’une lanterne. François se réserva l’honneur de faire l’appel ; il y procéda avec une certaine lenteur emphatique, dévisageant l’archevêque, regardant avec affectation le père Caubert et le père Olivaint, car il voulait voir, disait-il, comment est fait un jésuite. Les formalités de l’écrou ne furent pas longues ; le nom des détenus ne fut inscrit sur aucun registre, on se contenta de serrer dans un tiroir la liste expédiée par le greffe de Mazas. Le reçu que Meunier emporta pour justifier le transfert était singulièrement laconique : Reçu quarante curés et magistrats ; pas de signature, mais simplement le timbre administratif de la prison.
Portant leur petit paquet sous le bras, placés les uns auprès des autres, comptés plusieurs fois par le brigadier Ramain, les otages restaient impassibles, debout et cherchant à trouver un point d’appui contre la muraille, car le trajet dans les voitures de factage les avait fatigués. Ramain prit une lanterne, s’assura d’un coup d’œil que les surveillants étaient prés de lui, puis il dit : « Allons, en route ! » On traversa l’avant-greffe, on franchit le grand escalier, et, tournant à gauche, on pénétra dans la quatrième section. Une sorte de classement hiérarchique présida au choix des cellules : Mgr Darboy eut le n°1, M. le président Bonjean le n°2, M. Deguerry le n°3, Mgr Surat, archidiacre de Paris, le n°4 ; la meilleure cellule, moins étroite et moins dénuée que les autres, le n°25, échut à l’abbé de Marsy.
Dés qu’un des otages, obéissant aux ordres de Ramain surveillé par François, avait dépassé la porte de son cabanon, celle-ci était fermée ; on poussait le gros verrou et un tour de clé « bouclait » le malheureux. Nulle lumière ; l’obscurité était complète dans ces cachots ; on tàta les murs, on essaya de se reconnaître dans la nuit profonde. L’ameublement se composait d’une couchette en fer, garnie d’une paillasse, d’un matelas, d’un traversin, le tout enveloppé d’un drap de toile bise et d’une maigre couverture ; pas une chaise, pas un escabeau, pas un vase, pas même la cruche d’eau traditionnelle. Au petit jour, les détenus placés dans les cellules de droite purent apercevoir le premier chemin de ronde ; ceux qui étaient à gauche avaient vue sur le préau, que l’on nomme aussi la cour principale.
Le bruit d’une maison qui s’éveille, la rumeur des détenus de droit commun qui tranaient leurs sabots sur les pavés, ne laissèrent pas les otages dormir longtemps le matin. M. Rabut qui, en qualité de commissaire de police, connaissait bien le règlement disciplinaire des prisons, voyant le brigadier passer dans le couloir, lui demanda de l’eau ; le président Bonjean réclama une chaise ; à l’un et à l’autre Ramain répondit : « Bah ! pour le temps que vous avez à rester ici, ce n’est pas la peine ! »
Depuis le 26 avril, depuis l’entrée de Garreau à Mazas, les otages avaient vécu isolés les uns des autres ; s’ils s’étaient promenés, c’était seuls, dans le préau cellulaire, sans aucune relation avec leurs compagnons de captivité. Ils s’imaginaient qu’il en serait ainsi à la Grande-Roquette et furent surpris lorsqu’on les fit descendre tous ensemble par l’escalier de secours et qu’on les réunit dans le premier chemin de ronde. Ils éprouvèrent une sorte de joie enfantine à se retrouver, à pouvoir causer, à se communiquer leurs impressions, qui étaient loin d’être rassurantes. L’archevêque fut très entouré, les prêtres vinrent lui baiser la main et lui demander sa bénédiction. Il ne quittait pas M. Bonjean, auquel il offrait le bras, car le président était souffrant et très affaibli. Il avait voulu, pendant le siège, malgré son âge et ses fonctions, faire acte de soldat ; le sac avait été trop pesant pour ses frêles épaules ; il en était résulté une infirmité pénible que son séjour en prison ne lui permettait pas de combattre par des moyens artificiels. Il marchait donc « courbé en deux », comme l’on dit, et trouvait sur le bras de Mgr Darboy un appui qui lui était indispensable. Le plus souvent, ne pouvant suivre ses compagnons dans leur promenade, il s’asseyait au bord d’une guérite, où chacun venait s’entretenir avec lui. M. Rabut alla saluer le président, qui le présenta à l’archevêque. « Qu’augurez-vous de notre transfèrement? lui demanda celui-ci. — Rien de bon, monseigneur, » répondit M. Rabut.
Les jésuites, fort calmes, gardant sur les lèvres leur immuable sourire, ayant du fond du cœur renoncé à tout, même à la vie, disant à Dieu : Non recuso laborem, se promenaient et devisaient entre eux, ou écoutaient un missionnaire qui, revenant de Chine, pouvait leur expliquer que sous toute latitude l’homme rendu à lui-même et soustrait à la loi est ressaisi par le péché originel et redevient fatalement une bête sauvage. Le père Allard, l’aumônier des ambulances, portait encore au bras gauche la croix de Genève, ostentation de bon aloi qui forçait les gens de la Commune à violer toutes les conventions, même celle qui sur les champs de bataille protège les infirmiers. L’abbé Deguerry, actif et rassuré par la bonne compagnie qu’il retrouvait enfin, causait avec verve et essayait de faire partager à ses compagnons l’espérance dont il était animé. « Quel mal leur avons-nous fait ? répétait-il à toute objection ; quel intérêt auraient-ils à nous en faire ? » Puis il accusait, en plaisantant, les lits de la Roquette d’être trop courts pour sa longue taille.
Deux otages qui ne s’étaient point rencontrés depuis trente-quatre ans, depuis les jours du collège, se reconnurent. L’un, ses études terminées, obéissant à une irrésistible vocation, avait suivi la voie religieuse ; il était entré dans les ordres et appartenait à la Société de Jésus. Lorsqu’il fut amené au Dépôt de la préfecture de police et qu’on l’interrogea afin de pouvoir remplir les formalités de l’écrou, il répondit : « Pierre Olivaint, prêtre et jésuite, » revendiquant ainsi comme un titre de gloire cette qualification si périlleuse alors et si détestée. L’autre, ancien officier de l’armée, avait quitté l’état militaire et avait embrassé, par goût, l’ingrate carrière de l’enseignement ; c’était M. Chevriaux, proviseur du lycée de Vanves. Pourquoi avait-il été arrêté et incarcéré ? Son crime était d’avoir gardé fidèlement son poste, qu’il ne croyait pas pouvoir abandonner sans un ordre de l’autorité légale. Dénoncé à Raoul Rigault comme « agent versaillais », il avait été enlevé le 1er mai et jeté à Mazas. Le hasard des révolutions et l’insanité de la Commune remettaient en présence dans le préau d’une geôle ces camarades de la vingtième année. Ils s’embrassèrent et furent émus. Ils ne conservaient d’illusion ni l’un ni l’autre, et lorsque le prêtre demanda au laïque s’il était préparé à mourir, s’il avait mis ordre aux choses mystérieuses de la conscience, celui-ci put répondre que, grâce à un prêtre des missions étrangères, son voisin de cellule, il était en paix avec lui-même et délié vis-à-vis de Dieu. « C’est bien, répliqua Pierre Olivaint ; mais ne te semble-t-il pas, mon cher ami, que tu m’appartenais et que j’ai presque le droit d’être jaloux ? » Deux jours après, Olivaint devait tomber à l’abattoir de la rue Haxo, laissant un impérissable souvenir à ceux qui lui ont survécu et dont son héroïque sérénité avait soutenu les cœurs pendant les angoisses des derniers jours.
ii. — la mort des otages
La Commune se réfugie à la mairie du onzième arrondissement. — Les incendiaires de l’Hôtel de Ville. — Le comte de Beaufort. — Le massacre des otages est résolu. — La cour martiale. — Gustave-Ernest Genton. — Le bouclage. — L’archevêque change de cellule. — Quatre femmes incarcérées à la Roquette. — Arrivée du peloton d’exécution. — Mandat irrégulier. — Résistance du greffier. — Modification à la liste primitive. — Edmond Mégy. — Benjamin Sicard. — Le surveillant Henrion. — Henrion se sauve en cachant les clefs. — Le brigadier Ramain et le surveillant Beaucé. — L’appel. — Les adieux du président Bonjean. — Les assassins discutent. — L’absolution. — « il fredonnait. » — « Tu nous embêtes. » — Le feu de peloton. — Le coup de grâce. — Les remords de Mégy. —Vol dans les cellules. — Émeraude ou diamant ?— On dépouille les morts. — Les corps sont transportés au cimetière de l’Est. — L’eau du ciel.
A quatre heures, « la récréation » dut prendre fin ; les otages furent reconduits dans leur section ; mais la porte de leur cellule ne fut fermée qu’à six heures, au moment du « bouclage » réglementaire de la prison ; ils purent donc encore rester quelque temps ensemble. Pendant leur promenade, ils avaient attentivement prêté l’oreille aux bruits du dehors, et c’est à peine si de lointaines détonations d’artillerie étaient parvenues jusqu’à eux. On était au mardi 25, et la bataille ne se rapprochait pas de la Roquette. Un surveillant leur avait dit : « Le dernier quartier général de l’insurrection sera Belleville ; il faut prendre patience et courage ; la grande lutte sera autour de nous. » Les otages avaient fait l’expérience de leur nouvelle demeure et du système auburnien, qui laisse les détenus en commun pendant le jour et les isole pendant la nuit. Pour eux, c’était une grande amélioration. Le matin, on avait remis à chacun d’eux une écuelle avec laquelle ils avaient été à la distribution des vivres ; ils avaient reçu leur portion de « secs », comme l’on dit dans les prisons, c’est-à-dire de légumes délayés dans de l’eau. Tant bien que mal, après avoir avalé leur pitance, ils s’étaient endormis, l’estomac léger et la conscience en repos.
Le lendemain, 24 mai, dans la journée, un surveillant leur dit : « Il y a du nouveau ; toute la clique de la Commune est à la mairie du XIe arrondissement. » Or cette mairie est située place du Prince-Eugène, au point d’intersection du boulevard Voltaire et de l’avenue Parmentier, à trois cents mètres à peine de la Roquette ; c’était un mauvais voisinage. En effet, la veille, dans la soirée, la Commune et le Comité de salut public avaient tenu leur dernière séance à l’Hôtel de Ville. On avait décidé d’évacuer le vieux palais populaire et de transporter « le gouvernement » au pied même de Belleville, à l’abri de la colline du Père-Lachaise, non loin des portes de Vincennes, d’Aubervilliers et de Romainville, qui permettraient peut-être de tenter une fuite sur la zone occupée par les Allemands. Les trois services importants, la guerre, la sûreté générale, les finances, s’étaient donc installés dans les salles de la mairie du XIe arrondissement ; c’est là que Ferré était accouru, après avoir fait fusiller Georges Vaysset et n’avoir pas réussi à faire tuer d’autres détenus du Dépôt.
C’était peu d’évacuer l’Hôtel de Ville, il fallut l’incendier. Quelques bandits se chargèrent de l’exécution de ce crime et s’en acquittèrent en conscience, aidés par les fédérés du 174e bataillon et par deux compagnies des Vengeurs de Flourens. Toute la place fut bientôt en feu, car non seulement on brûla l’Hôtel de Ville, mais aussi les bâtiments de l’octroi qui lui faisaient face, et les Archives, et l’Assistance publique, où plus d’un des incendiaires avait tendu une main que l’on n’avait pas repoussée. Dans la matinée du 24, des fédérés du 174e bataillon passaient sur le quai Saint-Bernard et disaient joyeusement : « Nous venons d’allumer le château Haussmann et nous allons à la Butte-aux-Cailles cogner sur les Versaillais. »
La rage du meurtre avait saisi les gens de la Commune ; les gardes nationaux n’obéissaient plus qu’à eux-mêmes, soupçonneux, ne comprenant rien à leur défaite, car on leur avait promis la victoire, criant à la trahison dès qu’un projectile tombait au milieu d’eux, farouches et pris du besoin de tuer. Dans la matinée du 24, un officier qui avait été attaché à l’état-major de Cluseret fait effort pour arriver jusqu’à la mairie du XIe arrondissement ; aux barricades, on l’arrête pour qu’il aide à porter des pavés ; il dit qu’il a des ordres à transmettre et parle de son grade qui doit être respecté ; on lui crie : « Aujourd’hui il n’y a plus de galons ! » Quelqu’un dit : « C’est un traître, il est vendu à Versailles. » On le saisit, on le traîne dans une boutique, on le juge, il est condamné à être dégradé et à servir comme simple soldat ; il répond que ça lui est indifférent, et d’emblée on le proclame capitaine. Cette farce tourna subitement au sinistre. Le malheureux sortit ; dès qu’il reparut sur le boulevard Voltaire, on lui cria qu’il était un Versaillais. Des marins l’enlevèrent sur leurs épaules et le promenèrent sur la place, pendant que des femmes essayaient de le frapper à coups de ciseaux. On le poussa enfin dans un terrain vague où s’ouvre aujourd’hui la rue de Rochebrune et on le fusilla. C’était le comte de Beaufort ; on est surpris de sa qualité et on se demande ce qu’il faisait dans cette galère. Delescluze le regarda mourir, et cependant il avait tenté de le sauver ; vainement il avait demandé un délai de deux heures pour interroger le prétendu coupable, vainement il essaya d’émouvoir quelques sentiments humains dans la tourbe qui l’entourait, Beaufort fut assassiné, car plus d’un des meurtriers avaient intérêt à se débarrasser de lui. [4] En étudiant de près cette histoire, on découvrirait peut-être qu’elle eut une amourette pour début, et qu’une vengeance particulière intervint au dénouement.
Delescluze, délégué à la guerre. Ferré, délégué à la sûreté générale, s’étaient donc établis à la mairie du XIe arrondissement. Des membres du Comité de salut public et de la Commune les assistaient. Ces hommes sentaient que tout était fini ; ils n’avaient rien su faire de leur victoire, ils ne voulaient consentir à accepter leur défaite et rêvaient de disparaître dans quelque épouvantable écroulement. Ce fut alors sans doute que le massacre des otages fut résolu. Delescluze se mêla-t-il à cette odieuse délibération ? On ne le sait ; c’était un sectaire très capable de commettre un crime politique pour servir sa cause, mais qui devait hésiter à conseiller un crime inutile, dont le résultat ne pouvait que rendre son parti méprisable et compromettre l’avenir.
Là, dans cette mairie encombrée d’officiers qui venaient demander de l’argent, de blessés qu’on apportait, de munitions entassées partout, de tonneaux de vin que l’on roulait à côté des tonneaux de pétrole et des tonneaux de poudre, assourdi par le brouhaha des batailles et les clameurs de cent personnes criant à la fois, on établit une cour martiale. Un vieillard inconnu et qui était, dit-on, sordide, un officier fédéré qui, dit-on, était ivre, composèrent un tribunal sous la présidence de Gustave-Ernest Genton. Ce Genton était un ancien menuisier, ayant un peu sculpté sur bois, dont la Commune avait fait un magistrat, et qu’à la dernière heure elle abaissait au rang de président de sa cour martiale. Qu’une cour martiale soit instituée par une insurrection pour se débarrasser d’adversaires pris les armes à la main, cela peut jusqu’à un certain point s’expliquer ; mais juger et faire exécuter des prêtres, des magistrats arrêtés depuis deux mois, qui n’ont même pas eu la possibilité de combattre la révolte, c’est incompréhensible et demeure un des faits les plus extraordinaires de l’histoire.
Genton était un lourd garçon, ordinairement paresseux, de taille petite, épais, gros, à face brutale avec les yeux saillants, la lèvre inférieure proéminente comme celle des ivrognes de profession, portant toute la barbe et une chevelure grisonnante. Il y eut une discussion dont plus tard, devant le 6e conseil de guerre, on essaya de se prévaloir en la déplaçant. On a prétendu que le premier ordre d’exécution transmis à la Roquette concernait soixante-six otages et qu’il avait été modifié sur les instances du directeur François. C’est là une erreur. Une discussion s’éleva en effet dans le greffe de la prison, mais sur un autre objet, que nous ferons connaître. La cour martiale n’était point d’accord sur le chiffre des otages que l’on devait tuer ; le nombre soixante-six fut proposé et écarté, « parce que ça ferait trop d’embarras. » On s’arrêta au nombre de six : deux noms seulement furent désignés, celui de M. Bonjean et celui de l’archevêque de Paris.
Pendant que l’on délibérait sur la destinée des otages, ceux-ci avaient, comme la veille, été conduits au chemin de ronde qui leur servait de préau. Rien, extérieurement du moins, n’était changé dans leur situation : ils avaient eu leur distribution de vivres, avaient causé avec les surveillants et avaient été reconduits à quatre heures dans leur section. Ils avaient remarqué cependant, avec une certaine surprise, qu’on les avait engagés à se hâter lorsqu’ils remontaient l’escalier et que leurs cellules, au lieu de rester ouvertes jusqu’à l’heure du bouclage, avaient été fermées au verrou et à la clef. Pendant la promenade, Mgr Darboy s’était plaint d’être dans un cabanon trop étroit où il n’avait que son grabat pour s’asseoir. L’abbé de Marsy lui avait alors proposé de lui céder sa cellule, le n° 23, qui était plus spacieuse, munie d’une chaise, d’une table et même d’un petit porte-manteau. L’archevêque avait accepté. Sur le croisillon de fer qui sépare le judas de la porte, l’abbé de Marsy avait dessiné les instruments de la passion et écrit : Robur mentis, viri salus ; comme au Dépôt de la préfecture de police, Mgr Darboy avait tracé un crucifix sur le mur de la cellule qui lui avait été attribuée.
La journée eût été normale à la Grande-Roquette si, dans la matinée, on n’y eût amené quatre femmes. Conduites par des fédérés, elles furent poussées au greffe et ordre fut donné de les incarcérer. Elles venaient de la rue Oberkampf, où elles étaient restées afin de veiller sur leur maison de commerce en l’absence de leurs maris partis pour éviter de servir la Commune. Elles avaient refusé de livrer les chevaux et les voitures que l’on réquisitionnait chez elles ; le cas était pendable ; les quatre prisonnières furent écrouées et enfermées ensemble dans une cellule du quartier des condamnés à mort.
Entre quatre et cinq heures du soir, François était à son poste d’observation habituel, c’est-à-dire chez le marchand de vin, lorsqu’il aperçut un détachement qui, précédé par Genton, gravissait la rue de la Roquette ; il dit à l’ami avec lequel il buvait : « Tiens ! voilà le peloton d’exécution qui vient chez nous. » Il se leva et arriva à la prison en même temps que les fédérés, parmi lesquels on remarquait quelques hommes à casquette blanche appartenant aux Vengeurs de Flourens et un individu costumé, — déguisé ? — en pompier. François, Genton, Vérig, deux officiers, dont l’un portait l’écharpe rouge à crépines d’or, pénétrèrent dans le greffe. François demanda : « Est-ce pour aujourd’hui ? » Genton répondit par un signe affirmatif. Celui-ci remit un ordre au directeur, qui le lut et le passa au greffier. Le greffier en prit connaissance et dit : « Le mandat est irrégulier, nous ne pouvons y donner suite. » L’officier à ceinture rouge eut un geste de colère : « Est-ce que tu serais un Versaillais, toi ? » Le greffier répliqua avec calme que l’ordre prescrivait d’exécuter six otages, mais que deux noms seuls étaient indiqués ; cela ne suffisait pas : les individus condamnés à mort devaient être désignés nominativement, afin d’éviter toute erreur et pour assurer la régularité des écritures. C’est sur ce point et non pas sur le nombre des otages à fusiller que la discussion s’engagea. Les fédérés qui se tenaient dans la cour accouraient dans le greffe, qu’ils encombraient ; le greffier ordonna de fermer les portes et de ne plus laisser entrer personne.
Le greffier, se retranchant derrière les nécessités du service et les devoirs de sa charge, ne démordit pas de son opinion, qu’il finit par faire partager à François. Le directeur sembla pris de scrupule et dit : « Les choses doivent se passer régulièrement pour mettre ma responsabilité à couvert. » Genton céda, il demanda le livre d’écrou ; les noms des otages n’y avaient point été portés ; on cherchait la liste expédiée par le greffe de Mazas, on ne la retrouvait pas. L’homme à l’écharpe rouge s’impatientait fort et disait : « Eh bien ! c’est donc ici comme du temps du vieux Badingue et l’on se moque des patriotes ; j’en ai tué qui n’en avaient pas tant fait ! » Enfin la liste fut découverte sous des registres qui la cachaient. Genton se mit à l’œuvre et écrivit dans l’ordre suivant : Darboy, Bonjean, Jecker, Allard, Clerc, Ducoudray. Il s’arrêta, sembla réfléchir, puis brusquement effaça le nom de Jecker et le remplaça par celui de l’abbé Deguerry. Montrant la liste à François, il lui dit : « Ça te convient-il comme ça ? » François répondit : « Ça m’est égal, si c’est approuvé. » Genton eut un mouvement d’impatience : « Que le diable t’emporte ! Je vais au Comité de salut public et je reviens. » Il s’éloigna, seul, rapidement vers la place du Prince-Eugène.
Les fédérés se répandirent dans la cour et l’homme à l’écharpe rouge resta dans le greffe, où il malmena François, qui n’était pas « à la hauteur des circonstances » et qui n’avait pas un esprit « vraiment révolutionnaire ». L’ivrogne s’excusait de son mieux et paraissait peu à l’aise en présence de cet officier rébarbatif. Celui-ci était un assez beau garçon, brun, prenant des poses, et malgré son grade, qui paraissait élevé, portant un fusil sur l’épaule. On a beaucoup discuté pour savoir quel était cet individu, que les employés de la prison considéraient, à cause de son écharpe, comme un membre de la Commune ; on l’a pris pour Eudes, pour Ferré, pour Ranvier, surtout pour Ranvier. On s’est trompé ; nous pouvons le nommer : c’était Mégy, que la révolution du 4 septembre avait été chercher au bagne de Toulon, où il subissait une peine de quinze ans de travaux forcés, méritée par un assassinat, pour en faire un porte-drapeau dans un bataillon de garde nationale. Il souffleta son capitaine, fut, pour ce fait, condamné à deux ans de prison et délivré le 18 mars. La Commune ne pouvait négliger cet homme qui tuait les inspecteurs de police à coups de revolver ; elle en lit une sorte d’émissaire diplomatique et l’envoya prêcher la République universelle à Marseille en compagnie de Landeck et de Gaston Crémieux. Le général Espivent interrompit cette farandole révolutionnaire, et Mégy, qui excelle à se sauver quand l’occasion s’en présente, put revenir à Paris. Il fut nommé commandant du fort d’Issy, qu’il abandonna aussitôt que l’occasion lui parut propice. Le 22 mai, il était sur la rive gauche de la Seine ; c’est à lui et c’est à Eudes que l’on doit l’incendie de la Cour des comptes, du palais de la Légion d’honneur, de la rue de Lille, de la rue du Bac et de la Caisse des dépôts et consignations. Tel était le général, — on l’appelait ainsi, — qui venait en amateur donner un coup de main pour assassiner quelques vieillards. L’autre officier, remarquable par les pommettes roses et les yeux brillants ordinaires aux phithisiques, s’appelait Benjamin Sicard ; capitaine au 101e bataillon, il était détaché, en qualité de capitaine d’ordonnance, à la Préfecture de police ; c’est ce qui justifiait les aiguillettes d’or dont il avait orné son uniforme. Il avait été envoyé par le délégué à la sûreté générale, par Ferré, pour surveiller l’exécution des otages et pour en rendre compte.
Les fédérés du peloton amené par Genton s’étaient mêlés à ceux de Vérig. Un surveillant nommé Henrion s’approcha d’eux et, parlant à un groupe de Vengeurs de Flourens, il leur dit : « Prenez garde, ce sont des assassinats que vous allez commettre, vous les payerez plus tard. » L’un d’eux répondit : « Que voulez-vous ? Ce n’est pas amusant ; mais nous avons fusillé ce matin à la Préfecture de police, maintenant il faut fusiller ici ; c’est l’ordre. » Henrion reprit : « C’est un crime. — Je ne sais pas, répliqua le vengeur ; on nous a dit que c’étaient des représailles, parce que les Versaillais nous tuent nos hommes. » Henrion s’éloigna et rentra dans le vestibule, à côté du greffe, car il était de service. Genton revint au bout de trois quarts d’heure, il n’avait pas l’air content ; il est probable que Ferré l’avait réprimandé pour n’avoir pas procédé malgré la demi-opposition de François. Celui-ci prit l’ordre d’exécution nominatif cette fois et approuvé ; il dit : « C’est en règle, » et « sonna au brigadier ». Ramain arriva ; François lui remit la liste, en lui disant : « Voilà des détenus qu’il faut faire descendre par le quartier de l’infirmerie. »
Ramain appela Henrion, celui-ci se présenta. Ramain lui dit : « Allez ouvrir la grille de la quatrième section. » Henrion répondit : « Je vais chercher mes clefs ! » Ses clefs, il les tenait à la main ; il s’élança dehors, jeta les clefs derrière un tas d’ordures et prit sa course comme un homme affolé. L’idée du massacre que l’on préparait lui faisait horreur. D’une seule haleine, il courut jusqu’à la barrière de Vincennes, put passer grâce à un mensonge appuyé d’une pièce de vingt francs, se jeta à travers champs et arriva à Pantin couvert de sueur et de larmes. Des soldats bavarois le recueillirent ; il ne cessait de sangloter en répétant : « Ils vont les tuer ! ils vont les tuer [5] ! »
Pendant que cet honnête homme fuyait la maison où s’amassaient les crimes, Ramain, furieux, appelait Henrion, qui ne répondait guère. Genton demandait si l’on se moquait de lui ; François perdait contenance, et Mégy, glissant une cartouche dans son fusil, disait : « Nous allons voir ! » Ramain dit alors à François : « Faites monter le peloton au premier étage, je cours chercher mes clefs au guichet central, je passerai par l’escalier de secours et j’ouvrirai par le couloir. » Lourdement les quarante hommes, ayant en tête François, Genton, Mégy, Benjamin Sicard et Vérig, gravirent l’escalier. Ramain enjamba la cour intérieure, pénétra dans le guichet central, enleva les clefs accrochées à un clou, et donnant la liste des otages au surveillant Beaucé, il lui dit : « Va faire l’appel » ; puis lestement il monta les degrés de l’escalier, franchit la galerie de la quatrième section et ouvrit la grille. Le peloton se divisa en deux groupes à peu près égaux, de vingt hommes chacun ; l’un resta massé devant la grille ouverte ; l’autre traversa le couloir, longeant les cellules où les otages étaient enfermés, descendit l’escalier de secours et fit halte dans le jardin de l’infirmerie. « Nous entendions les battements de notre cœur, » a dit un des otages survivants. Le bruit des pas cadencés, le froissement des armes ne leur laissaient point de doute ; ils comprirent que l’heure était venue. Qui allait mourir ? Tous se préparèrent.
Ramain attendait le surveillant Beaucé, auquel il avait remis la liste ; ne le voyant pas venir, il descendit le petit escalier pour aller le chercher au guichet central. Beaucé s’était disposé à obéir, croyant accomplir une formalité sans importance ; mais au moment où il allait se rendre à la quatrième section pour y appeler les six détenus désignés, il se croisa avec le détachement du peloton d’exécution, qui attendait dans le quartier de l’infirmerie ; il comprit ; il s’affaissa sur lui-même, collé contre la muraille, sur la première marche de l’escalier, et se sentit incapable de faire un pas de plus. Ramain accourut : « Allons, Beaucé, arrivez donc ! » Beaucé, tremblant, répondit : « Je ne peux pas, non, je ne pourrai jamais ! » Ramain s’élança vers lui, lui arracha des mains la liste et la clef qui ouvrait les cellules, et lui dit avec mépris : « Imbécile, tu n’entends rien aux révolutions. » Beaucé se sauva et courut s’enfermer dans le guichet central.
Ramain remonta ; tous les otages avaient mis l’œil au petit judas de leur porte et tâchaient de voir ce qui se passait dans la galerie. Ramain appela : « Darboy ! » et se dirigea vers la cellule n°l. A l’autre extrémité du couloir, il entendit une voix très calme qui répondait : « Présent ! » On alla ouvrir le cabanon n° 23, et l’archevêque sortit : on le conduisit au milieu de la section, à un endroit plus large qui forme une sorte de palier. On appela : « Bonjean ! » Le président répondit : « Me voilà, je prends mon paletot. » Ramain le saisit par le bras et le fit sortir en lui disant : « Ça n’est pas la peine, vous êtes bien comme cela ! » On appela Deguerry. Nulle voix ne se fit entendre ; on répéta le nom, et, après quelques instants, le curé de la Madeleine vint se placer à côté de M. Bonjean. Les pères Clerc, Allard, Ducoudray répondirent immédiatement et furent réunis à leurs compagnons. Ramain dit : « Le compte y est ! » François compta les victimes et approuva d’un geste de la tête.
Le peloton qui était resté devant la grille d’entrée s’ébranla et s’avança vers les otages, à la tète desquels le brigadier Ramain s’était placé pour indiquer la route à suivre. Deux surveillants, appuyés contre le mur, baissaient la tête et détournaient les yeux. En passant près d’eux, le président Bonjean dit à très haute voix : « Ô ma femme bien-aimée ! ô mes enfants chéris ! » Etait-ce donc un de ces mouvements de faiblesse naturels aux cœurs les plus fermes ? Non, cet homme incomparable fut héroïque jusqu’au bout ; mais il espérait que ses paroles seraient répétées, parviendraient à ceux qu’il aimait et leur prouveraient que sa dernière pensée avait été pour eux.
Sous la conduite de Ramain, le cortège descendit l’escalier de secours, et, parvenu dans la galerie qui côtoie les cellules des condamnés à mort, rejoignit le premier détachement des fédérés. Là on s’arrêta pendant quelques instants. Mégy, montrant le petit jardin, disait : « Nous serons très bien ici. » Vérig insistait afin que l’on allât plus loin, et, comme pour trouver un auxiliaire à son opinion, cherchait François des yeux ; François n’avait pas suivi les otages, il était retourné au greffe. On agita devant ces malheureux la question de savoir si on les fusillerait là ou ailleurs. Ils avaient profité de cette discussion pour s’agenouiller les uns près des autres et pour faire une prière en commun. Cela fit rire quelques fédérés, qui les insultèrent. Un sous-officier intervint : « Laissez ces gens tranquilles, nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain. »
Pendant ce temps, Vérig, Genton et Mégy étaient enfin tombés d’accord : là on serait trop en vue. Ramain ouvrit la petite porte donnant sur le premier chemin de ronde ; l’archevêque passa le premier, descendit rapidement les cinq marches et se retourna. Lorsque ses compagnons de martyre furent tous sur les degrés, il leva la main droite, les trois premiers doigts étendus, et il prononça la formule de l’absolution : Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis ! Puis, s’approchant de M. Bonjean, qui marchait avec peine, pour les causes que nous avons dites, il lui offrit son bras. Toujours précédé par Ramain, entouré, derrière et sur les flancs, par les fédérés, le cortège prit à droite, puis encore à droite, et s’engagea dans le long premier chemin de ronde qui aboutit près de la première cour de la prison. En tête, un peu en avant des autres, marchait l’abbé Allard, agitant les mains au-dessus de son front. Un témoin, parlant de lui, a dit : « Il allait vite, gesticulait et fredonnait quelque chose. » Ce quelque chose était la prière des agonisants qu’il murmurait à demi-voix. Tous les autres restaient silencieux.
On arriva à cette grille que l’on appelle la grille des morts et qui clôt le premier chemin de ronde ; elle était fermée. Ramain, qui était fort troublé, malgré qu’il en eût, cherchait vainement la clef au milieu du trousseau qu’il portait. A ce moment, Mgr Darboy, moins peut-être pour disputer sa vie à ses bourreaux que pour leur épargner un crime, essaya de discuter avec eux. « J’ai toujours aimé le peuple, j’ai toujours aimé la liberté », disait-il. Un fédéré lui répondit : « Ta liberté n’est pas la nôtre, tu nous embêtes ! » L’archevêque se tut et attendit que Ramain eût ouvert la grille. L’abbé Allard se retourna, regarda vers la fenêtre de la quatrième section et put apercevoir quelques détenus qui les contemplaient en pleurant. On tourna à gauche, puis tout de suite encore à gauche, et l’on entra dans le second chemin de ronde, dont la haute muraille noire semblait en deuil. Au fond s’élevait le mur qui sépare la prison des terrains adjacents à la rue de la Folie-Regnault.
C’était l’endroit que François et Vérig étaient venus reconnaître ensemble dans la journée du 22. Il était bien choisi et fermé à tous les regards ; c’était une sorte de basse-fosse en plein air, propre aux guets-apens. Ramain s’en était allé. Les victimes et les meurtriers restaient seuls en présence, sans témoin qui plus tard pût parler à la justice. D’après la place où les corps ont été retrouvés, on sait que les otages furent disposés dans l’ordre hiérarchique qui avait présidé à leur classement en cellules. On les rangea contre le mur faisant face au peloton d’exécution, Mgr Darboy le premier, puis le président Bonjean, l’abbé Deguerry, le père Ducoudray, le père Clerc, tous deux de la Compagnie de Jésus, et enfin l’abbé Allard, l’aumônier des ambulances, qui, pendant le siège et lors des premiers combats de la Commune, avait sauvé tant de blessés. Le peloton s’était arrêté à trente pas de ces six hommes debout et résignés. Ce fut Genton qui commanda le feu. On entendit deux feux de peloton successifs et quelques coups de fusil isolés. Il était alors huit heures moins un quart du soir [6].
Dans ce multiple assassinat, Genton. président de la cour martiale, représentait la justice de la Commune ; Benjamin Sicard représentait la sûreté générale, c’est-à-dire la police telle que Théophile Ferré la pratiquait ; Vérig représentait l’armée de la guerre civile ; Mégy, acteur volontaire, représentait la haine sociale dans le but qu’elle poursuit.
On a dit que chacun des hommes qui avaient fait partie du peloton d’exécution reçut une gratification de cinquante francs ; le fait est possible et nous ne l’infirmons pas, quoique nous n’en ayons trouvé aucune preuve. Il est dans la tradition terroriste : aux massacres des prisons en septembre 1792, « les travailleurs », comme on les appela, touchèrent chacun un écu de six livres pour dédommagement de la perte de leur journée. Parlant de ces massacres, Robert Lindet a dit : « C’est l’application impartiale des principes du droit naturel. » Peut-être eût-il répété cette parole s’il eût compté les gens de bien étendus sans vie dans le chemin de ronde de la Grande-Roquette.
Lorsque le peloton sortit sur la place qui s’étend devant le dépôt des condamnés, la foule félicita les fédérés : « A la bonne heure, citoyens, c’est là de la bonne besogne ! » Vérig montrait son pistolet d’arçon et disait : « C’est avec cela que j’ai achevé le fameux archevêque, je lui ai cassé la gueule. » Il se vantait ; le procès-verbal d’autopsie démontre que Mgr Darboy ne reçut pas « le coup de grâce ». Il n’en fut pas de même de M. Bonjean : dix-neuf balles l’atteignirent sans le tuer, sans même lui faire de blessures immédiatement mortelles ; un coup de pistolet tiré en avant de l’oreille gauche mit fin à son martyre. Si Vérig, encore tout chaud du meurtre, se félicitait d’y avoir pris part, on pourrait croire que plus tard, loin de l’enivrement de la lutte, il eût regretté d’avoir assassiné des innocents ; on se tromperait. Certains hommes, pétris d’une argile impure, s’enorgueillissent d’un crime, comme d’autres s’empressent vers une bonne action. Deux ans et demi après la soirée du 24 mai 1871, Mégy a parlé, et il est utile de recueillir ses paroles. Un journal américain, mal informé, avait annoncé qu’il s’était fait justice lui-même. Voici dans quels termes Mégy rectifia l’erreur :
« New-York, 8 décembre 1873 ; à monsieur le rédacteur du Sunday Mercury. Monsieur, j’ignore où vous puisez les renseignements que vous publiez dans votre journal ; quant à celui qui me concerne, c’est une mystification que je trouve mauvaise ; aussi je vous prie d’insérer ces lignes pour rétablir la vérité sur mon prétendu suicide. Quoique deux fois condamné à mort en France et au suicide par vous, je suis encore vivant. Je ne suis pas plus mort que le jour où j’ai tué l’agent de police de l’Empire qui voulait m’arrêter parce que j’étais républicain ; pas plus que lorsque j’étais pour cette cause au bagne de Toulon ; pas plus que le jour où j’arrêtais à Marseille le préfet Crosnier ; pas plus que lorsque je commandais le fort d’Issy sous la Commune, ou que je liquidais avec mon chassepot l’affaire en litige à la Roquette. Enfin je ne suis pas plus mort que le jour où je suis arrivé ici, et n’ai pas envie de mourir, au contraire ; c’est que j’espère vivre jusqu’au jour où je pourrai encore faire justice des assassins du peuple. — Edmond Mégy, mécanicien, ex-gouverneur du fort d’Issy sous la Commune. »
« L’affaire en litige » n’était qu’en partie « liquidée », et les otages de la quatrième section qui avaient entendu l’appel des victimes, qui avaient ressenti au cœur le retentissement du feu de peloton, s’attendaient, toutes les fois que l’on ouvrait la grille ou que l’on passait dans le couloir, à être menés à la mort. François lui-même était persuadé que tous les détenus de cette section étaient destinés à être fusillés ; parlant de l’un d’eux, il dit : « Celui-là sera de la seconde fournée, ce sera pour demain. » Il avait un ami parmi les otages renfermés à la quatrième section, un nommé Greff, venu de Mazas et incarcéré comme ancien agent secret. François voulait le sauver ; aussi dans la soirée il le fit changer de section, précaution inutile qui n’empêcha pas la mort de ce malheureux, réservé au massacre de la rue Haxo.
Les otages ne se faisaient donc aucune illusion et ils eurent un tressaillement pénible lorsque au milieu de la nuit ils entendirent plusieurs hommes entrer dans leur section, ouvrir des cellules et parler à voix basse. Heureusement il n’était plus question d’assassinat ; il ne s’agissait que de vol. Vérig, qui ne laissait jamais passer une bonne occasion, un greffier de la Petite-Roquette, un deuxième greffier du dépôt des condamnés et le brigadier Ramain, éclairés par un surveillant, venaient s’assurer si l’héritage des victimes méritait d’être recueilli. Dans la cellule de l’abbé Allard et dans celle du père Ducoudray, on ne fut point content ; on ne trouvait que « des soutanes de jésuites » , et cela ne paraissait pas suffisant. Dans la cellule de Mgr Darboy, on fut plus satisfait ; l’anneau pastoral les avait mis en gaité ; on en discutait la matière et la valeur ; ils faillirent même se prendre aux cheveux, car ils ne parvenaient pas à s’entendre sur la nature de l’améthyste : les ignorants prétendaient que c’était un diamant, les savants soutenaient que c’était une émeraude. On fit un paquet de ces pauvres défroques et on les porta dans l’appartement du directeur, que tant d’émotions, accompagnées de trop de verres de vin, avaient un peu fatigué et qui s’était mis au lit de bonne heure.
Pendant que l’on dévalisait les cellules, les cadavres, étendus au pied du mur de ronde, se raidissaient dans la mare de sang dont ils étaient baignés. Vérig, le brigadier Ramain, un greffier des Jeunes-Détenus nommé Rohé et quatre ou cinq autres nécrophores munis de lanternes, vinrent à deux heures du matin s’accroupir auprès des corps mutilés. On y allait sans ménagement, et l’on déchirait tout vêtement dont les boutonnières ne cédaient pas au premier effort. Un d’eux se passa la croix pastorale autour du cou, ce qui fit rire les camarades ; un autre, voulant arracher les boucles d’argent qui ornaient les souliers de l’archevêque, se blessa la main contre un ardillon ; il se releva, frappa le cadavre d’un coup de pied au ventre et dit : « Canaille, va ! il a beau être crevé, il me fait encore du mal. »
Cela dura quelque temps ; Ramain disait : « Dépêchons-nous, le jour va venir. » Alors on jeta dans une petite voiture à bras le corps de Mgr Darboy, du président Bonjean, de l’abbé Deguerry ; un fédéré s’attela dans les brancards, d’autres poussèrent derrière et aux roues ; on arriva ainsi au cimetière du Père-Lachaise, où les corps furent versés dans une des tranchées toujours ouvertes aux fosses banales. On fit un second voyage pour emporter les restes de l’abbé Allard, du père Clerc et du père Ducoudray. Aucun des objets volés dans les cellules et dans les vêtements des victimes ne fut retrouvé. Un paquet de hardes qui ne pouvait servir à rien parut compromettant. La maîtresse de François donna deux francs pour acheter de l’huile de pétrole et brûler ces inutiles dépouilles. Le directeur avait donné l’ordre de « nettoyer » l’endroit où les otages étaient tombés et d’enlever toute trace de sang. Une pluie printanière se chargea de ce soin ; l’eau du ciel lava la place.
Fin de l’extrait
PIÈCE JUSTIFICATIVE
NUMÉRO 9.
Lettre du surveillant Henrion.
Pantin, le 25 mai 1871.
Monsieur Brandreith,
Le 24 à six heures et demie du soir, il est arrivé un piquet de 40 hommes commandé par un officier ; je crois être le 106e bataillon ; ils venaient pour fusiller l’archevêque, les gendarmes et sergents de ville. Me voyant seul avec un de mes collègues pour aller chercher tous ces malheureux et les livrer à leurs bourreaux, j’ai profit de l’encombrement de la cour et du poste qui regardait par la grille, pour partir. A sept heures j’étais dehors l’enceinte ; j’ai pu remarquer que c’étaient tous des hommes de 20 à 25 ans avec le pantalon gris de fer à bande rouge ; il y en avait un en bourgeois ; le capitaine qui est arrivé un instant après, dit à ses hommes que c’était abominable que ce bataillon soit commandé deux fois pour cette corvée dans la même journée et que tout cela retomberait sur les officiers. Les gendarmes et sergents de ville étaient à la promenade. Ils sont arrivés ; je ne puis vous dire si l’exécution a eu lieu. Je n’aurais jamais pu remplir cette tâche que je me voyais tracée : conduire quatre ou cinq de mes camarades de régiment dans les mains des exécuteurs, sans les embrasser. D’après la réputation que j’avais devant le directeur et les greffiers, je me voyais perdu. Sitôt que M. le directeur Brandreith aura repris son poste, s’il veut avoir l’obligeance de m’écrire, je me rendrai à mon poste ; je resterai à Pantin en attendant.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes sentiments les plus respectueux.
Signé : henrion.
Mon adresse: Route des Petits-Ponts, n° 17, à Pantin.
(Lettre timbrée Pantin, 25 mai 1871 ; arrivée à Versailles, timbrée 26 mai 1871. M. Brandreith était le directeur régulier du dépôt des condamnés.)
————
[1]« 22 mars 1871. Ordre est donné au directeur de la Petite-Roquette de mettre eu liberté provisoire tous les détenus militaires, sans exception. Raoul Rigault. » Pièce citée dans le procès Marigot ; débats contradictoires ; 4e conseil de guerre ; 19 octobre 1871.
[2]« Le nombre des détenus s’élève à 230, dont 2 condamnés à mort. Le directeur Brandreith refuse de reconnaître le Comité central ; le greffier refuse tout service. Il y avait en caisse 756 francs, qu’on a refusé de me remettre. » Extrait d’une lettre de François à Raoul Rigault en date du 24 mars 1871.
[3]Il avait fait enlever et transporter chez lui les cinq dalles qui servent de point d'appui aux montants de la guillotine. On les retrouva le 28 juin 1871, lors d'une perquisition opérée à son domicile, rue de Charonne, n° 10. Il déclara avoir eu l'intention de les faire vendre en Angleterre comme objets de curiosité.
[4]Pour l’intervention inutile de Delescluze, voir procès Guinder et Dénivelle : déb. contr. ; 6e conseil de guerre ; 19 juin 1872.
[6]On a lieu de croire que c’est un fédéré du 244e bataillon, surnommé les Turcos de Bergeret et commandé par Victor Bénot, qui aurait tiré le premier sur l’archevêque. Au moment où Mgr Darboy levait la main pour bénir ses assassins, ce fédéré, tailleur de son état et nommé Joseph Lolive, aurait lâché son coup de fusil, en disant : « Tiens, voilà notre bénédiction. » (Procès Lolive ; débats contradictoires, 6e conseil de guerre ; 25 mai 1872.)
11:00 Publié dans Biographie, Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)
10/11/2012
Les obsèques des otages par C. Ordioni
Voici le chapitre VIII de la Biographie de Sa Grandeur Mgr Georges Darboy, archevêque de Paris, avec une notice sur les principaux otages massacrés en mai 1871, par ordre de la Commune... (1871), par Cyprien ORDIONI. Ce chapitre relate très brièvement les obsèques des Pères jésuites massacrés le 24 mai à la Grande-Roquette et le 26 mai à la rue Haxo.
VIII
LES RR. PP. JESUITES
Le R. P. de Pontlevoy, provincial des Jésuites de France, préparant en ce moment une notice sur la vie des illustres victimes de son ordre qui ont été massacrées le 24 mai à la Roquette, nous nous bornerons à donner ici. leurs noms et à faire connaître les détails de leurs obsèques :
Le R. P. Ducoudray, supérieur de l'école Sainte-Geneviève, et le R. P. Clerc, professeur ; le R. P. Olivain, supérieur de la résidence de Sèvres ; les RR. PP. Caubert et de Bengy, ont été massacrés le 26 mai, à Belleville.
Les obsèques de ces serviteurs de Dieu ont eu lieu le 31 mai à l'église du Gesu avec une touchante simplicité.
Une assistance aussi nombreuse que recueillie emplissait la nef et les chapelles de l'église du Gesu, 35, rue de Sèvres ; toutes les classes de la société étaient confondues autour d'un nombreux clergé.
Les corps des cinq victimes étaient modestement rangés devant le maître autel, sans autre décoration funèbre qu'un simple drap mortuaire et quelques cierges. La messe basse a été célébrée par le R. P. de Pontlevoy, provincial de la Compagnie de Jésus.
Après la messe, le vénérable curé de Saint-Sulpice a rendu hommage à la mémoire de ces glorieuses victimes. Dans une éloquente improvisation, inspirée par ce zèle apostolique qui caractérise les vingt ans de son ministère pastoral, il a vivement ému l'auditoire. Voici en substance le fond de ce discours :
« Quel émouvant spectacle que celui de ces cinq victimes étendues sous nos yeux !
Qui ne pleurerait ce P. Olivain, aussi distingué dans sa vie laïque que dans sa vie religieuse, — lui qui a donné au collége de Vaugirard sa véritable célébrité ; qui ensuite est venu, dans cette résidence, épancher dans les âmes les élans de sa piété et de son zèle ; goûté de tous par la sagesse de sa direction et par le succès de ses retraites ?
Qui ne pleurerait le P. Ducoudray, supérieur de l'école Sainte-Geneviève ?—Après avoir puisé la science profane et ecclésiastique à la Faculté de droit et au séminaire de Saint-Sulpice, il était entré dans la Compagnie de Jésus, — avait dépensé toute son intelligence à préparer aux Écoles polytechnique et de Saint-Cyr des ingénieurs et des officiers sur lesquels le pays fonde en ce moment de légitimes espérances pour la réhabilitation de notre patrie déchue.
Et comment oublier ce bon P. Caubert, connu de tout le monde par les nombreux services qu'il rendait dans cette maison ?
Et le P. Clerc, qui avait quitté son grade d'officier de marine pour embrasser la vie religieuse !
Et enfin ce P. de Bengy, illustre par la noblesse de sa famille, plus illustre encore par son dévouement infatigable dans les avant-postes du siége de Paris !
Je pleure sur tous ces morts, parce qu'il révèlent au monde entier la ruine, la honte et les désastres de. nôtre France. Faut-il que la malice de l'impie soit violente, pour le pousser à commettre d'aussi cruels massacre, accomplis avec toute la brutalité du sauvage et la préméditation du scélérat !.
Mais si je pleure sur tous ces malheurs, je me réjouis dans la gloire et les espérances que nous procurent ces martyrs. —Oui, au nom de la théologie," ceux-là sont martyrs qui meurent sous le coup d'une persécution religieuse, qui sont tués par haine de Dieu et de la religion dont ils sont ministres. Y avait-il une autre raison de les mettre à mort ? On n'a pas eu un seul reproche à leur faire. Étrangers à toute discussion politique, ils vivaient dans leur cellule, tout appliqués à leurs études et au salut des âmes.
Donc ils sont martyrs, et si l'Église n'avait pas à se prononcer sur leur canonisation, déjà je vous inviterais à entonner l'hymne de l'action de grâces et à célébrer leur entrée dans le ciel. Ô Église ! tu seras fécondée par le sang de ces victimes. Ô France ! tu seras régénérée par ces holocaustes.
Ô Compagnie de Jésus ! tu peux te réjouir : tu es toujours aussi féconde et ; aussi généreuse ; Y a-t-il un seul point de la terre qui n'ait été arrosé de ton sang, pour la prédication « de l'Évangile et l'affermissement de la foi ? »
Le pieux pasteur termina cette allocution par les conseils que lui dictaient son expérience et son grand amour du bien pour l'Église et la patrie.

17:28 Publié dans Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)