17/11/2013
La vie du Père Olivaint - Chapitre XVII
http ://www.archive.org/details/pierreolivaintpOOclai
PIERRE OLIVAINT
PRETRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
PAR LE P. CHARLES CLAIR
1890
CHAPITRE XVII
Le siège de Paris. — La Commune.
Les dernières années qui précédèrent les douloureux événements de 1870, furent signalées par la recrudescence des passions révolutionnaires et antireligieuses. L’Église, les congrégations, les jésuites, dénoncés à la tribune du Sénat et du Corps législatif, redevinrent le thème habituel des déclamateurs de clubs et des journalistes de faubourgs ; le dévergondage des idées fomentait le désordre et préparait l’émeute.
Le P. Olivaint suivait d’un regard attristé les progrès du mal. La faiblesse du pouvoir en face des manifestations démagogiques, l’apathie des bons, leurs divisions intestines lui faisaient prévoir, à courte échéance, la catastrophe ; mais ce qui l’inquiétait plus que la violence des ennemis de l’ordre social, c’était la timidité de ceux qui auraient dû le défendre. Les catholiques eux-mêmes, à les considérer en général, ne lui paraissaient pas déployer un courage égal au péril. Nous trouvons, dans ses notes, cette plainte énergiquement exprimée : « Conduite des catholiques. — Comme ils s’effacent, au lieu de s’affirmer ! comme ils se trahissent, au lieu de se soutenir ! comme ils se retirent, au lieu de s’avancer ! comme, seuls, ils font des concessions ! comme ils exaltent leurs adversaires et rabaissent leurs défenseurs ! comme chacun prétend avoir exclusivement l’Église pour soi et lutte contre les autres !... »
Le profond chagrin qu’il éprouvait à ce spectacle était, grâce à Dieu, adouci par le zèle et la générosité que plusieurs déployaient au service de la religion et du pays. Il était heureux, par exemple, quand quelques-uns de ses enfants, au club du Pré-aux-Clercs ou du Vieux-Chêne, avaient affronté bravement la colère ou les sarcasmes d’un auditoire hostile pour défendre la vérité et venger l’honneur de l’Église.
En voyant se multiplier les attaques contre la Compagnie de Jésus, le P. Olivaint se dit que l’heure était venue de souffrir sans faiblesse la persécution dont le mystérieux attrait avait naguère décidé de sa vie. Il ne cessa de conseiller la résistance par toutes les voies légales, mais sans se faire illusion sur le résultat ; il savait qu’en temps de révolution la loi n’est plus qu’un vain mot. Tout son espoir était en Dieu : « Nous retiendrons sur nous et sur nos œuvres la bénédiction d’en haut, écrivait-il dans un mémoire adressé au P. Provincial, si nous sommes vraiment religieux, religieux avant tout. Devant la loi, c’est le citoyen qui sauve le religieux ; mais, dans la pratique et devant Dieu, il est bien plus vrai de dire que c’est le religieux, par sa fidélité, qui sauve le citoyen ou plutôt qui se sauve lui-même. »
Au moment où la déclaration de guerre jetait tous les esprits dans l’agitation et l’inquiétude, le P. Olivaint sentit le besoin de se recueillir. Le 1er août 1870, il se mit en retraite, pour se disposer à la passion qui était proche. Toutes ses méditations et tous ses efforts tendirent à bien établir en lui le règne du Saint-Esprit par la pureté du cœur ; il prit pour dernier mot d’ordre : « Aimer, c’est souffrir, » et se déclara « prêt à mourir pour l’Église, le Souverain Pontife, la Compagnie… » Il sortit de la solitude pour apprendre nos désastres à Wissembourg, à Woerth, à Forbach, et ce qui lui parut plus humiliant que toutes nos défaites, l’abandon de Rome ! Ce fut pour lui l’annonce des plus grands malheurs, auxquels depuis longtemps il s’attendait. Dans les premiers jours de janvier 1870, il avait dit : « La persécution est à nos portes ; elle sera terrible. » Et comme la personne à laquelle il adressait ces paroles semblait douter de l’imminence du péril, il reprit avec animation : « Mon enfant, nous traverserons un bain de sang[1]. »
« Le 11 août 1870, raconte M. le docteur H. G***, partant avec mon ambulance pour l’armée du Rhin, j’allai faire mes adieux au P. Olivaint, à la maison de la rue de Sèvres. En me reconduisant, il me prit la main et me dit : « Vous avez raison de porter secours à nos blessés ; vous allez au-devant du danger et je vous approuve. Mais vous ne serez pas des plus exposés. La guerre a été follement engagée, nous sommes battus, et nous le serons encore. Profitant de l’impuissance du pouvoir, le parti radical, qui déjà s’agite, provoquera dans Paris un terrible bouleversement. On s’attaquera aux maisons religieuses, on commencera par les nôtres, on viendra ici même. Un nous trouvera tous, chacun à son poste, moi comme les autres, bien entendu. Ce que nous deviendrons… l’avenir vous l’apprendra. »
Peu de jours après, le P. Olivaint confiait au P. de Ponlevoy son jugement sur la situation : « Nous sommes tranquilles pour le moment. Mais la république rouge s’organise à côté de la tricolore. On voit sur les murs les avis de deux gouvernements, si l’on peut parler ainsi. Que la sociale l’emporte un instant, et nous savons d’avance notre sort. »
La prévision de cet avenir, loin de l’intimider, excitait son courage. « Que fera de nous la Révolution ? écrivait-il[2] ; confiance ! courage ! Nous sommes prêts à tout, et nous tâcherons de nous mettre au niveau des circonstances, ad majorem Dei gloriam ! »
Si, dans son patriotisme, il se faisait quelque illusion sur les chances de la lutte contre l’Allemagne, il n’en avait aucune au sujet des menées criminelles de la Révolution. « Comme vous voyez tout en noir ! disait-il dans une autre lettre[3] ; je suis bien loin de juger comme vous. Non. non, tout n’est pas perdu. Les Prussiens seront repoussés et je ne serais pas étonné même qu’ils dussent renoncer au siège de Paris. Mais la Révolution se lèvera probablement quand les Prussiens disparaîtront. A la Providence ! Il me semble que le Seigneur est en train de relever la France par ses humiliations même ; il a fait guérissables les nations de la terre, selon la parole de l’Écriture, et je m’obstine à espérer qu’ils nous guérira. »
En tous cas, il était dès lors énergiquement résolu à ne céder ni à la peur, ni même à la violence. « Je vous suis bien reconnaissant, ajouta-t-il, de m’offrir à tout événement un asile. Certes, j’irais avec une grande confiance sous votre toit, et ce serait pour moi une vraie consolation, si jamais la Providence m’obligeait à partir. Mais je ne vois pas comment cela pourrait arriver, à moins d’un décret de bannissement dont les gendarmes assureraient l’exécution. Autrement, que nous ayons affaire à la Révolution ou aux Prussiens, les âmes dans de tels dangers ont plus que jamais besoin de secours, et vous pensez bien que nous saurons rester à notre poste. »
Dans toutes ses lettres, il tient ce même langage. « Pour moi, écrit-il à Mme la maréchale Randon[4], pour moi, je ne quitte pas Paris : à tout événement je dois rester à mon poste, et pour nos Pères, et pour les chères âmes. » — « Vous le pensez bien, répète-t-il encore[5], je ne songe pas à fuir. Que deviendraient les pauvres âmes, si ceux que Dieu charge de les soutenir, les abandonnaient au milieu de telles épreuves ? Quand les gendarmes me feront sortir par la porte, en attendant que je puisse rentrer par la fenêtre, je verrai s’il y a moyen de visiter votre chère demeure. »
Au milieu de ces graves préoccupations, le P. Olivaint ne perdait rien de son généreux entrain et de sa merveilleuse activité. Dès le 26 août 1870, il organisait une vaste ambulance dans la maison de la rue de Sèvres, et assignait à chaque Père un poste d’aumônier et un poste d’infirmier à chaque Frère. Il fallut vaincre d’étranges résistances pour obtenir la faveur de se dévouer au service de nos braves soldats. Une fois ces obstacles surmontés, le P. Olivaint s’occupa d’un projet qu’il semble avoir eu grandement à cœur. Il s’agissait d’établir un Orphelinat pour les victimes de la. guerre. « Une œuvre de ce genre, dit-il[6], si utile en elle-même et qui ira rien de contraire à notre institut, serait certainement bien accueillie. Je la placerais dans un autre quartier, du côté de Saint-Philippe du Roule.... Auprès de cette œuvre peut-être un externat s’établirait. Dans les temps de révolution surtout, ceux-là seuls réussissent qui savent oser et prévoir. »
Le P. Olivaint a vu, du haut du ciel, se réaliser son pieux dessein. Le vénérable successeur de l’archevêque martyr a recueilli les orphelins de la guerre, et sur la rive droite de la Seine s’est élevé l’externat de Saint-Ignace qui réunit déjà plus de sept cents enfants.
L’investissement de Paris se complétait peu à peu ; la grande ville allait se trouver séparée du reste du monde. « Les Prussiens sont près d’ici, écrit le P. Olivaint dans une lettre qui parvint, à travers mille obstacles, jusqu’en Pologne[7] ; quelle affreuse guerre ! Et si nous n’avions que les Prussiens à combattre ! mais la Révolution se dresse devant nous. A Lyon flotte le drapeau rouge ; un certain nombre de nos Pères sont en prison. A Paris, les rouges sont encore contenus. Cependant plusieurs tentatives ont été faites. Notre collège de Vaugirard, pour sa part, a été attaqué deux fois[8]. J’ai eu, moi, ici, une petite émeute. Mais que Notre-Seigneur est bon ! On ne le voit jamais mieux que dans des temps semblables. Nous avons été remarquablement protégés[9]. Après tout, nous ne demandons pas mieux que de souffrir pour ramener la bénédiction de Dieu sur notre pauvre pays. Non, nous ne savions pas nous-mêmes à quel point la France était malade ! Mais Dieu a fait guérissables les nations de la terre, pourvu cependant qu’elles veuillent guérir. Ah ! si votre chère Pologne avait voulu ‘ Et notre France voudra-t-elle ? Comprendra-t-elle que tout est perdu si elle ne revient à Dieu, si elle ne retourne à la foi catholique, si elle ne renonce à cette corruption de mœurs et de doctrines qui sont au fond la vraie cause de ses malheurs ? Prions, prions, et en attendant des jours meilleurs, si jamais ils doivent luire, sachons nous dévouer pour les âmes et faire notre devoir. Il y a eu à Paris une grande débandade ; à l’approche du siège, des multitudes ont pris la fuite ; tous ceux que des raisons de force majeure ne retenaient pas ont déguerpi. Nous avons, nous, renvoyé nos jeunes gens et nos infirmes, et nous restons au poste pour soutenir les courages et panser toutes les blessures, pour réconcilier les mourants avec le Seigneur et leur ouvrir le ciel. Nous avons une ambulance dans chacune de nos maisons. De plus, nous logeons des mobiles. Nous avons des aumôniers aux fortifications et aux avant-postes. Nous faisons pour la patrie tout ce qui dépend de nous. Quant au danger, grâce à Dieu, nous n’y pensons pas. Je bénis Notre-Seigneur des dispositions calmes et généreuses de tous ceux qui m’entourent. Le canon va gronder, les bombes et les obus vont pleuvoir.... A la bonne Providence ! Ah ! mieux vaut mourir que de voir plus longtemps le triomphe de l’erreur et de l’iniquité sur la terre, mais il faut bien mourir, et quelle plus heureuse mort que de succomber dans le dévouement au service du bien, de la vérité, de l’Église et de Dieu !...
« Après la tempête, nous aurons des jours meilleurs. C’est la justice de Dieu qui passe ; bientôt nous sentirons les effets de sa miséricorde. Écrivez-moi bientôt et dites-moi que vous avez trouvé le secret de ne plus jamais pécher contre l’espérance, et que cette douce vertu soutient votre âme et votre corps même. »
Le P. Olivaint aurait ardemment désiré prendre pour lui, selon sa coutume, le ministère le plus pénible et suivre nos soldats sur le champ de bataille. « Nos Pères se dispersent dans toutes les directions pour relever les blessés avec un zèle bien édifiant, mandait-il le 21 septembre au P. Provincial. On serait vexé de rester là, si le vrai poste de Dieu n’était pas celui de l’obéissance. » Il n’était pas oisif ; son zèle était plus entreprenant que jamais. « La guerre prêche, » disait-il, et il constatait avec joie « un mouvement de retour à Dieu pour bien des âmes[10]. » Ce qu’il passe sous silence, ce sont les épreuves physiques et morales de ces tristes jours, du moins en tant qu’il s’agit de ses souffrances personnelles. « C’est, dit-il[11], la monotonie de l’état de siège, du froid, des privations, de la fatigue ; mais, en vérité, si nous nous comparons à cette multitude qui nous environne, nous avons bien peu à souffrir. Comme nous souffririons volontiers davantage, si le salut devait venir par là ! Ah ! si les âmes se tournaient davantage vers Dieu ! »
« La bonne Providence nous protège d’une manière manifeste. Elle a pour nous, ici particulièrement, pour cette question matérielle devenue passablement difficile, toutes sortes d’attentions touchantes. L’autre jour, les larmes m’en venaient aux yeux de reconnaissance. Sachez bien que nous ne sommes pas du tout au découragement, pas même à l’inquiétude : ce serait vraiment faire injure à Notre-Seigneur[12]. » Le 11 janvier, au lendemain du combat de Buzenval, il exprima avec plus d’énergie encore ce même sentiment : « Nous serions bien ingrats, si nous n’étions prêts à tout dévouement et à une inconfusible confiance. »
Enfin, ce long siège s’acheva dans l’humiliation de la défaite. En jetant un regard en arrière, le P. Olivaint éprouvait, avant tout, un sentiment de reconnaissance. « Qu’il fait bon mettre toute sa confiance en Dieu ! écrivait-il ; nous avons été l’objet d’une providence toute particulière. Sans doute, nous avons eu notre part d’épreuves, cela était juste ; mais en vérité, nous n’avons pas trop souffert. Trois de nos Pères ont été blessés sur les champs de bataille, mais légèrement. Les obus ont sifflé sur Vaugirard, la rue de Sèvres, la rue des Postes : c’était un assez vilain concert ; je ne sais pas pourquoi on vante la musique allemande ; mais personne de nous n’a été atteint. Quelques murs ont été percés, un énorme éclat d’obus s’est arrêté dans la tribune de notre église, juste au-dessus du saint Sacrement ; on eût dit qu’il n’était venu là que pour saluer le maître. Je dois avouer, pour toucher un autre point, que nous n’avons pas vécu certainement dans l’abondance ! Quelques-uns sont un peu plus maigres qu’auparavant ; quelques autres, tombant de fatigue, sont en train de se refaire. Cependant, l’état sanitaire est en général assez bon. Donc, bénissons Dieu et préparons-nous à le mieux servir, car il y aura bientôt beaucoup à faire : noble carrière pour ceux qui aiment le dévouement et vivent par le cœur[13] ! »
A un ancien élève de Vaugirard, impatient d’avoir de ses nouvelles, il disait : « Non, mon bien cher enfant, je ne suis pas mort et je vous aime toujours. Et Vaugirard n’est pas mort non plus, malgré les obus qui pleuvaient dans toute la plaine. Un seul projectile a touché les murs ; la petite chapelle de la nouvelle infirmerie a été saccagée. Dans le parc, les allées sont labourées, mais cette semence prussienne ne poussera pas. Les externes n’ont pas cessé de venir pendant le siège, excepté quand les obus s’opposaient à leur passage. Les internes rentrent maintenant ; bientôt il n’y aura plus qu’un souvenir ! Aux Moulineaux, les Prussiens étaient dans le bois et les Français dans la maison. Les Moulineaux ont échappé comme le reste. Voyez la protection de Dieu[14] ! »
Cette pensée de filiale confiance en Notre-Seigneur se mêle à tout ce qu’il écrit. « Rassurez-vous sur notre sort, mandait-il à une personne inquiète à son sujet[15] ; la divine Providence nous a miraculeusement gardés au milieu des douloureuses péripéties de ces effroyables jours. Malgré les rouges et les Prussiens, malgré les privations et les obus, il n’est pas tombé un seul cheveu de notre tête, car le Seigneur ne l’a pas permis. De toutes les communautés de la rive gauche qui se trouvaient, comme nos trois maisons, dans le tir pendant le bombardement, et sur lesquelles, par conséquent, pleuvaient les obus, je n’ai entendu parler que d’une seule religieuse qui ait été frappée, encore assure-t-on que la bonne Sœur avait demandé à Dieu cette blessure comme une grâce. Les fatigues n’ont pas manqué ; bon nombre d’entre nous, et moi tout le premier, sommes un peu comme des hommes à épuisés qui ont besoin de se refaire ; nous allons nous décarêmer en carême. Bientôt il n’y paraîtra plus. Ah ! s’il pouvait en être ainsi de notre pauvre France ! Si elle voulait, si elle savait comprendre la cause de ses malheurs ! Si, désavouant son impiété sociale, elle revenait à Dieu pour rentrer dans sa vieille mission de nation catholique, armée du glaive, comme un chevalier, pour la défense de la sainte Église, ah ! comme elle se relèverait.... Pauvre France ! comment espérer que le voile épais du mensonge tombe enfin ? »
Et, dans une autre lettre[16], résumant d’un mot ses impressions, il garderait, disait-il, de tous ces événements, « un souvenir mêlé de consolation et de tristesse : tristesse, en pensant à tant de victimes ; consolation, en pensant à tant d’âmes qui s’étaient rapprochées de Dieu. »
Il était loin cependant de croire que tout fût terminé ; l’avenir lui apparaissait bien sombre. « On dort ici comme aux bords de l’Océan, écrit-il quelques jours avant l’insurrection de la Commune[17], sachant bien que l’on peut être réveillé à chaque instant par la tempête ; mais on dort... et le Seigneur garde et Marie étend les mains.... Confiance ! »
« Remerciez avec nous Notre-Seigneur qui nous a si bien gardés et qui nous garde encore, écrivait-il ce même jour à un Père de la Compagnie. Les rouges sont toujours là qui rugissent ; humainement parlant, la position est vraiment critique. La guerre civile peut éclater à chaque instant. Les insurgés ont des batteries de canons et de mitrailleuses braquées sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre. Mais Notre-Seigneur est là. C’est un vrai miracle de sa miséricorde que ces misérables ne soient pas devenus maîtres de tout pendant le siège : il est bien certain que le gouvernement ne les arrêtait pas. Une force mystérieuse, à leur grand étonnement, la main même de Dieu les a contenus et les contient encore. Nous comptons de plus en plus sur le secours de Notre-Seigneur. »
Pour l’obtenir sûrement, le P. Olivaint réclame l’intercession des Saints au ciel et des âmes pures sur la terre. Parlant d’une religieuse du Carmel : « Il ne fallait pas, dit-il, qu’elle quittât Paris. Où donc, au milieu de si cruelles épreuves, où donc eût été la protection et l’expiation pour cette ville coupable, si les anges du sanctuaire avaient fui ? Ne lui parlez pas de partir maintenant. Autant que jamais on a besoin que les prières et les pénitences de la sainte Montagne du Carmel détournent le tonnerre attiré par les hauteurs impies de Montmartre et de Belleville. »
L’horrible assassinat du malheureux Vincenzini (26 février), le meurtre des généraux Lecomte et Clément Thomas (18 mars ;, la fusillade de la place Vendôme (22 mars) servirent de prélude aux atrocités dont les hommes de la Commune allaient se rendre coupables. C’est dans cette inutile manifestation de la paix que tomba, victime de son courage, un des enfants les plus aimés du P. Olivaint.
Paul Odelin, lieutenant au 16e bataillon de la garde mobile de la Seine, avait, durant le siège, fait chrétiennement son devoir. Ce vaillant jeune homme avait toujours rêvé quelque beau dévouement. En 1867, il avait voulu s’engager aux zouaves pontificaux : « Si je meurs, disait-il, je serai martyr, j’irai au ciel tout droit ; c’est la mort qui me convient, à moi ; il faut que ce soit court et bon. » Pendant la guerre, songeant à l’avenir, il entrevoyait la possibilité d’un complet sacrifice de lui-même à Dieu. « Mon cœur, écrivait-il, déborde du besoin de se donner entièrement et sans récompense ici-bas. » Dieu l’exauça ; selon le vœu du généreux enfant, ce fut court et bon...
Le mercredi 22 mars, il marchait donc auprès du drapeau, au premier rang, en uniforme. Épargné par la première décharge, Paul reprocha énergiquement aux fédérés leur indigne guet-apens, et tomba frappé par une balle en pleine poitrine. A cette douloureuse nouvelle, le P. Olivaint accourut et s’agenouillant auprès du mort : « Quelle sérénité, murmura-t-il tout en pleurs ; cher Paul !... J’envie son sort ! » Et s’adressant à la pauvre mère désolée, il ajouta : « Je n’ai pas une parole de consolation à vous dire. Je n’ai pas de consolation pour moi ; comment pourrais-je vous en donner ? Du reste, n’en cherchez pas sur la terre : voyez Paul au ciel et n’en descendez pas. » En disant ces mots, il arrosait de larmes les vêtements ensanglantés de celui qu’il se plaisait à appeler un de ses plus chers enfants de Vaugirard et qu’il pleurait maintenant avec la douleur et l’affection d’un père[18].
Le jour des funérailles, le P. Olivaint, après la messe, fit l’absoute ; mais il put à peine prononcer le» prières ; sa voix était étouffée par les sanglots. Le 25 mars, il écrivait : « Paul Odelin a été tué l’autre jour, à la place Vendôme. Hélas ! pauvre mère !... Priez pour elle, priez pour ce cher jeune homme. C’est une vraie perte : il promettait beaucoup ; il avait le cœur et l’intelligence, la foi et le dévouement, le savoir-faire et le courage. Que de fois je l’ai admiré pendant le siège ! Il était lieutenant dans un bataillon de Belleville, ‘et, bien que parfaitement connu comme catholique, il avait conquis le respect, l’estime, l’affection de ses hommes ; c’était même le catholique qu’on appréciait en lui. Encore un dont le sang noble et pur va peser dans la balance de Dieu du côté de la miséricorde. Sursum corda[19] ! »
Un secret pressentiment l’avertissait qu’il ne tarderait pas à prendre lui-même sa part de l’expiation sanglante. Le lendemain des funérailles de Paul Odelin, le dimanche de la passion, deux mois jour pour jour avant le martyre de la rue Haxo, le P. Olivaint, s’étant rendu une dernière fois au couvent des Oiseaux rempli des souvenirs de sa mère, adressa aux religieuses quelques paroles d’encouragement. Il développait avec une merveilleuse énergie cette divine promesse : « Pas un cheveu ne tombera de votre tête sans la permission du Père céleste[20], » quand, s’interrompant tout à coup : « Vous me direz : il ne s’agit pas d’un cheveu seulement, mais peut-être de la tète.... Eh bien ! si la tête tombe, ce sera avec la permission et la grâce du Père céleste. » Son visage devint radieux, sa voix de plus en plus vibrante : « Quelle faveur serait-ce ? s’écria-t-il. Voyez les apôtres : Ils allaient, transportés de joie d’avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, ibant gaudentes... Soyons, nous aussi, généreux et prêts au sacrifice. Il faut du sang pur à la France pour la régénérer ; mais qui de nous sera jugé digne de verser le sien ? Si nous sommes choisis, quelle grâce ! Si nous sommes laissés, humilions-nous. »
Le même jour, le P. Olivaint visita le P. de Ponlevoy dans la retraite où celui-ci, par obéissance, avait dû se réfugier. Prévoyant un cas extrême qui n’était pas chimérique : « Avant tout, dit-il à son supérieur, si on vient m’arrêter, je veux me poser sur mon terrain et me donner pour ce que je suis : citoyen français, sans doute, mais prêtre, mais jésuite ; car c’est sous ce titre que je vis et que j’entends bien mourir. — Soit, lui fit-il répondu, moriamur in simplicitate nostra[21]. S’il faut mourir, au moins mourons tout entiers et tombons tout d’une pièce[22]. » De retour à la maison de la rue de Sèvres, le P. Olivaint prit avec le plus grand calme ses dernières dispositions. Il réunit les siens autour de lui et leur dit « qu’il fallait s’attendre à servir de victimes.... J’espère être là pour répondre moi-même en cas de surprise, ajouta-t-il. Si on s’en prend à vous, renvoyez à moi ; je suis le responsable. » Puis il indiqua les articles de la Constitution de 1848 et du Code pénal qui protègent la liberté individuelle, le domicile, la propriété....
« A ce moment, raconte un des Pères présents à cette scène, le P. Olivaint remarqua que je souriais un peu en l’entendant parler d’avocat pour nous défendre ; mais il m’expliqua sa pensée : « Je suis le supérieur, me dit-il ; je dois, comme un capitaine de vaisseau, tout tenter pour sauver le navire et ne le quitter que lorsqu’il aura sombré complètement. » Il n’oublia aucun détail dans les conseils qu’il donnait à chacun et qu’il avait eu soin d’écrire en trois grandes pages. Ces notes que nous avons sous les yeux réglaient minutieusement tout ce qui concernait la dispersion, le refuge assigné à chaque Père, la vie religieuse en dehors de la communauté, le fruit spirituel à tirer de ces épreuves, etc. Il se leva en disant : Ils viendront : confiance et courage ! Il savait, à n’en pouvoir douter, qu’ils allaient venir. Le 2 avril, un ami dévoué lui demandant s’il ne jugeait pas prudent de quitter Paris, le P. Olivaint lui répondit du ton le plus naturel : « Nous avons été prévenus par un de ces malheureux[23] qu’une perquisition ici a été décidée. Nous serons probablement arrêtés demain ou après-demain. Que voulez-vous ? Il faut savoir rester à son poste. Qui sait si, dehors, nous ne regretterions pas le bien que peut-être nous pourrons faire dedans ? »
Le 4 avril, de grand matin, on vint lui annoncer que, durant la nuit, un bataillon de fédérés avait violemment envahi l’école Sainte-Geneviève et fait prisonniers huit Pères, quatre frères coadjuteurs et sept domestiques. Ces otages, dont trois, les PP. Léon Ducoudray, Anatole de Bengy et Alexis Clerc, devaient glorieusement mourir, avaient tous été conduits au dépôt près la préfecture de police, vaste prison attenante au Palais de Justice où se trouvait déjà incarcéré M. le président Bonjean, et où, dans la même journée, furent amenés tour à tour Mgr Darboy, Mgr Surat, M. Deguerry, curé de la Madeleine, M. Moléon, curé de Saint-Séverin, M. Crozes, aumônier de la Roquette, l’abbé Allard, ancien missionnaire.
Il avait été décidé d’abord que le P. Olivaint laisserait la maison à la garde de deux Pères et se retire rait en lieu sûr. Mais, à ces tristes nouvelles, « un revirement soudain se fit dans sa disposition, » raconte le P. de Ponlevoy[24]. Tel était son caractère. Tant que le danger n’était que probable, il consentait à s’y soustraire ; maintenant qu’il est à la fois certain et très-prochain, il n’y consentira jamais ; mille fois plutôt s’y précipiter lui-même que d’y abandonner ses frères ! Il apprend ce qui vient de se passer la nuit précédente à l’école Sainte-Geneviève ; il est semi-officiellement prévenu, de la part d’un membre de la Commune, de tout ce qui s’apprête pour le soir. Mais Dieu sans doute lui met au cœur d’attendre ; son parti pris est irrévocable, il attendra de pied ferme. Comme par un mouvement spontané, il va droit au P. Bazin, désigné pour garder la maison : « Mon Père, lui dit-il d’un ton bien décidé, j’ai changé mon premier plan ; vous partez et je reste. » Celui-ci se permet quelques observations en effet très-spécieuses. Mais le P. Olivaint coupe court : « Non, non, ajoute-t-il, il y a du danger, je suis supérieur, je dois et veux rester. » Cela dit, il lui laisse deux cents francs qui restaient encore pour venir en aide à la famille dispersée.
Plusieurs fois dans la journée et jusqu’au soir, les avis se multiplièrent ; au dedans et au dehors on revint à la charge : le P. Olivaint resta inébranlable « Je ne veux pas fuir devant les gens de la Commune, répétait-il ; il faut qu’ils me trouvent ici, s’ils y viennent.... S’ils me font prisonnier, je les suivrai. S’ils font plus, j’espère, avec la grâce de Dieu, leur montrer comment sait mourir un jésuite. »
Un peu avant midi, il répondit encore à une personne qui le suppliait de fuir : « Je suis comme un capitaine de vaisseau qui doit rester le dernier à son bord.... Après tout, si nous sommes pris aujourd’hui, je n’aurai qu’un seul regret, c’est que ce soit le mardi et non le vendredi saint. » A six heures du soir, on vint lui annoncer que la redoutable visite allait avoir lieu entre sept et huit heures. « Allons donc ! répliqua-t-il, pourquoi vous inquiétez-vous ainsi, mon enfant ? le meilleur acte de charité que nous puissions faire, n’est-ce pas de donner notre vie pour l’amour de Jésus-Christ ? »
Il était en habit ecclésiastique, se promenant, d’un pas ferme et décidé, dans le long corridor du rez-de-chaussée, en face de la porte d’entrée, et récitant tranquillement son bréviaire. Un ami vint encore le trouver : « Mais, mon Père, que faites-vous là ? » dit-il. — Le Père lui serra la main et répondit : « J’attends... »
[1]Lettre de Mme la baronne Duchaussoy, du 21 août 1875.
[2]Lettre du 11 septembre 1870 à Mme la marquise de Contactes.
[3]Lettre du même jour à Mme la marquise de Sainte-Marie d’Aigneau.
[4]18 août 1870.
[5]Lettre du 11 septembre 1870 à Mme la marquise de Contados.
[6]Lettre du 11 septembre 1870 au R. P. de Ponlevoy.
[7]Lettre du 14 septembre à Mme la comtesse Laniewska.
[8]M. le comte de Kératry, préfet de police, averti du danger que courait le collège de Vaugirard, s’empressa de prendre des mesures pour le protéger. Le P. Olivaint l’en remercia aussitôt par une lettre que M. de Kératry a insérée dans son livre : Le 4 septembre et le gouvernement de la défense nationale, p. 227. — A ce sujet, le P. Olivaint écrivit au P. de Ponlevoy (14 septembre) : « J’ai remercié le préfet de police de ce qu’il a fait en nous protégeant... Ainsi M. de Kératry devient notre défenseur !... J’ai signé carrément supérieur des Pères jésuites. Ils savent assez déjà ce que nous sommes, et je crois préférable, quelles que soient les difficultés, de ne pas avoir peur de le dire nettement au nom de la liberté. » — Le P. de Ponlevoy répondit : « Vous avez bien fait de remercier : la politesse et la gratitude ne gâtent rien. Si l’on savait combien nous avons à cœur, avec la cause divine, la chose publique ! Tâchons, en faisant nos preuves, de le montrer à Dieu et aux hommes. Le dévouement et la charité sont d’ailleurs le plus sûr de tous les paratonnerres. »
[9]Voici comment le P. Olivaint raconte l’événement auquel il fait ici allusion. « Hier, nous avons eu notre petite alerte. Une méchante fille de quinze ans, qui vient mendier ou voler dans notre église, a été mise à la porte par Xavier (un des sacristains). Alors elle s’est avisée de crier dans la rue qu’on l’avait battue, qu’on l’avait jetée dans une prison toute noire ... La foule s’assemblait et prenait fait et cause pour elle. Je suis arrivé, et j’ai cru que la soutane ne servirait qu’à exciter les colères. Je suis donc resté en observation, attendant le moment où l’église serait envahie. Heureusement Notre-Seigneur a détourné le coup. Notre serrurier qui passait, a empoigné la misérable et, à l’aide de Jeux mobiles, il l’a menée je ne sais où ; la foule alors s’est écoulée et nous n’avons plus rien eu à craindre. Dieu est fidèle ! Croyez, mon révérend Père, que nous comptons bien sur lui, et que nous ne sommes pas déconcertés le moins du monde. Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. » (Lettre au P. de Ponlevoy, 11 septembre 1870.) — Le P. Olivaint s’était demandé si le moment était venu.... Le danger passé, il prit néanmoins la précaution de se jeter sur son lit tout habillé, ne voulant pas être surpris, lendemain, faisant le récit de ce qui s’était passé, il répéta encore : Ce n’était pas encore le moment.
[10]14 octobre.
[11]29 décembre.
[12]26 novembre.
[13]Lettre du 10 février 1871.
[14]Lettre à M. Franco Doria.
[15]Lettre du 26 février 1871 ; à Mme Cabat.
[16]17 mars.
[17]8 mars.
[18]Notice sur Paul Odelin, p. 183 et suiv.
[19]Lettre à Mme Duparc, 25 mars.
[20]Luc, xxi, 18.
[21]Mourons dans notre simplicité (I Mac, n, 35.)
[22]Actes de la captivité et de la mort, etc., par le P. de Ponlevoy, xie édit., p. 23.
[23]Cet homme, que la Commune improvisa maire du Ve arrondissement, avait reçu un service important du P. Olivaint et ne se montra pas ingrat.
[24]Actes..., p. 41.
16:09 Publié dans Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)




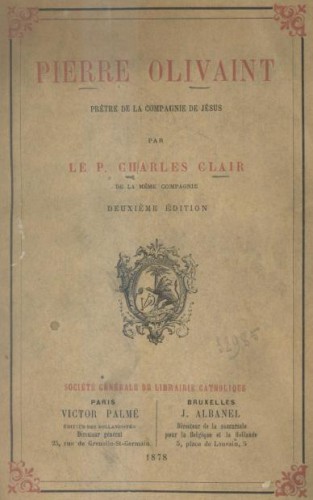
Les commentaires sont fermés.